Isabelle Henrion-Dourcy, Le théâtre ache lhamo. Jeux et enjeux d’une tradition tibétaine, Peeters-Leuven, Institut belge des hautes études chinoises, « Mélanges Chinois et Bouddhiques », Volume 33, 2017, 940p.
Nathalie Gauthard
Octobre 2020
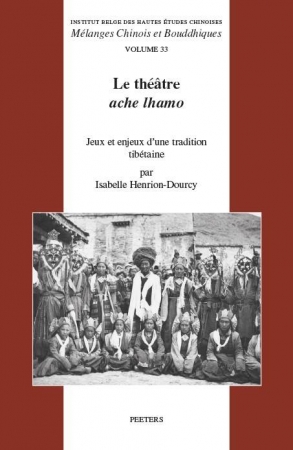
1L’ouvrage d’Isabelle Henrion-Dourcy impressionne d’emblée par son volume (940 pages) et la richesse de son propos : circonscrire une pratique artistique tibétaine, l’ache lhamo à l’époque pré-moderne (avant 1950). C’est en témoin privilégié, lors de terrains ethnographiques à la fin des années 90 et au début des années 2000 qu’elle a observé et analysé ces pratiques scéniques encore vivantes. La publication de cette monographie a été motivée par un sentiment « d’urgence » : celui de la perte, de l’uniformisation des traditions et de la transformation des sociétés contemporaines. Cette réalité de terrain est particulièrement renforcée par le contexte socio-politique de l’annexion chinoise sur le Tibet (1959) et par le durcissement autoritaire et répressif de ces dernières années. Isabelle Henrion-Dourcy l’introduit en ces termes :
Aujourd’hui, cette tradition est devenue bien souvent une caricature d’elle-même. Les chants, les danses, les costumes, les paroles sont méconnaissables, folklorisés à outrance, offerts à une consommation touristique de masse (page 3)1.
2Le ton est donné et ce travail d’envergure en est d’autant plus important2.
3Cette publication est le fruit d’un remaniement de sa thèse de doctorat écrite et soutenue en 20043. C’est une recherche qui « revendique un caractère exclusivement descriptif », une monographie d’une tradition scénique majeure au Tibet central fondée sur un travail ethnographique réalisé durant quatre ans dans la Région autonome du Tibet (R.A.T.)4 entre 1996 et 1998 et dans les communautés de l’exil en Inde et au Népal entre 1998 et 2000. Son propos est « d’appréhender le fait théâtral tibétain de manière à la fois globale et intégrée », de « produire une intelligibilité de l’ache lhamo en soulignant les interrelations de ses divers aspects — culturels, religieux, sociaux, économiques et politiques » tout en démontrant qu’il est un « genre composite échappant aux catégories du théâtre occidental » (page 4). Ainsi, le recours au mot théâtre dans le titre de l’ouvrage pour désigner l’ache lhamo recouvre une volonté de tempérer tout ethnocentrisme et raccourci sinocentré :
On parle de théâtre No et de théâtre Kathakali. L’opéra de Pékin représente un cas particulier, mais c’est justement pour éviter de suggérer une éventuelle parenté, en l’occurrence inexistante, avec cette tradition scénique que j’ai préféré garder le mot « théâtre » pour le lhamo. J’essaierai toutefois de conserver le plus souvent le vocable tibétain, qui évite la « traduction-trahison », à l’instar des termes vernaculaires de Kathakali ou No qui sont aujourd’hui passés dans l’usage courant (page 5).
4Malgré cela, le lhamo a bien été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (PCI) de l’UNESCO en 2009 sur les listes chinoises et désigné en tant que « Tibetan opera, the most popular traditional opera of minority ethnic groups in China »5 en raison de la présence du chant et de la musique instrumentale, éléments constitutifs, entres autres, du lhamo.
5Ache lhamo, signifie grande sœur-déesse en référence à la fondation de ce genre scénique. Il est à la fois un drame religieux et populaire (l’un n’excluant pas l’autre), une satire mimée, une farce paysanne, une récitation sur un mode parlé, du chant, de la musique, du son, des percussions, de la danse, des bouffonneries improvisées, des personnages masqués ou non, s’accompagnant d’une sobriété des décors et de la mise en scène. En résumé, c’est une pratique scénique, un art performatif protéiforme conjuguant des formes d’expressions très diverses. Afin de circonscrire cet art dans sa totalité, cette recherche convoque plusieurs champs disciplinaires : l’histoire culturelle, la socio-anthropologie et les études théâtrales. Il est divisé en trois parties. La première intitulée « Textes et contextes : le cadre culturel du Lhamo à l’époque pré-moderne » (pp. 55-283) éclaire le contexte sociétal, historique, religieux et culturel d’émergence de cette pratique scénique populaire. La seconde partie, « L’ancrage sociologique du Lhamo » (pp. 287-408) présente les résultats d’une analyse sociologique fine sur les troupes, les acteurs et les commanditaires de l’ache lhamo. La troisième partie « Sur scène : art et savoir des acteurs » (pp. 413-704) expose en détail les techniques et les registres de cette discipline scénique et propose des réflexions sur les liens entre théâtre et rituel en convoquant des théoriciens du théâtre tels que Richard Schechner, Piergiorgio Giacchè, Eugenio Barba et Jean-Marie Pradier.
6Plusieurs légendes d’origines sont attribuées à la naissance du lhamo. Il aurait été fondé par le Mahasiddha Thangtong Gyepo, un tantriste et yogi du XVe siècle, architecte et constructeur de ponts et vénéré en tant qu’incarnation d’Amitabha, le bouddha de la lumière infinie. Il est toujours évoqué au début de chaque représentation avec son effigie sur la scène et par les invocations des lhamowa, les praticiens du lhamo. Parmi les légendes et théories avancées, il y a celle qui consisterait en une récolte de fonds par la représentation théâtrale et comme moyen de duper les démons. La danse d’introduction, dite des chasseurs masqués (le masque symbolisant Tangthong Gyepo), est une danse commune de conjurations des démons. Pour Isabelle Henrion-Dourcy,
cette revendication d’un fondateur illustre et d’une filiation ininterrompue est un trait caractéristique de l’herméneutique et de l’innovation dans la culture tibétaine, qui valorise le respect fidèle de la tradition. L’innovation est toujours expliquée en termes de vision ou de révélation mais celle-ci n’est légitimée en tant qu’acte fondateur que par l’autorité spirituelle du visionnaire. Il faut que les visions émergent dans une conscience éveillée pour qu’elles soient considérées comme pures, alors que les simples trouvailles d’un quidam sont sans fondements (p. 76).
7Les démons sont ainsi distraits par le spectacle tandis que les dieux ou les divinités locales s’en réjouissent. De surcroît, on peut deviner dans la légende de l’architecte constructeur de pont, une métaphore poétique ou une allégorie religieuse de ponts menant vers l’Éveil. Le lhamo appartient à la catégorie savante et bouddhique du dögar. Le dögar est un terme savant, issu d’une division classique du savoir élaboré par le bouddhisme tibétain. Il désigne une science mineure, subdivisée en cinq sections, composantes nécessaires pour la réalisation du spectacle où l’on retrouve les savoir-faire : la narration de l’histoire, la musique, les costumes, le rire et l’humour et enfin le dögar. Ce dernier terme s’est d’ailleurs imposé parmi les communautés tibétaines en exil, en particulier au sein du Tibetan Institute of Performing Arts6 sous le patronage de l’Administration Tibétaine en exil (C.T.A.). Le dögar, sous-section de la grammaire, permet d’enseigner le Dharma d’une manière agréable pour obtenir l’adhésion des auditeurs. Ce qui rejoint les observations de la sanskritiste Lyne Bansat-Boudon lorsqu’elle s’interroge sur le théâtre indien :
Comment le théâtre se fait-il école du dharma ? C’est que, défini comme « un objet à voir et à entendre », donc promis à la représentation, il est pour les spectateurs l’objet d’une perception directe (pratyaksapratiti). C’est en tant que tel qu’il se révèle capable d’enseigner le dharma : en montrant son fruit.7
8L’auteur met en parallèle à de nombreuses reprises les productions scéniques tibétaines et indiennes bien qu’à priori, le Natyashastra, le traité de théâtre indien, n’ait pas été traduit en tibétain, néanmoins de nombreuses concordances existent. Elle met en exergue deux fonctions du théâtre : instruire et divertir. Une autre fonction est celle de réjouir les dieux du sol, en effet : « on dit que là où un lhamo a été joué, les céréales poussent mieux, car la terre a reçu des bénédictions (jinlab). Tout le public prend refuge, car tous les mots chantés sont les mots du Bouddha » (entretien avec Tashi Döndhup cité page 513). Cela renvoie à la notion de « religion cadastrale »8 destinée à réjouir les dieux du sol. Le lhamo est également temo, littéralement « ce qui est à regarder », il renvoie ainsi à la même étymologie des termes « spectacle » et « théâtre ». La première partie se conclut sur le résumé des pièces du répertoire Chögyel Norsang, Drime Künden, Nangsa Öbum, Sukyi Nyima, Pema Öbar, Drowa Zangmo, Chungpo Donyö Döndhup, Gyasa Besa et les livrets d’acteurs.
9Dans « l’ancrage sociologique du lhamo », le lecteur a accès à une très large documentation sur l’organisation de la troupe et sur les relations (parfois surprenantes) des commanditaires avec les membres de la troupe. Le Tibet pré-moderne avait une « organisation domaniale » (p. 300), les domaines appartenaient à l’État, aux aristocrates et aux monastères. Cette organisation comprenait de nombreux impôts (nature, service, culture). Les représentations d’ache lhamo faisaient partie de l’impôt en culture des paysans à leurs seigneurs, notamment durant les grands festivals, dont le Shotön, la fête du yaourt à la fin de l’été à Lhassa. Ainsi, pouvoir politique et enjeux sociaux se conjuguaient via les représentations de lhamo. La troupe des Kyomolunga y est étudiée en particulier. La relation ambiguë entre théâtre et discipline monastique y est abordée :
En principe, et c’est une conception issue de la culture monastique elle-même, le théâtre est une activité noble, le spectacle dögar est porté au rang de science, il indique un chemin d’Éveil ; ses jeux sur le langage, la gestuelle et le chant servent un message spirituel. Mais dans la pratique, il apparaît que cette fonction d’édification n’a de valeur et d’utilité que pour le simple peuple non pour les moines eux-mêmes (page 385).
10Appréciées ou sanctionnées, ces troupes de laïcs ou de moines connurent des épisodes divers dans l’histoire de lhamo.
11La troisième partie, particulièrement axée sur les arts performatifs tibétains, constitue une mine d’informations sur les techniques de jeu et l’esthétique théâtrale. La description et l’analyse détaillée du prologue, du vocabulaire technique, du chant, de la musique, des masques, constituent une des études les plus stimulantes de ces dernières années en études théâtrales. La formation pratique d’Isabelle Henrion-Dourcy aux arts du spectacle et au mime n’y est pas étrangère. Cette acuité permet des observations et analyses fines et très précises des savoir-faire et techniques des lhamowa. Le lecteur apprendra par exemple que, contrairement aux théâtres traditionnels d’Asie (Inde, Chine), les techniques du corps du lhamo n’incarnent pas une « virtuosité dynamique » (p. 527) mais une « technique vestimentaire » donnant « corps » au costume. Au-delà, le naturel est valorisé, l’absence d’effort, la fidélité au texte et l’improvisation. Du reste, le jeu des lhamowa est exempt de toute identification à des divinités tantriques comme dans le ‘cham9 ou des cultes de possession. Les lhamowa prônent une mise à distance, une retenue, car « ce qui émeut le public n’est pas le fait de voir une émotion dépeinte mais c’est la situation dans laquelle se trouvent les personnages qui provoque la compassion, la tristesse, la joie, ou la réprobation de ceux qui regardent » (p. 658). L’humour, le comique fait partie intégrante des représentations de lhamo que ce soit pour railler les comportements (moines cupides, fonctionnaires véreux, faux oracles, etc.) ou les accoutrements des étrangers ou provinciaux. Les personnages principaux ne rient pas, ce sont les spectateurs qui s’en donnent à cœur joie lors de satires, parodies, pastiches voire obscénités durant les intermèdes comiques car comme le rapporte un fameux proverbe tibétain : « Parler de vagin, parler de pénis ne fait de tort à personne… » (p. 691). Certaines de ces moqueries, en particulier celle consistant à affubler aux meilleurs interprètes de lhamo des surnoms désobligeants ou grossiers, visent à éradiquer le mikha (littéralement « mauvaise bouche »), un principe nuisible né du regard admiratif ou envieux d’autrui et qu’il faut détourner par la dévalorisation. Enfin la représentation de lhamo donnait l’occasion de faire un pique-nique, un des passe-temps favoris des Tibétains. Cette longue partie s’accompagne d’une réflexion approfondie sur les corrélations entre rituel et théâtre en se fondant sur l’anthropologie théâtrale, les performance studies et l’ethnoscénologie. Cette partie date un peu dans ces références. En effet, depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, de nombreux travaux en anthropologie ou en études théâtrales ont remis en perspective et en discussion ce faux débat. Cette réflexion a néanmoins le mérite de rappeler un pan de l’histoire des études théâtrales et des esthétiques occidentales et d’un point de vue méthodologique de ne jamais perdre de vue le contexte culturel étudié.
12Isabelle Henrion-Dourcy conclut sur les dangers de la folklorisation à outrance, l’enfermement dans de nouveaux modèles standardisés qu’ils soient en Chine ou en exil. En outre, l’ouvrage est agrémenté d’une bibliographie, discographie et vidéographie très riche ainsi que de plusieurs planches, illustrations et photographies prises durant des représentations de lhamo. Le tout forme un ouvrage incontournable car Isabelle Henrion-Dourcy a su éviter les pièges de la pluridisciplinarité avec une grande maîtrise tout en fournissant un témoignage ethnographique exceptionnel.
Notes↑
1 Isabelle Henrion-Dourcy a d’ailleurs publié dans le premier numéro de L’Ethnographie en ligne sur les transformations de l’ache lhamo depuis le début du XXIe siècle : « Quelques voies de renouveau pour le théâtre traditionnel tibétain depuis les années 2000 ». En ligne, consulté le 2 septembre 2020.
2 Cet ouvrage a obtenu le Prix Henri Lavachery de l’Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. Ce prix couronne un travail d’ethnologie, sous forme d’un écrit ou d’un film, réalisé dans la 11e période quinquennale, soit entre 2013 et 2017.
3 Thèse de doctorat en anthropologie sous la direction de Françoise Lauwaert et Fernand Meyer, en co-tutelle avec l’Université libre de Bruxelles et l’École pratique des Hautes Études (E.P.H.E.), IVe Section, de Paris (531p. + 258p. d’annexes), soutenue le 17 septembre 2004 à Bruxelles.
4 Depuis 1965, il est commun de désigner par Tibet la seule « Région Autonome du Tibet » redessinée par l’administration de la République populaire de Chine. Pour les populations de culture tibétaine, le terme Tibet recouvre « trois provinces », (tib., chol kha gsum) : l’Ütsang (pensé comme le centre du Tibet), le Kham (l’Est) et l’Amdo (le Nord-Est), soit une superficie d’environ 2,5 millions de kilomètres carrés, ce qui correspond à cinq fois la superficie totale de la France ou à la totalité de l’Europe de l’Ouest.
5 Voir « Tibetan opera ». En ligne, consulté le 2 septembre 2020. Sur les processus de patrimonialisation Chine-Tibet : Gauthard Nathalie, « L’Épopée tibétaine de Gesar de Gling. Adaptation, patrimonialisation et mondialisation », Cahiers d’ethnomusicologie, n°24, 2011. En ligne, consulté le 2 septembre 2020.
6 Sur les musiques et les arts du spectacle de l’exil, lire : Gauthard Nathalie, « Les graines de l’exil tibétain : du parcours intime au destin collectif », Cahiers d’ethnomusicologie, n°32, 2019, p. 197-213 et Lukasiewicz Chloé, « Chanter loin du Pays des Neiges. Que sont devenues les musiques traditionnelles tibétaines à Dharamsala après soixante ans d’exil ? », Cahiers d’ethnomusicologie, n°32, 2019, p. 179-195.
7 Bansat-Boudon Lyne, « Introduction. Le voile de la māyā, conceptions indiennes de la théâtralité », Puruṣārtha, n°20, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1998, p. 10-11.
8 Toffin Gérard, « De la nature au surnaturel », Études rurales, Paysages et divinités en Himalaya, Vol. 107-108, 1987, p. 9-26.
9 Sur le ‘cham : Gauthard Nathalie, Danses sacrées du Tibet. Une méditation en mouvement, Éditions Claire Lumière, 2016.
Pour citer cet article↑
Nathalie Gauthard, « Isabelle Henrion-Dourcy, Le théâtre ache lhamo. Jeux et enjeux d’une tradition tibétaine, Peeters-Leuven, Institut belge des hautes études chinoises, « Mélanges Chinois et Bouddhiques », Volume 33, 2017, 940p. », L'ethnographie, 3-4 | 2020, mis en ligne le 26 octobre 2020, consulté le 01 mai 2024. URL : https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie/index.php?id=694Nathalie Gauthard
Nathalie Gauthard est professeure en arts de la scène et du spectacle à l’Université d’Artois et présidente de la Société Française d’Ethnoscénologie - SOFETH (agréée ONG pour le PCI par l’UNESCO). Après une formation en lettres modernes à Paris 7 et en études théâtrales à Paris 3, elle s’est orientée et spécialisée en ethnoscénologie à Paris 8. Ses recherches portaient alors sur l’analyse des processus de composition, de recomposition et d’innovation des rituels tibétains dansés, ‘cham, à destination d’un regard extérieur au sein des communautés tibétaines exilées (Népal, Inde). Elle ensuite a poursuivi ses recherches sur l’analyse des processus de patrimonialisation de l’UNESCO et ses effets sur l’épopée de Gesar de Ling (RPC, Tibet). Outre sa spécialisation sur les pratiques scéniques et performatives asiatiques, elle étudie également les esthétiques et les pratiques carnavalesques. Elle a soutenu une HDR intitulée « Pour une anthropologie des arts vivants et performatifs. Dynamiques esthétiques, sociales et politiques en arts du spectacle » à Paris IV, elle poursuit à présent ses recherches sur la circulation, la transmission des savoirs, les processus de patrimonialisation et de revendications identitaires à l’œuvre dans les pratiques scéniques et performatives. Auteure de nombreux articles et de publications scientifiques, elle a été élue dernièrement directrice scientifique de la Revue L’Ethnographie. Création, Pratiques, Publics(MSHPN-USR3258).


 Flux RSS
Flux RSS