Heidrum Bruckner, Hanne M. de Bruin and Heike Moser (ed.), Between Fame and Shame: Performing Women – Women Performers in India, Wiesbaden (Germany), Harrassowitz Verlag: Drama und Theater in Sudasien 9, 2011, 284p.
Tiziana Leucci
Mars 2020
Index↑
Mots-clés : Inde, Femmes artistes, Personnages féminins, Rites de possession, Théâtre dansé-chanté
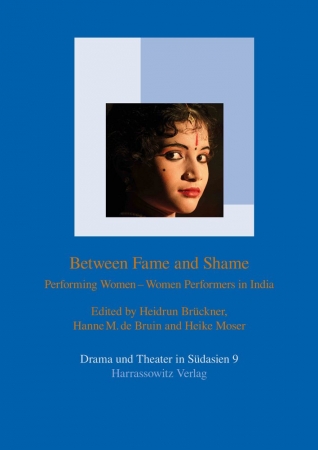
1Ce volume remarquable, accompagné d’une riche iconographie et d’un matériel vidéo accessible sur Internet contient des contributions de chercheurs d’Inde, d’Europe et des États-Unis. Le livre est divisé en trois grandes parties intitulées : « Théorie », « Histoire et Contexte Social » et « Interprétation ». Il contient douze articles multidisciplinaires, employant une diversité d’outils analytiques empruntés à diverses disciplines, telles l’histoire des arts vivants, l’épigraphie, l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’analyse de la performance, et les récits biographiques.
2Comme le titre intrigant le suggère, l’ouvrage traite surtout des personnages féminins joués par des acteurs masculins et l’ambiguïté des fonctions et rôles tenus par des femmes sur la scène indienne, à la fois rituels et théâtraux. Ironiquement, dans le passé récent comme dans le présent, la position des femmes/artistes dans la société balance constamment des hauteurs de la « renommée » aux bas étages de la « honte ». Une telle destinée dramatiquement précaire n’est malheureusement pas une particularité de l’Inde. Comme les historiens culturels des arts vivants le savent bien, ce destin marque profondément les vies d’une majorité de femmes/artistes en Europe également, comme Hanne M. de Bruin le mentionne justement dans son introduction au volume, bien structurée et informée (Contextualizing Women and Performance in India: An Introductory Essay, pp. 11-38).
3Ces femmes « subalternes » (pour utiliser la terminologie du philosophe et théoricien politique italien, Antonio Gramsci) doivent encore aujourd’hui lutter pour résister au système patriarcal dominant, désormais « modernisé » mais également « pernicieux », qui reste présent à tous les niveaux de la société indienne. Par le biais d’associations réformistes militantes, le code de comportement « hégémonique » des hautes castes, strictes et moralistes envers les femmes, a atteint toutes les classes, y compris les aires jadis laissées à l’agency des femmes « subalternes » où les femmes tenaient une position de pouvoir dans certains contextes rituels. À ce sujet, le volume contient plusieurs contributions très intéressantes sur les cultes et rites de possession aux divinités Siri et Renukā-Ellamma qui ont lieu encore aujourd’hui en Inde du Sud dans la région du Tulunadu (sud Karnataka), le district de Dharward (nord Karnataka), et sur les limites des Etats du Maharashtra et Andhra Pradesh.
4Le premier article, par Peter J. Claus (Reflections on Folk Literary Criticism, pp. 39-65) analyse le riche répertoire des chants pāddanas des régions Tulu du Sud Karnataka. L’auteur s’intéresse aux variations reflétant leur dynamisme comme les interventions actives des chanteuses dans le processus de préservation, élaboration personnelle, critique littéraire, et additions au corpus oral.
5Le deuxième article, par Elisabeth Schombucher (Divine Words, Human Voices: Listening to the Female Voice in Performances of Possession, pp. 67-94) clôt la première partie de l’ouvrage. L’auteur analyse attentivement le culte centré sur une femme possédée par Bhūlēkamma, la déesse des pécheurs, en se concentrant sur les clients et dévots, elle se focalise aussi sur les chants accompagnant le culte dans les aires parlant la langue Télougou1 de l’Odisha côtière. Le premier article de la seconde partie, par Heidrun Bruckner (Folk Culture and Modernity: The Case of Goddess Renukā-Ellamma and her Special Devotees, pp. 97-121) traite magistralement d’un culte controversé : celui en l’honneur de la déesse Renukā-Ellamma aux temples de Saundatti et Chandragutti, qui attire chaque année des milliers de dévots des états frontaliers du Karnataka, Maharashtra, Telengana et Andhra Pradesh. Dans les décennies passées, ce culte n’a cessé d’attirer l’attention des autorités gouvernementales locales, des travailleurs sociaux, et des institutions religieuses2. Bruckner met en lumière le processus de « moralisation » et de relative « adaptation » de ce culte aux conditions actuelles d’un hindouisme et d’une vie publique moralisée. J’adhère d’autant plus à ses conclusions que j’ai personnellement assistée aux impressionnantes cérémonies dont l’auteur traite, au début des années 1990 quand le processus était en cours, et que je suis arrivée à des conclusions proches, pour d’autres femmes et artistes intervenant autrefois dans les temples3.
6L’article suivant, de B. A. Viveka Rai (Gender in Folk Narratives with Special Reference to Tuluva Society, in the West Coast Region of Karnataka, India, pp. 123-133) présente une étude détaillée des cultes de Bhūtas et des possessions féminines de masse à Siri au Tulunadu. Rai analyse lui aussi brillamment les effets, malheureusement pas toujours positifs, de la dite « modernité » sur les performances rituelles locales et les possessions de masse. En examinant les résultats de ces interventions superimposées, l’on est tenté d’interroger les bénéfices réels pour la « santé et prospérité » de ces possédés masculins et féminins, qui se trouvent contraints d’accepter le moralisme « moderne », qui les prive totalement, eux et leurs pratiques traditionelles socio-religieuses de tout sens, considération, respect et pouvoir.
7La troisième contribution, par Lea Griebl et Sina Sommer (Siri Revisited. A Female ‘Mass Possession Cult’ without Women Performers?, pp. 135-152) complète le tableau complexe brossé par Rai en y ajoutant des éléments très importants sur la profonde transformation du culte de possession de Siri. Les deux auteurs montrent le caractère paradoxal de la situation présente dans laquelle, dans un culte essentiellement « féminin », la présence même des femmes tend à se raréfier en étant progressivement « domestiquée », « purifiée » ou totalement « éradiquée » pour de nombreuses raisons, certaines déjà évoquées.
8Le quatrième article, par Diane Daugherty (Subhadra Redux: Reinstating Female Kutiyattam, pp. 153-167), aborde la nouvelle vie d’une ancienne pièce du théâtre chanté et dansé Kūtiyāttam, qui n’avait pas été mise en scène depuis longtemps. L’auteur retrace magistralement le processus de « re-construction » de cette pièce, les choix faits par les artistes féminines actuelles au Kerala pour les faire « revivre » encore, pour un public moderne. Daugherty étudie l’impact sur la préservation des artistes héréditaires féminins dans l’art du Kūtiyāttam, connu comme Nannyār-kūttu, qui était jadis utilisé pour être réalisé seulement dans un espace spécifique localisé devant les temples, nommé Kūttampalam, pour une audience sélectionnée de connaisseurs composée surtout d’aristocrates et d’autorités religieuses pendant des cérémonies spéciales dans des temples. Elle souligne aussi l’importance d’avoir ouvert l’entraînement aux étudiants d’autres communautés, qui vont aider à préserver et diffuser la connaissance de ces arts à une plus grande audience au Kerala et au-delà.
9La cinquième contribution par Heike Moser (How Kūtiyāttam Became Kūti-āttam, ‘Acting Together’. Or: The Changing Role of Female Performers in the Nannyār-Kūttu Tradition of Kerala, pp. 169-188) est une étude détaillée de l’histoire du Kūtiyāttam et Nannyār-Kūttu, prenant en compte les sources épigraphiques liées à ces traditions théâtrales. Ces sources ajoutent à l’histoire de ces arts de la performance et confirment l’importance du rôle joué par les artistes féminines dans leur développement. Moser remet ainsi en cause l’affirmation commune de leur origine indigène kéralaise, car les inscriptions tendent à les localiser dans les régions tamoules voisines. Comme l’auteur le remarque, à l’époque médiévale, ces deux aires étaient culturellement liées.
10Le sixième article, par Christine Guillebaud (Women’s Musical Knowledge and Power, and their Contributions to Nation-Building in Kerala, South India: A Case Study of Kaikkottukali, pp. 189-207) traite d’un style de danse féminine de groupe du Kerala, appelé Kaikkottukali. Ce type de danse existe chez plusieurs communautés, depuis les brahmanes de hautes castes Nampūtiri aux basses castes de distilleurs (Toddy Tappers) et blanchisseurs (Dhobis). L’auteur montre la manière dont chaque communauté perçoit, réalise et interprète la même forme de danse, non seulement comme une variation chorégraphique, mais surtout à travers une représentation spécifique à la caste. Tout cela affecte la construction des séquences de pas, mais aussi le choix des instruments et chants d’accompagnement, le type de scène, les costumes et le public ainsi que la « bonne façon » dont ils considèrent que la danse même doit être présentée, enregistrée, « labellée » et finalement « appréciée ». L’étude analyse aussi l’histoire récente et l’appropriation « nationaliste » des danses Kaikkottukali, les lieux et contextes où elles sont régulièrement apprises et réalisées, les concours désormais répandus dans les écoles et autres lieux, et enfin la manière dont cette pratique contribue à construire un fier symbole d’identité régionale du Kerala dans l’esprit de ses habitants.
11La septième contribution, qui clôt la deuxième partie du volume, est due à Brigitte Schulze (Poetic-Painful Lives of Women Performers vis-à-vis High-Caste Moral Modernity as Remembered by Kamalabai Gokhale and Retold by Brigitte Schulze, pp. 209-220). Dans un article touchant, elle relate les conditions d’oubli dans lesquelles elle trouva la très âgée artiste Kamalabai Gokhale (90 ans), à Pune, qui fut une actrice de film et peut-être la première « star » du cinéma muet indien. À travers ses souvenirs de gloire passée, jours parsemés aussi de souffrances et de luttes, elle nous fournit un tableau réaliste de la vie quotidienne d’une actrice professionnelle indienne dans les troupes de théâtre et cinéma au début du XXe siècle. Ici encore, le lecteur peut facilement reconnaître le stigmate attaché aux femmes travaillant dans les champs des arts de la performance par les préjugés moraux des hautes castes. Une telle attitude, mêlant puritanisme chrétien Victorien, prescriptions légales socio-religieuses locales envers la pureté ainsi que l’obsession pour la chasteté féminine, devint particulièrement virulente et répandue en Inde à partir de la seconde moitié du XIXe siècle4.
12L’ultime partie du livre débute par un article de Marlene Pitkow (The Good, the Bad, and the Ugly: Kathakalī’s Females and the Men Who Play Them, pp. 223-243). Paraphrasant avec humour le titre de l’un des plus célèbres spaghetti western films du réalisateur italien Sergio Leone (Il Buono, il Brutto e il Cattivo, 1966), Pitkow nous donne une explication bien argumentée des trois grands types de personnages féminins codifiés dans les pièces de Kathakalī et interprétés par des acteurs masculins. Reflétant l’ambiguité générale et la suspicion envers la « féminité », de telles héroïnes sont divisées dans les catégories principales suivantes : (1) bonne, modeste, chaste et fidèle ; (2) mauvaise et ambivalentes, souvent séductrices, belles et bonnes dans leurs comportements et apparences extérieurs, mais traîtresses et intéressées dans leurs véritables intentions ; et (3) laides et méchantes, sorte de démons féminins, mais non dépourvues d’aspects comiques ou tragiques.
13La dernière contribution de cette partie est celle de Virginie Johan (Actresses on the Temple Stage? The Epic Conception and Performance of Women’s Roles in Kūtiyāttam Rāmāyana Plays, pp. 245-274). Après Pitkow, Johan décrit à son tour la technique particulière des acteurs de Kūtiyāttam d’évoquer les événements passés en « flashback », les différents rôles (surtout féminins), lieux et situations. Sans pouvoir nous attarder sur l’argumentation de l’auteur, nous voudrions tout de même réagir à sa conclusion selon laquelle « this theatre can be called ‘epic’, not only because it is narrative, but also in the Brechtian sense of the term » (p. 249). Cette comparaison nous paraît trompeuse pour diverses raisons. Tout d’abord, le fait qu’un artiste (indépendamment de son sexe) incarne différents personnages est une convention technique très « pratique », et répandue dans de nombreux styles de théâtre dansé d’Inde (donc nullement limitée aux Kūtiyāttam et Kathakalī). Ensuite, la similarité formelle entre le théâtre de B. Brecht et de telles conventions scéniques d’Asie n’est en rien surprenante, puisque le dramaturge allemand s’est explicitement inspiré du jeu de l’acteur chinois, Mei Lanfang, de l’Opéra de Pékin (rencontré en 1935 à Moscou), célèbre pour sa virtuosité à incarner des rôles féminins. Toutefois, au-delà de cet emprunt, les buts respectifs de ces deux jeux d’acteur, restent fondamentalement différents. Brecht a utilisé cette technique pour créer, dans ses propres termes, un effet de distanciation ou d’étrangeté (Verfremdungseffekt), pour limiter l’émotion, à la fois entre le personnage et l’acteur, et entre l’acteur et le public. Par cet effet, Brecht cherchait à obliger le public à percevoir plus intellectuellement et plus critiquement la situation socio-politique pour mieux la changer. Le théâtre « épique » de Brecht vise ainsi essentiellement à éveiller la conscience politique du spectateur. À l’opposé, comme l’auteur le sait, l’« esthétique » du Kūtiyāttam (comme dans la plupart des formes de théâtres indiens) repose sur le principe d’empathie, par l’éveil et la transmission de « saveurs » émotionnelles (rasa) chez l’acteur puis son public, à travers le regard (rasadrsti), les gestes5, les expressions du visage, les chansons, la danse et musiques, etc. La distanciation n’est donc aucunement recherché, bien au contraire, et il est douteux que le Rāmayāna, ou « l’Epopée du prince Rāma » et sa fidèle épouse Sita, vise à transmettre une « distance » politique vis-à-vis de l’ordre socio-cosmique, royal et brahmanique représenté.
14Par son caractère interdisciplinaire et sa valeur, ce volume présente une très riche et intéressante collection d’études sur les personnages féminins et le rôle crucial joué par les femmes dans les arts vivants et rituels, complexes et variés d’Inde, ainsi que dans le cinéma. Peut-être aurait-il été plus approprié de limiter l’intitulé à l’Inde du sud, car la quasi-totalité des articles concerne des traditions d’Inde du sud (Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Telengana, Andhra Pradesh). Seuls deux articles abordent les régions centrales : l’un sur le Maharashtra et l’autre sur les aires « Télougouphones » du sud de l’Odisha. Nous souhaitons donc que ce bel exemple soit suivi par des spécialistes d’autres États d’Inde centrale et du nord afin de compléter l’étude et développer une comparaison à l’échelle du sous-continent.
Bibliographie↑
ASSAYAG, Jackie, La colère de la déesse décapitée. Traditions, cultes et pouvoir dans le sud de l’Inde, Paris, CNRS éd., 1992.
ASSAYAG, Jackie & TARABOUT, Gilles (dir.), La possession en Asie du Sud. Parole, corps, territoire, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, coll. « Puruṣārtha », vol. 21, 1999.
BANSAT-BOUDON, Lyne (dir.), Théâtres indiens, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, coll. « Puruṣārtha », vol. 20, 1998.
LEUCCI, Tiziana, « L’apprentissage de la danse en Inde du Sud et ses transformations au XXème siècle : le cas des devadāsī, rājadāsī et naṯṯuvaṉār », Rivista di Studi Sudasiatici (RiSS), Firenze, Firenze University Press, 2008, p. 53-87. En ligne : http://www.fupress.net/index.php/rss/article/view/3170.
LEUCCI, Tiziana, Du Dâsî Âttam au Bharata Nâtyam: ethnohistoire d’une tradition chorégraphique et de sa moralisation & nationalisation dans l’Inde coloniale et post-coloniale. Thése de doctorat en Anthropologie sociale et ethnologie, Paris, EHESS, 2009.
LEUCCI, Tiziana, « Heidrun Brückner, Hanne M. de Bruin & Heike Moser (eds.), Between Fame and Shame: Performing Women—Women Performers in India », South Asia Multidisciplinary Academic Journal [Online], Book Reviews, 2015a, connection on 11 March 2020. En ligne : http://journals.openedition.org/samaj/3863.
LEUCCI, Tiziana, « ‘Partout où va la main, le regard suit ; là où va le regard, l’esprit suit’. Le langage des mains dans le théâtre dansé de l’Inde », Ethnographiques.org, N°31 : La part de la main, 2015b. En ligne : http://www.ethnographiques.org/2015/Leucci.
LEUCCI, Tiziana, « La danseuse de temple et courtisane au miroir de l’Occident chrétien. Usages et déplacements de l’imaginaire orientaliste dans l’Inde nationaliste et dans les études féministes postcoloniales », in : Anne Castaing & Élodie Gaden (dir.), Comparatisme et Société, N°35 : Écrire et penser le genre en contextes postcoloniaux, Bruxelles, P.I.E., Peter Lang, 2017a, p. 59-88.
LEUCCI, Tiziana, « La danse en Inde du sud, entre conflits générationnels, identitaires, de genre et de caste», in : Margaret E. Walker & Kaley Mason (dir.), MUSICultures 44/1 : Generational Frictions in Musical Ethnography of South Asia, 2017b, p. 134-162.
LEUCCI, Tiziana, « Davesh Soneji, Unfinished Gestures: Devadāsīs, Memory and Modernity in South India, University of Chicago Press, 2012; Permanent Black, New Delhi 2012 », Clio. Femmes, Genre, Histoire, N°46 : ‘Danser’, 2017c., p. 281-284. En ligne : https://journals.openedition.org/clio/13895.
NEGERS, Daniel, « La dimension politique dans l'émergence d'une forme narrative populaire à l'époque moderne: le Burrakatha d'Andhra Pradesh », C. Servan-Schreiber (dir.), Traditions orales dans le Monde Indien, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, coll. « Puruṣārtha », vol. 18, 1995, p. 103-125.
NEGERS, Daniel, « Burrakatha. A Telugu Folk Narrative of Andhra Pradesh in History and Performance », Molly Kaushal (dir.), Chanted Narratives, The Living 'Katha-Vachana' Tradition, New Delhi, Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2001, p. 119-135.
NEGERS, Daniel, « Jangamkatha and Burrakatha: From Religious Discourse to Political Message », M.D. Muttukumarasvvamy & M. Kaushal (dir.), Folklore, Public Sphere and Civil Society, New Delhi-Chennai, Indira Gandhi National Center for the Arts-National Folklore Support Center, 2004a, p. 225-264.
NEGERS, Daniel, « De l’expression orale au genre littéraire. L'Exemple du burrakatha d'Andhra Pradesh », Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, coll. « Puruṣārtha », vol. 24, 2004b, p. 157-179.
NEGERS, Daniel, « The “War of Bobbili”: Genres of Composition of a Folk Epic Story », M. Kannan & Carlos Mena (eds.), Negociations with the Past: Classical Tamil in Contemporary Tamil, Institut Français de Pondichéry & Tamil Chair, University of California, Berkeley & Pondichéry, 2006a, p. 353-416.
NEGERS, Daniel, « Le burrakatha de la reine Rudrama devi. L’Instrumentalisation d’un personnage historique dans la célébration de l’identité régionale andhra », V. Bouillier & C. Le Blanc (eds.), L’usage des héros. Traditions narratives et affirmations identitaires dans le monde indien, Paris, Champion éd., 2006b, p. 155-185.
PETERSON, Indira Viswanathan & SONEJI, Davesh (eds.), Performing Pasts. Reinventing the Arts in Modern South India, New Delhi, Oxford University Press, 2008.
SONEJI, Davesh, Unfinished Gestures. Devadāsīs, Memory, and Modernity in South India, Chicago & London, The University of Chicago Press, 2012.
Notes↑
1 Sur la tradition des formes dramatiques de théâtre chanté et dansé en langue Télougou, voir : Negers 1995, 2001, 2004a, 2004b, 2006a, 2006b.
2 Cf. Assayag 1992.
3 Cf. Leucci 2008, 2009, 2017c; Soneji 2012.
4 Cf. Peterson & Soneji 2008 ; Soneji 2012 ; Leucci 2017a, 2017b et 2017c.
5 Cfr. Leucci 2015b.
Pour citer cet article↑
Tiziana Leucci, « Heidrum Bruckner, Hanne M. de Bruin and Heike Moser (ed.), Between Fame and Shame: Performing Women – Women Performers in India, Wiesbaden (Germany), Harrassowitz Verlag: Drama und Theater in Sudasien 9, 2011, 284p. », L'ethnographie, 2 | 2020, mis en ligne le 20 mars 2020, consulté le 24 avril 2024. URL : https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie/index.php?id=508Tiziana Leucci
LEUCCI Tiziana, historienne et anthropologue de la danse, est chargée de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), rattachée au Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS, EHESS- CNRS), Paris. Ses recherches portent sur l’ethnohistoire de la danse en Inde, sur le statut des danseuses et courtisanes indiennes et sur leur perception et représentations, depuis le 13éme siècle, dans les récits de voyage et les productions théâtrales européens (ballets, opéras, pièces dramatiques, etc.). La figure de la ‘Bayadère’ notamment, a constitué la matière d’un DEA et d’un doctorat à l’EHESS (Paris), d’un ouvrage en Italien (2005) et d’articles (dont trois pour le ballet La Bayadère de Marius Petipa au Teatro alla Scala de Milan, au Teatro dell’Opera de Rome, à l’Opéra de Paris et à l’Académie de ballet A. Vaganova de St. Pétersbourg). Formée à la danse classique et contemporaine à l’Académie Nationale de Danse de Rome et à la danse indienne à Chennai et Bhubaneswar en Inde, elle enseigne aussi la danse Bharatanātyam au Conservatoire ‘Gabriel Fauré’, Les Lilas (France). Page web : http://ceias.ehess.fr/index.php?1780


 Flux RSS
Flux RSS