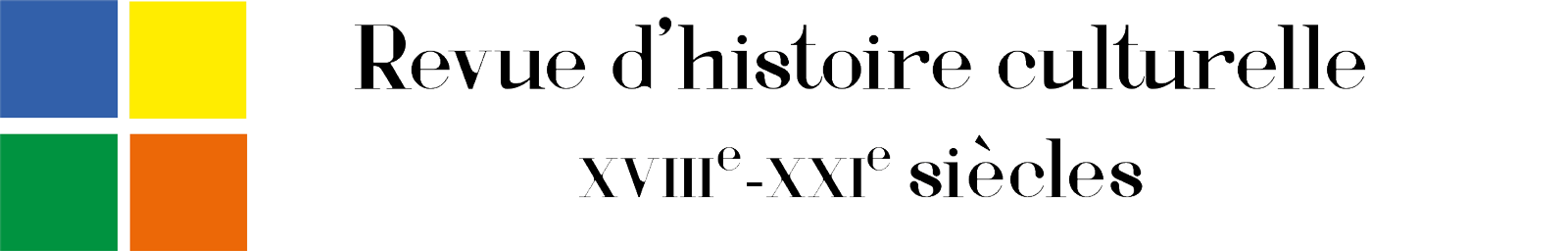La question générale, générique, structurelle du rapport entre histoire et culture que traite l’histoire culturelle intéresse intensément la psychanalyse et l’anthropologie psychanalytique dont je me réclame. Ce qui n’est pas évident pour tout le monde, la psychanalyse apparaissant comme une thérapie, une psychologie, une clinique, ce qu’elle est effectivement, mais ce qui méconnaît l’ambition freudienne de penser, dans le mouvement même de sa clinique, le lien social. Elle a été méconnue à l’intérieur même du devenir postfreudien. Occasion pour moi donc de la présente mise au point.
Une définition consensuelle serait une « histoire sociale des représentations », avancée par Pascal Ory. On parle bien en Allemagne de Kulturgeschichte, illustrée par Karl Lamprecht1 . Déjà se pose la question typographique autant que philosophique de savoir s’il faut écrire « culture » avec une minuscule ou une majuscule. La tradition française, de L’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations de Voltaire (1756) à l’Histoire de la civilisation en Europe2 (1800), au reste remarquable, de Guizot, dont on retient surtout l’idéologie libérale, préfère la minuscule - mais préfère surtout employer le terme de « civilisation », plus général. 1800-1900 : de Guizot à Lamprecht, voici la mise en place claire d’un paradigme fondateur. Que l’on pense également à la contribution de Maurice Agulhon à une histoire culturelle des représentations qui croise la psychanalyse sans s’y référer beaucoup et surtout sans s’y affilier – pour moi il n’y a d’ailleurs pas d’affiliation à la psychanalyse, puisque ce n’est pas une « vision du monde », Weltanschauung à prétention totalisante, mais une science, un savoir spécialisé du réel inconscient. Ce sont surtout les détracteurs et, pour le dire clairement, ses ennemis qui la réduisent à une « vision du monde » pan-explicative, espèce de » pansexualisme », faute d’en saisir le terrain et la démarche. Par ailleurs, mon expérience est que l’on apprend beaucoup en psychanalyse des études qui ne s’y réfèrent pas, plus que de celles qui s’y réfèrent à moitié. Car elles fournissent un matériau qui fait travailler le savoir de l’inconscient.
La représentation et son sujet : enjeux culturels
Au centre même de la question se trouve justement la notion de représentation (Vorstellung) : la question de la représentation est renouvelée par Freud en insistant sur le fait que le rapport du sujet à la représentation est lui-même divisé par la dimension inconsciente.
Et la notion de « mentalité » apparaît plus descriptive qu’explicative, depuis l’École historique des Annales (Lucien Febvre et Marc Bloch) : les belles études qui en ressortent laissent la notion elle-même comme un point d’interrogation. Ce qui émerge de ces variantes de l’histoire culturelle, c’est qu’elle procède du refus d’un économisme réducteur de la dynamique culturelle, ce qui oblige à repasser par une dynamique représentationnelle, au nexus de l’individuel et du culturel.
Aujourd’hui émérite3, j’ai dirigé pendant des années, à l’UFR sciences humaines cliniques de Paris VII, devenue Études psychanalytiques, un axe de recherche intitulé « Corps, pratiques sociales et anthropologie psychanalytique » dans le cadre de l’École doctorale « Recherches en psychopathologie et psychanalyse », avec des chercheurs de diverses disciplines : outre les analystes et chercheurs en psychanalyse, des sociologues, historiens, anthropologues, dans le cadre d’une UMR, Unité mixte de recherche Université de Picardie puis Paris-7/CNRS .
Voilà pour le contexte institutionnel. J’ajouterai que je dirige depuis l’année dernière un séminaire de recherche à la Maison Suger, annexe de la Maison des Sciences de l’Homme, où je persévère à prôner cet échange, ouvert à toutes les sciences sociales - nous y parlerons cette année des discours sociaux dans le rapport au « malaise de la culture »4.
Mon but aujourd’hui est de montrer l’éclairage que la psychanalyse, dans l’expérience ouverte par Freud, peut — et selon moi, doit, c’est mon engagement — apporter aux sciences sociales et plus spécifiquement à cette question de la Culture, en sa structure et son devenir.
Les thèses de l’anthropologie psychanalytique : pour une généalogie inconsciente de la Culture
Je voudrais donc présenter ce qui se désigne comme anthropologie psychanalytique, soit l’apport de la psychanalyse à la Culture, saisie en son envers inconscient.
De quoi s’agit-il donc avec l’anthropologie psychanalytique ?
Partons d’une mise au point : la psychanalyse n’est pas qu’une méthode d’investigation des processus psychiques inconscients et une méthode de traitement des troubles névrotiques, c’est une discipline qui ouvre sur le savoir de l’homme, l’inconscient en étant une dimension ou plutôt une « épine plantée » au cœur du savoir de l’homme qui l’a longtemps méconnu et qui a le loisir de continuer à la méconnaître. On ne peut donc pas la réduire à une psychopathologie. Freud rappelle dans son Autoprésentation (1925) qu’il est parti d’un intérêt pour la culture, est passé par la clinique du sujet, pour y revenir par un long détour.
Il ne s’agit pas non plus de donner dans ce que l’on désigne comme « psychanalyse appliquée », qui revient peu ou prou à « psychologiser » le social, ce qui n’a jamais été la tentation de Freud.
Donc le sujet de l’inconscient, c’est aussi le sujet du collectif (ce qui est tout autre chose que la croyance à un « Inconscient collectif » du type jungien ou autre). Le refus abrupt de Lacan d’une « anthropologie psychanalytique5 » en ce qui le concerne signifie qu’au fond « anthropologie psychanalytique » est une expression quelque peu pléonastique ou du moins redondante, la psychanalyse comme théorie du sujet de l’inconscient étant ipso facto une anthropologie du collectif. Encore faut-il préciser en quoi.
Un survol de la genèse de la contribution de Freud aux sciences sociales6 permet d’en mesurer la portée.
La « morale sexuelle civilisée » dans son rapport à la « nervosité moderne » ouvre, dès 1908, sur la question du sujet du symptôme et de la culture. Voici un premier croisement avec « l’histoire culturelle » qui tient en deux éléments essentiels.
En premier lieu, le névrosé ne relève pas que de la psychopathologie. La culture est fondée, construite (aufgebaut), tel un édifice, sur la répression pulsionnelle, en sorte que la névrose témoigne cliniquement de la difficulté structurelle de concilier les exigences culturelles et le sujet qui y « laisse des plumes ».
En second lieu — et c’est là un point essentiel — la névrose, quelle que soit sa forme ou celui sur qui elle se porte, a le pouvoir de « rendre vaine », de « déjouer » l’intention de la culture, qui tend à réguler la répression sexuelle. Ainsi le névrosé n’a pas que des symptômes, il est un symptôme culturel vivant et cela éclaire sur la condition névrotique de la culture, en sa dimension moderne. C’est de facto un opérateur anthropologique.
Il n’est pas inintéressant de remarquer que l’essai freudien paraît en 1908, dans la décennie initiée par l’essai princeps sur l’histoire culturelle de Lamprecht, mais il introduit cette dimension pulsionnelle qui définit a contrario l’entreprise de la Kultur. Dans ce contexte, le mariage apparaît comme un symptôme social décisif, comme je l’ai montré dans un ouvrage récent7, le mariage instrument de l’alliance étant une « institution de culture » à travers le désir de faire-un et un foyer de symptômes.
En un second temps, logique autant que chronologique, avec Totem et Tabou (1913), Freud hausse son ambition en passant de la condition moderne à la généalogie de la Culture, par une audacieuse spéculation.
Le Meurtre du Père originaire (Urvater) est présenté comme l’événement originaire générateur du lien social, mythe scientifique pour penser cette coupure, produit du Phantasieren théorique, mais étayé sur le réel clinique de la névrose, l’élevant à une réflexion sur interdit socio-symbolique et symptôme. Essai produit peu avant la mort de Lamprecht, ce qui symbolise, là encore, un franchissement
En un troisième temps, le meurtre revient dans l’institution et ses idéaux. L’institution analysée dans Psychologie des masses et analyse du moi (1921) se présente comme « une somme d’individus qui ont mis un seul et même objet à la place de leur idéal du moi et se sont identifiés les uns aux autres dans leur moi ». Effet de retour du meurtre dans le rituel des idéaux.
En un dernier temps, la religion comme » trésor de représentations »8 définie dans L’Avenir d’une illusion (1927) s’impose à l’anthropologie psychanalytique. Ce qui ouvre sur Le Malaise dans la Culture (1930) qui s’amorce par une définition de la Kultur, par la double détermination de la coupure avec la nature et de la réglementation des relations des hommes entre eux. Mais, au cœur de la Culture (ce qu’aux yeux de Freud nous avons finalement de plus précieux), œuvre la pulsion de mort, noyau d’agressivité qui ne figurait pas dans son premier essai.
L’anthropologie psychanalytique à l’épreuve de l’histoire : un paradigme concret. La profanation de Saint Denis sous la Révolution
L’exemple étant la chose même, plus encore que son illustration9 – tant sur le plan clinique que sociologique, il me semble recommandé de présenter un exemple, privilégié à mes yeux, correspondant à une étude au nexus de l’histoire et de la culture10 et de montrer comment se nouent, dans le champ proposé, l’objet et la méthode, bref le caractère utile, voire nécessaire, d’introduire l’hypothèse de l’inconscient freudien au cœur de la conception de la Culture, en tel moment dramatique de son histoire.
Le contexte historique est l’extraordinaire laboratoire de la Révolution française. C’est en quelque sorte l’événement initiateur de la modernité qui a noué culture et politique. Entrée de la Culture dans l’histoire par le bouleversement majeur de l’ordre politique.
« Tuer le mort », vous reconnaissez dans le titre de l’étude proposée, l’expression freudienne contenue dans Totem et Tabou, reprise par Daniel Lagache, l’un des inspirateurs des sciences humaines cliniques, dans le cadre de sa théorie anthropologique du deuil. Mais cette expression, elle s’est imposée à moi de façon très précise et très spéciale, quasi matérielle, quand je me suis confronté à cet événement — comment l’appeler, incongru, monstrueux, surtout intrigant — de l’exhumation des rois de Saint-Denis en pleine Terreur.
Je rappelle d’emblée de quoi il s’agit : à partir du 15 octobre 1793, l’ensemble des rois, souverains ayant régné sur la France depuis une quinzaine de siècles, 1200 ans pour être précis, enterrés à la nécropole ou abbaye royale de Saint-Denis, ont été systématiquement extraits de leurs tombes, jetés dans des fosses remplies de chaux vive, et le plomb extrait de leurs tombeaux a été fondu sur place : douze siècles annulés symboliquement en trois semaines. D’amont en aval : du dernier Bourbon régnant, Louis XV, à Dagobert, le bon roi de la chanson, enterré avec Saint-Denis.
Il ne s’agit pas de quelque passage à l’acte, de la ruée d’une horde, comme le dira Hugo dans son poème sur Le Rhin, en une belle outrance poétique, mais d’une décision froide de l’État révolutionnaire, de la Convention nationale et surtout du Comité de salut public. Deuxième mort des rois, thanatographie inscrite dans leur biographie, tendant à expurger littéralement la royauté du sol de France. Tous ces rois auront eu deux morts, anomalie biographique remarquable. Pourquoi les rois vivants ayant été mis hors d’état de nuire, fallait-il liquider les rois morts, qui, eux, ont en principe fini de nuire ? La tête de Louis XVI était tombée depuis le 21 janvier de l’année 93. Ce qui est moins connu, c’est que le jour où Marie-Antoinette va à l’échafaud, elle « croise » le corps de Louis XV que l’on extrait ce même jour de la nécropole ! On est là dans une torsion vertigineuse des temporalités historiques, par où se révèle le temps révolutionnaire.
L’équipe d’ouvriers n’aura pas chômé : en trois semaines, c’est au total quelque 46 rois et 32 reines qui auront été « extraits », auxquels il faut ajouter 63 princes de sang et 10 serviteurs du royaume (chambellans et chefs de guerre) ainsi qu’une vingtaine d’abbés de Saint-Denis, raptés dans l’affaire, soit 170 exhumés qui sont déterrés ou plutôt « désenterrés ». On sent déjà l’idée d’un contre-rituel.
Genèse d’un projet
Il n’est pas inutile de dire un mot sur ce qui m’a mis sur la piste de cette histoire. J’avais entendu parler depuis longtemps de cet événement, mémorisant dès mes années de formation peut-être, avec une curiosité incurable de normalien, même de khâgneux qui ne m’a jamais quitté, tout en l’oubliant régulièrement, faute de lui assigner un statut. Quelle signification lui donner ? L’histoire, quand elle est connue, est rangée au rang des curiosa, des curiosités historiques.
C’est dans mon enseignement à Sciences Po, où j’ai été pendant huit ans responsable d’un cours de Master « Histoire et théorie du politique » — je retrouvais ainsi le lieu que j’avais fréquenté, la Fondation Nationale des Sciences politiques —, que j’ai réinvesti en quelque sorte la trace mnésique de cet événement. Pourquoi ? Parce qu’en un enseignement semestriel annuel, je présentais les outils théoriques de l’anthropologie freudienne jusqu’en ses retombées socio-politiques, l’enseignement étant validé par une note de recherche finale où je demandais aux étudiants de prendre un exemple de l’histoire politique pour montrer dans quelle mesure les outils freudiens étaient utiles, ou nécessaires ou superflus, suffisants ou insuffisants. Expérience pédagogique assez exceptionnelle, puisque j’ai vu ce dont étaient capables les politologues en formation, de s’emparer de ces outils et de vérifier la fécondité heuristique des hypothèses freudiennes, avec un appétit dont les analystes mêmes ne sont pas toujours aussi capables, ayant quelque peu sous-estimé l’appel freudien de la préface de 1913 de Totem et Tabou de travailler avec les représentants des sciences sociales. J’ai même envisagé une publication collective de ces travaux d’études et failli le dédier à mes étudiants de Science po avec qui je suis resté en contact.
L’expérience a été une réussite, trop peut-être, car certains étudiants en venaient à envisager de commencer une thèse de psychopathologie, ce dont les indigènes de la discipline pouvaient s’offusquer, mais c’est une autre histoire. L’interdisciplinarité n’est pas un échange mondain ou académique, c’est une lutte, ça fait bouger les frontières et c’est aussi ce qui maintient vive la psychanalyse. Par exemple, chatouiller un peu le politique avec la psychanalyse, passe encore, en montrer l’efficace au cœur du social, c’est une autre affaire, ça va trop loin pour certains.
Or, selon un rituel immuable, je terminais mon cours en donnant un exemple pour aider à appliquer la fécondité heuristique freudienne aux objets socio-politiques, cet exemple-là, de l’exhumation de Saint Denis, pour montrer in concreto comment un chercheur en science du politique peut compléter sa boîte à outils et à quel moment — car il s’agit de la temporalité logique de la construction d’objet — la psychanalyse doit entrer en scène pour éclairer un point aveugle, un « scotome » de l’histoire. Après cette sorte d’entrainement, qui a pris fin en 2012, je me disais qu’il n’était pas possible de ne pas traiter la question, en ayant pressenti l’importance. Je dois dire que ce que j’ai découvert a dépassé les espérances.
C’est pour moi un paradigme concret de ce que peut l’anthropologie analytique, de sa nécessité, qui ne se réduit pas à quelque vitrine thématique ou à quelque « supplément d’âme inconscient » sur les objets sociologiques, historiques et politiques, où nous jouerions le rôle d’excitants temporaires des champs disciplinaires, qui s’empresseraient de revenir ensuite au sérieux de leurs objets, mais comme une problématisation fondamentale dont on peut afficher l’ambition : toute approche de sciences sociales décomplétée de l’hypothèse de l’inconscient mutile une partie de son objet réel même, soit l’envers inconscient du lien social et de l’institution politique.
J’ai rarement écrit un livre avec une telle intensité, car je me suis immergé dans l’événement confronté sans évitement au problème méthodologique. Autant il est aisé d’asperger les objets de quelques généralités freudiennes pour nous acquises et, du coup, peu utiles aux autres, que tels collègues enregistrent poliment (c’est intéressant mais ça ne prête pas à conséquence) ou plus sceptiquement : notre devoir épistémologique est de rendre compte du réel collectif. L’affaire est considérable, c’est dans cet esprit que j’ai défendu cet axe d’anthropologie psychanalytique avec obstination.
Mon premier constat fut que ce récit a intéressé plus les érudits ou les détracteurs de la Révolution française, avides de démontrer le vandalisme révolutionnaire, que les historiens eux-mêmes, malgré quelques exceptions dont la moindre n’est pas le travail d’Alain Boureau sur « le simple corps du roi »11 qui n’abordait qu’une dimension de la question.
Comment le magnifique Dictionnaire de la Révolution française ne consacre–t-il pas au moins un article spécifique à cette histoire de Saint Denis ? Serait-ce un détail de l’histoire, plus « symbolique », au sens vague, que réel ? Serait-ce une « bavure » du processus révolutionnaire ? Une énormité, une anomie ne saurait être un détail. Et c’est là que nous entrons en scène.
Un objet d’anthropologie politique
Je vais donc présenter le trajet, les résultats de l’enquête d’une part, les enjeux d’autre part pour une anthropologie du politique dans le présent, qui va de la question de la Terreur à celle de la souveraineté, dans son rapport au temps et à la mort.
J’ai cherché partout, par un travail de détective, toutes les traces de cet événement, chez les érudits et les historiens. Il était essentiel de constituer l’objet. Car s’il s’était agi de liquider l’affaire, avec Freud comme alibi, on aurait pu dire : voilà, ce meurtre post mortem des pères de la nation, c’est évidemment la consommation du Meurtre du père par les fils révolutionnaires. Cela confirme le Meurtre du Père qui nous est cher, à juste titre. Or, cela n’avance à rien, et cela surtout n’affecte en rien les discours de l’historien, du sociologue, qui diraient : voilà bien les psychanalystes, avec leur Meurtre du Père, l’objet historique est autrement complexe, et ils auraient raison. J’ai écrit ce livre à destination aussi des historiens, les premiers ayant réagi, et qui m’ont rassuré sur la véracité du récit historique que j’ai reconstruit, je crois même leur avoir appris quelque chose des faits. Mais l’enjeu est ailleurs et c’est ce qui en fait aussi une enquête à destination des analystes qui seraient oublieux de Freud anthropologue (et pas seulement à ses moments perdus) : c’est que d’un tel acte, qui rencontre un point-limite de la rationalité historique, la dimension inconsciente est absolument nécessaire pour rendre compte, à condition d’entrer dans les détails des faits et des discours. L’objet ne fait pas que vérifier, il nous enseigne. L’enjeu épistémologique en est considérable, car cela engage la légitimité de la psychanalyse à intervenir en de tels signes, sans se perdre dans quelque vague « psychohistoire » — on ne peut plus éloignée du point de vue freudien — ou une histoire des mentalités assaisonnée d’inconscient.
Alors comment procéder ?
Le discours politique ou l’annonce de l’acte
D’abord s’assurer du contexte politique et de la production des discours qui non seulement précèdent l’acte, mais en font partie : les rois ont été tués parce qu’une décision a été prise et justifiée.
Ensuite décrire la procédure en son détail, non pas simplement anecdotique, mais symptomatique. Il se trouve que c’est l’un des premiers actes administratifs de l’État français moderne.
Enfin mobiliser l’anthropologie analytique pour rendre compte du détail même de l’événement et de ses enjeux, du côté du sujet du politique et de la question de la souveraineté comme axe du politique, ce qui fait le caractère exemplaire et pas seulement insolite de l’événement. Pour le coup on a affaire à une radicalisation, en l’occurrence celle des processus révolutionnaires qui commencent par les Droits de l’homme et finissent par le massacre en règle, des vivants et des morts, dans la même fournée en quelque sorte.
Le cheminement d’une idée
Comment l’affaire démarre-t-elle ? Comment l’idée vient-elle aux acteurs de cet acte on ne peut plus prémédité, quoique les ressorts en demeurent secrets aux acteurs eux-mêmes ?
Par un malaise, vague mais récurrent, comme tout malaise, qui fait que les acteurs du Nouveau Régime s’avisent qu’il y a des rois sous terre, et que cette présence persistante, alors que l’an I de l’Humanité nouvelle a sonné aux horloges de l’histoire, est en soi scandaleux. Pour l’avenir radieux, le passé doit être exterminé, du passé faire table rase, ça nous rappelle quelque chose, et après on compte les morts.
C’est ensuite le déclenchement du discours de Barrère rapporteur du Comité de salut public devant la Convention nationale – le 31 juillet 1793, sous la présidence de Danton –, qui met le feu aux poudres. C’est bien une plaidoirie que fait vibrer cet avocat, bien nommé « l’Anacréon de la guillotine », paradigme vivant de la haine « monarchomaque12 », opportuniste à tout va. Il faut serrer de près la rhétorique qui, précédant l’acte, le met en forme par une jouissance. D’abord le « constat » : « Les porte-sceptres continuent à défier les vivants depuis leurs mausolées. » Cette chose désormais innommable appelée un « roi » n’est évocable que par périphrase, comme « porte-sceptre », ce « bâton de commandement » désormais persiflé comme le hochet des rois. Les habitats funéraires desdits « porte-sceptres » deviennent le symbole matérialisé de cette provocation posthume.
Le tombeau, métonymie du pouvoir royal, apparaît donc comme son complice et l’emblème de la servitude que scelle le « monde royal ». L’orateur eût pu rappeler que ce mot « mausolée » fut formé par antonomase sur le nom de Mausole d’Halicarnasse, ce satrape mégalomane qui s’était fait construire un gigantesque monument funéraire. C’est le Mausole royal comme tel qu’il s’agit de rabaisser, en ses fastes néfastes… Le raisonnement est remarquable : l’orgueil ostentatoire du pouvoir cynique des rois vivants ne s’adoucit pas même sur « le théâtre de la mort », voire s’y décuple. Les rois ont la mort même orgueilleuse. Leur morgue survit à leur existence et s’en exacerbe d’autant. Cette survivance arrogante d’une « grandeur évanouie » va exiger la pulvérisation de leurs habitats funèbres. Puisqu’ils s’enorgueillissent, paraît-il, au-delà de la tombe et par les tombes, la haine des vivants les y poursuivra…
Dans la monarchie les tombeaux mêmes avaient appris à flatter les rois ; l’orgueil et le faste royal ne pouvaient s’adoucir sur ce théâtre de la mort, et les porte-sceptre, qui ont fait tant de maux à la France et à l’Humanité, semblent encore, même dans la tombe, s’enorgueillir d’une grandeur évanouie. Roland évoquait « les vils ossements de tous ces monarques orgueilleux qui, du fond de leur tombe, semblent, encore aujourd’hui, braver les lois de l’égalité13.
Alors, que faire ? La réponse suit :
La main puissante de la République doit effacer impitoyablement ces épitaphes superbes, et démolir ces mausolées qui rappellent des rois l’effrayant souvenir14.
Voilà, magnifiquement programmée, l’entreprise de démolition.
Après un retard administratif, il faudra attendre octobre pour le voir réalisé, après que l’on se soit attaqué notamment aux gisants.
Le prétexte était de récupérer le plomb des tombeaux. Prétexte matériel d’un acte dont la disproportion s’éclaire de sa portée symbolique.
De cet acte, on dispose d’un compte rendu précieux de Germain Poirier, l’un des membres de la commission chargée de l’application du décret, que l’on connaît par la copie originale qu’en fit dom Druon intitulé « Journal historique de l’Extraction des cercueils de plomb des Rois, Reines, Princes, Princesses et autres Personnes, qui avoient leurs Sépultures dans l’Église de l’abbaye Royale de St Denis en France ». La profanation en acte se présente sous le script d’un document administratif.
On y trouve la date de l’extraction, le nom des rois extraits, l’état de conservation du cadavre, les odeurs qui accompagnent la décomposition.
Autour de l’Acte les passages à l’acte de la populace que la commission n’est pas parvenue à tenir à distance.
Deux remarquables réactions, contrastées, sur la personne d’Henri IV, le plus populaire des Bourbons, et Louis XIV, le plus exécré.
Un soldat qui était présent, mû par un martial enthousiasme au moment de l’ouverture du cercueil, se précipita sur le cadavre du vainqueur de la Ligue et, après un long silence d’admiration, il tira son sabre, lui coupa une longue mèche de sa barbe, qui était encore fraîche, et s’écria en même temps en termes énergiques et vraiment militaires : Et moi aussi je suis soldat français, désormais je n’aurai plus d’autre moustache. Et plaçant cette lettre précieuse sur sa lèvre supérieure : Maintenant je suis sûr de vaincre les ennemis de la France, je marche à la victoire !
Par ailleurs un « charretier du dépôt » voulut infliger un dernier outrage au corps de Louis XIV déjà dans la fosse, comme le rapporte un témoin :
[il fit] « une large ouverture au ventre du prince [sic] ; il en retira une grande quantité d’étoupes qui remplaçaient les entrailles, et servaient à soutenir les chairs. Avec le même instrument il ouvrit la bouche. Ce spectacle donna lieu aux bruyantes et insultantes acclamations de la multitude.
Il ne suffisait donc pas d’envoyer le roi ad patres, il s’agissait, pour le charretier (terme devenu synonyme de rustre et de grossier), de descendre dans la fosse même pour l’éventrer et littéralement l’étriper (en ce moment, le symbolisme devient acte), puis de le dé-figurer, la seconde entaille portant sur le visage qu’il s’agit d’outrager. Histoire de vérifier ce qu’il « a dans le ventre », puis de répondre au sourire de défi et de morgue que l’on a cru voir s’afficher encore sur sa face, selon d’autres témoignages. Ce qui est insupportable, c’est cet air de majesté, manifestant une « grandeur » qui provoque respect et considération, en sorte qu’il s’agit de le dé-visager, de lui faire perdre la face. C’est bien l’intégrité du corps royal qui est visée, comme s’il s’agissait de ne pas le laisser entier jusque dans la fosse, de peur qu’il n’emporte ce masque de défi dans l’au-delà…
Rarement on aura vu le bruit et la fureur envahir la scène de l’Histoire !
Après cet acte, plus rien. Saint Denis est vide, les horloges de l’histoire sont arrêtées. Notons au passage que cette catastrophe pour la royauté aura été l’heure de gloire du « patrimoine ». Un acte de barbarie historique apparente aura fondé le mémorial de la Culture. Sachons que sous les dalles de la Culture, il y a un roi exhumé ! Les sentinelles de la mort, c’est par exemple Alexandre Lenoir qui cachait ces débris sacrés dans son jardin privé....
On voit sur cet exemple à nos yeux privilégiés l’impact de réel de l’inconscient sur le drame collectif. Pas besoin de postuler quelque entité de style « Inconscient collectif » qui devient justement une tentation de toutes les variantes d’« histoire des mentalités », alors qu’il s’agit du travail du sujet inconscient en sa confrontation traumatique au réel de l’histoire.