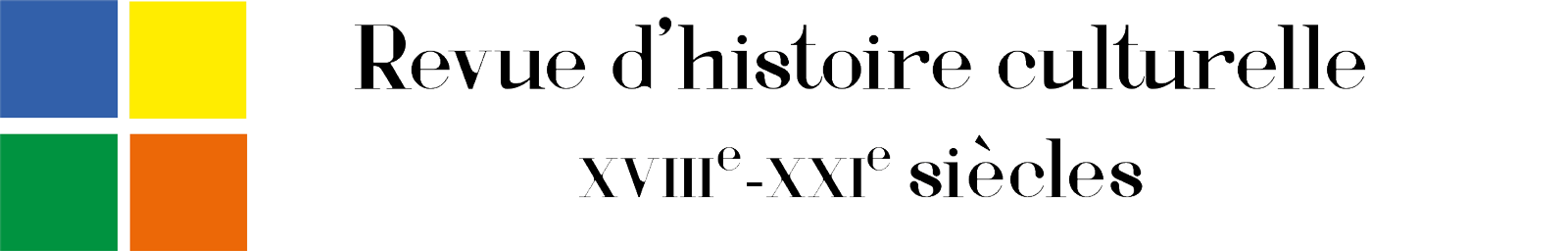Il suffit d’avoir vu une fois dans sa vie L’Homme qui tua Liberty Valance (1962) de John Ford pour en retenir la triple leçon : d’abord, que l’histoire se nourrit de mythes ; ensuite, que ceux-ci sont véhiculés par l’image, c’est-à-dire – depuis plus d’un siècle – le cinéma ; enfin, que les Anglo-Américains sont les meilleurs dans cet exercice. Les 80 ans de la défaite de mai-juin 1940 ont donné matière à vérifier le théorème en s’interrogeant sur la place singulière qu’occupait l’épisode dans la mémoire collective de la France, telle que le cinéma a contribué à la forger et à la diffuser auprès du grand public. La question n’est pas anodine, dans un pays non seulement confronté à une actualité que nourrissent de nombreux conflits, mais que de nombreux films sont de surcroît venus illustrer. Le centenaire de la Grande Guerre a ainsi suscité un pic créatif ponctuel, quand la Seconde Guerre mondiale continuait à focaliser l’attention sur la persécution des Juifs, la résistance ou la libération de la France, et que les guerres de décolonisation, elles-mêmes, inspiraient de nouvelles réalisations1. Mais quid de 1940 ? On ne saurait en dire autant, si bien que la débâcle semble encore aujourd’hui un angle mort de l’expression cinématographique hexagonale. La commémoration des faits a fourni à ce titre un excellent prétexte pour suggérer un questionnement qui, en empruntant le biais du cinéma, venait compléter l’historiographie, les pratiques culturelles, voire le discours institutionnel, afin de poser une question fondamentale : comment représente-t-on une défaite nationale à l’écran ?
Un paradigme : la France de 1940 ne s’est pas battue aux yeux des cinéastes étrangers
La première réponse est assurément la plus simple : ce sont les autres qui s’en chargent. L’exemple n’est pas nouveau, et il suffit de remonter le double fil de l’histoire et du cinéma pour s’en convaincre. Là où Abel Gance s’était essayé en 1960 à porter le roman national à l’écran avec son Austerlitz, c’est bien d’un réalisateur étranger, le Soviétique Sergueï Bondartchouk que vint la réplique logique, son monumental Waterloo sortant en salles dix ans plus tard. De tradition, il est d’ailleurs rare qu’un cinéma ancré dans l’héritage historique et culturel d’une nation, et entendant le restituer, filme ses défaites. À ce titre, La Charge de la brigade légère (1968) de Tony Richardson, qui retrace un épisode désastreux de la guerre de Crimée (1853-1856), constitue pour les Britanniques une glorieuse exception, encore qu’elle évoque un conflit mineur qui a laissé très peu de traces dans la mémoire collective – y compris outre-Manche. La plupart du temps, la défaite ne se conçoit au cinéma qu’à l’instar d’un maillon d’une chaîne dont la longueur permettra d’inverser le cours d’un destin temporairement mal engagé. Chez les Américains, le sacrifice texan d’Alamo (1960) ne doit s’envisager que comme le récit d’une péripétie contraire dans l’édification des États-Unis contre le Mexique de Santa Anna ; de même, le désastre de Pearl Harbor (2001) se clôt-il à l’écran avant même le générique de fin sur l’épisode symbolique du premier bombardement de Tokyo par l’USAAF2, la revanche, si minime soit-elle, intervenant dans la suite narrative directe de la défaite subie et nourrissant par là-même tous les espoirs d’une victoire finale.
Il en va exactement de même pour l’épisode militaire vécu au printemps 1940. Pour les Anglo-Américains, en l’espèce les Britanniques, il s’agit bien d’une défaite, mais ce n’est pas une déroute, car elle précède juste de quelques semaines la bataille d’Angleterre, victoire insulaire par excellence du second conflit mondial, qui a pour conséquence d’éclipser le désastre liminaire enduré sur le continent par la British Expeditionary Force3. Il s’agit donc d’une défaite glorieuse ayant même le goût d’une victoire différée, le « Spirit of Dunkirk » ayant pour fonction de galvaniser les vertus militaires britanniques4 en une scénographie, où les Français ne sont qu’à peine un élément du décor. Ce qui était déjà vrai de l’absence de la résistance française lors du débarquement en Normandie dans Il faut sauver le soldat Ryan5 (1998) de Steven Spielberg, s’est retrouvé de façon plus récente, mais sans véritable surprise, dans le traitement de la défaite de mai-juin 1940 par un film de guerre à grand spectacle, le Dunkerque (2017) de Christopher Nolan. Le propos de cette ambitieuse coproduction américano-britannico-franco-hollandaise était en effet de retracer ce qui est resté dans l’histoire comme l’opération « Dynamo », c’est-à-dire l’évacuation maritime vers l’Angleterre d’un peu plus de 338 000 militaires alliés, piégés par les Allemands dans la cité portuaire, entre le 27 mai et le 4 juin 1940. Sur le plan artistique, l’œuvre a suscité un très fort engouement critique, procédant du consensus, et ce, aussi bien en France qu’à l’étranger. Du point de vue historiographique, les réalités furent en apparence tout autant consensuelles, et cependant infiniment plus complexes, une chroniqueuse du Journal du dimanche n’hésitant pas à ainsi écrire, sans choquer, au sujet de cet « épisode méconnu », qu’il s’agissait là du « sauvetage par la mer de 330 000 soldats britanniques (sic) pris au piège sur la plage de Dunkerque »6. C’est justement là que le bât blesse, dans la mesure où les évacués furent en réalité aux deux tiers britanniques et au tiers français.
Or, comme l’écrit plus justement Alexandre Büyükodabas à propos du même film dans Les Inrockuptibles, et avec sens certain de l’euphémisme : « [L]e traitement éclair réservé aux forces françaises est plutôt chiche7. » On ne saurait mieux dire. Dans la superproduction, la touche française se limite pour l’essentiel à cette barricade aperçue au tout début du film, et derrière laquelle, des fantassins se préparent à combattre et sans doute aussi à mourir pour retarder l’avance allemande. L’œil mauvais, l’un d’entre eux lance au principal héros du film (Fionn Whitehead) un « – Bon voyage !... », en français dans le texte et rempli d’amertume8. Cette brève séquence, de moins d’une minute, sur 106 au total, est la seule à rappeler implicitement que si la Royal Navy et la RAF purent, avec des trésors d’héroïsme bien réels, réussir l’exploit d’assurer les conditions de l’embarquement des militaires évacués, ils le firent aussi grâce au sacrifice de 56 000 autres9 qui, eux, furent tués ou faits prisonniers, après avoir combattu avec acharnement, et qui, presque tous, étaient français. Ce sont ceux-là que l’on ne voit jamais à l’écran et qui sont les grands absents de l’épopée. Dans le magazine Historia, Carl Aderhold synthétise les débats en jugeant avec raison que la réalisation de Nolan constitue un bon avatar de cette « dualité défaite-victoire de la tradition anglo-saxonne (dans laquelle la présence de soldats français est réduite à presque rien10) ». Beaucoup plus sévères, Le Monde et Le Figaro qualifient cet escamotage de « cinglante impolitesse », voire – en reprenant involontairement l’argumentaire de Vichy – de « trahison11 ».
Mais comment en vouloir sérieusement à Christopher Nolan ? Car, au-delà des apparences, l’omission est largement partagée des deux côtés de la Manche, les soldats britanniques n’étant, sauf exceptions12, jamais représentés dans les films français traitant de la défaite de 1940. Il faut aussi rappeler que le cinéaste s’est lui-même inspiré de l’ouvrage de l’historien Joshua Levine, Dunkerque13, autoproclamé « livre officiel » de la bataille et dans lequel la vision de l’épisode historique s’avère si spontanément britannique qu’en deuxième de couverture une carte représente « L’encerclement des Alliés » à l’aide de seulement trois petits Union Jacks… Enfin, son film s’inscrit dans l’héritage de ceux qui l’ont précédé. Plus que le vieux Dunkerque (1958) de Leslie Norman, qui présentait déjà la vision anglaise de la chose, on pense plus volontiers au romantique Reviens-moi (2007) de Joe Wright, dont la postérité fut à n’en point douter davantage assurée par son long plan-séquence de cinq minutes, nécessitant la bagatelle de 2 000 figurants, montrant des soldats britanniques en attente de rembarquement sur la plage de Dunkerque, que par l’évocation des troupes françaises combattant aux portes de la ville. En l’occurrence, ces dernières se résument à la relégation symbolique en arrière-plan d’un officier de cavalerie français en train d’abattre son cheval d’un coup de pistolet – une scène au demeurant peu vraisemblable sur le plan historique. À l’instar du 31e Régiment de Dragon où figure le futur écrivain Claude Simon, les unités de cavalerie françaises sont décimées par l’aviation et l’artillerie allemandes dès les tout premiers jours des combats en mai 1940. Leurs débris combattront héroïquement devant Dunkerque – mais non sur les plages14. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’étonner que les soldats français de 1940 soient dix ans plus tard presque totalement absents du film de Nolan, de même qu’à la fin du film, la flottille d’embarcations de fortune soit exclusivement anglaise, comme en attestent ses pavillons, alors qu’environ 300 des 800 navires utilisés étaient français, belges ou hollandais. Il faut se rendre à l’évidence : vue et filmée de l’autre côté du Channel, la défaite de 1940, en général, et la bataille de Dunkerque, en particulier, se résument à une affaire strictement germano-britannique. L’épisode est héroïque pour les Anglais, mais les Français n’y ont joué aucun rôle.
1940 vue par le cinéma français ? Une affaire plus de civils que de militaires
En France, on connaît depuis longtemps le changement de paradigme historique, lequel a eu un impact direct et conséquent sur la vision cinématographique de l’épisode de mai-juin 1940. En un mot, et contrairement à ce qui se passe pour les Britanniques, la défaite française ne débouche sur aucune revanche militaire car, si la France est vaincue et occupée en 1940, ce sont ses alliés qui la libèreront en 1944. Le plus surprenant réside cependant dans l’étonnante démission mémorielle du cinéma français à l’égard de ces vaincus de l’histoire. Certes, le second conflit mondial a donné lieu en France à de très nombreuses réalisations, mais rares sont celles qui ont pris la débâcle comme sujet principal. De plus, l’effondrement militaire soudain (six semaines de combats) va contribuer à en effacer durablement l’image des soldats, le trauma de 1940 ne relevant plus en soi de la sphère militaire comme il aurait été logique qu’il le fût, mais s’incarnant résolument dans la figure de civils fuyant les bombardements aériens.
La première tendance de fond tient au fait que les représentations des combats militaires de 1940 sont effectivement rarissimes dans le cinéma français. Ce n’est pourtant pas faute d’héroïsme, comme cela a été relevé ailleurs par les acteurs et témoins de l’histoire, ou rappelés depuis lors par les historiens, qu’il s’agisse des grands affrontements de Dunkerque ou de Lille – finalement mieux connus à l’étranger qu’en France même – ou d’épisodes plus ciblés, mais néanmoins signifiants, tels les combats acharnés de Stonne, le sacrifice des défenseurs de l’ouvrage fortifié de La Ferté, la contre-attaque des chars du colonel de Gaulle à Montcornet, le premier bombardement de Berlin par un équipage français, la résistance des « cadets15 » de Saumur en juin 1940, ou encore l’armée des Alpes empêchant l’invasion de la France par l’Italie fasciste. Aucun de ces faits singuliers n’a jamais donné lieu à une quelconque traduction filmique. Ce qui en ressort, c’est que l’ampleur de la défaite militaire, vécue à la mesure d’un véritable effondrement national, a oblitéré de façon durable leur représentation.
Plusieurs raisons historiques successives, différentes et cependant cumulatives permettent de comprendre cette lacune dans la durée même du conflit et dans ses lendemains. La première est technique : la défaite de mai-juin 1940 a été si soudaine, qu’elle n’a pas été en mesure de produire des images de guerre, y compris les actualités hebdomadaires filmées, très vite dépassées par le rythme des événements quotidiens, et donc très pauvres en la matière16. La deuxième raison, ainsi que la troisième, mêlent étroitement considérations techniques et choix politiques. Car le régime de Vichy comme la France de la Libération manquent en premier lieu de moyens pour filmer la défaite de 1940 et, en ce sens, souffrent cruellement de la comparaison avec Hollywood, sans doute, mais plus sûrement encore avec Babelsberg ou Cinecitta. Ainsi, les rares œuvres qui évoquent la défaite, aux cours des quatre années d’existence de l’État français empruntent plus volontiers à la forme classique du mélodrame bourgeois. Le meilleur exemple est encore La Fille du puisatier (1940) de Marcel Pagnol, où l’action épouse la défaite nationale mais ne la met pas en images. Entamé avant la défaite, le long métrage achevé devient ensuite un film sur le deuil de ceux partis à la guerre et qui n’en sont pas (encore) revenus. Donc, ici, point de scènes de combats reconstituées et, comme s’il fallait symboliquement s’élever au-dessus de la tragédie nationale, le héros est un officier aviateur, dont l’uniforme élégant et celui, plus commun, du soldat de troupe joué par Fernandel, se complètent pour symboliser des fonctions sociales familières du public, à l’exacte mesure de ces militaires de vaudeville, croisés chez Feydeau ou Courteline. En un mot : les soldats de 1940 ne combattent pas à l’écran17. Fondamentalement, les partis pris techniques du cinéma de la Libération ne sont pas différents. Hormis les grands moyens mis en œuvre pour représenter de façon très réaliste le déraillement du train allemand dans La Bataille du rail (1946)18 de René Clément, on mesure à nouveau combien les référentiels peinent à s’extraire du théâtre filmé d’avant-guerre, même lorsque Le Bataillon du ciel (1947) d’Alexandre Esway entend montrer – sans vraiment y parvenir – les missions préparatoires menées par les commandos FFL en juin 1944 pour la libération de la France19.
En revanche, la portée idéologique des deux périodes diffère bien entendu, mais a pour point de convergence le rejet de l’hypothétique image de 1940. Au cinéma comme ailleurs, le régime de Vichy procède de la défaite elle-même, comme l’illustre la scène finale de La Fille du puisatier, où la famille française retrouvée écoute avec ferveur l’allocution radiophonique du maréchal Pétain annonçant significativement la fin des combats. Dans un contexte de censure imposée par le vainqueur allemand et les tenants de la Révolution nationale, on devine également toutes les raisons qui, quatre ans durant, ont poussé à l’effacement des représentations guerrières : ampleur du traumatisme national, rejet d’un modèle républicain militairement défaillant et rendu coupable du désastre ou encore incapacité à représenter à l’écran une armée française ayant pratiquement disparu en vertu de l’armistice de 1940 – en dépit de la surreprésentation des généraux et des amiraux dans les cercles du pouvoir vichyste. La référence pétainiste aux prisonniers de guerre a beau être omniprésente dans les discours et les représentations, il n’en demeure pas moins que l’événement qui la fonde demeure irreprésentable – et irreprésenté.
À partir de l’automne 1944, la plupart de ces contraintes s’évanouissent avec le départ de l’occupant, sauf la plus importante : le souvenir de 1940 demeure aussi traumatisant qu’invisible. Dans ces conditions, et en vertu du mythe résistancialiste qui se développe à la même époque, entretenu aussi bien par les gaullistes que par les communistes, il convient de célébrer la figure, non du vaincu de 1940, mais du résistant, car c’est la seule apte à générer un modèle national valorisé accompagnant la refondation républicaine et largement fédérateur auprès du grand public20. Un film franco-américain précoce aura suffi pour se convaincre de la pertinence du présupposé. Tourné à Hollywood en 1943 par Julien Duvivier, L’Imposteur narre l’histoire d’un condamné à mort (Jean Gabin), s’évadant et usurpant l’identité de l’un de ses geôliers à la faveur de la débâcle de 1940, mais qui finira par s’approprier ses vertus. L’échec critique et public du long métrage lors de sa sortie aux États-Unis en 1944, puis en France, deux ans plus tard valide l’évidence : le cinéma de la Libération ne peut trouver ses racines dans le trauma national qui a précédé. L’épisode est donc irrémédiablement voué à l’oubli, au profit de très nombreuses réalisations qui, jusqu’à nos jours, glorifieront la résistance pour elle-même.
Mai-juin 1940 disparaît donc des représentations filmiques de la Seconde Guerre mondiale. Ou plutôt, l’épisode ne parvient pas à intégrer la mémoire collective française par l’image animée. Un quart de siècle durant, a minima, les soldats français de 1940 seront donc purement et simplement absents des écrans, leur seule incarnation tenant aux longues colonnes de prisonniers marchant vers les Stalags du Grand Reich21, et tâchant parfois de s’en échapper. Le combattant français de 1940, et son uniforme caractéristique, ce n’est donc pas celui de la Drôle de guerre et, moins encore, de la défaite, mais celui de la période qui lui fait suite, autrement dit, le soldat captif, et peut-être bientôt évadé. Le film d’évasion symbolise à cet égard la petite revanche individuelle sur le grand désastre collectif du printemps 1940. Apparue au tournant des années 50 et 60, au moment-même où le retour au pouvoir du général de Gaulle s’accompagne d’un nouveau regard sur la défaite et l’Occupation22, cette production dédiée constituera longtemps un sous-genre du cinéma français. Ses réalisations les plus emblématiques seront deux adaptations d’œuvres littéraires, La Vache et le prisonnier (1959) d’Henri Verneuil et Le Caporal épinglé (1962) de Jean Renoir. La première est une réalisation doublement adoubée par la présence de Fernandel au générique et le succès populaire qui en découla23. Quant à Renoir, qui avait en quelque sorte inventé le genre au cinéma avec La Grande Illusion (1937), il en propose une sorte de remake adapté aux temps de Seconde Guerre mondiale. Passé ce moment, le cinéma d’évasion de guerre disparaîtra purement et simplement. Dans ces deux films et quelques autres24, le prisonnier est donc le seul personnage présent à l’écran, dont le calot pointu, les bandes molletières et l’uniforme floqué dans le dos des infâmantes lettres blanches « KG25 », rappellent par l’ellipse le souvenir du désastre de 1940.
Le passage des décennies allait-il alors susciter par réaction un grand retour du refoulé cinématographique ? La production artistique allait-elle compenser les défaillances de l’expression publique, comme on le verrait plus tard avec la guerre d’Algérie ? Il n’en a rien été – ou presque. Premier constat : les films qui sont consacrés au printemps 1940 existent bien, mais sont plutôt rares. Second constat, plus déterminant encore que le précédent : ils l’abordent presque exclusivement sous l’angle civil, et non militaire. Si l’on devait s’attacher à établir une liste de ces réalisations où prédomine ce dernier aspect, on se rendrait aussitôt compte de son caractère très succinct. Le titre qui vient le plus spontanément à l’esprit est celui du film d’un réalisateur précédemment évoqué, Henri Verneuil, Week-end à Zuydcoote (1964). Tiré du roman éponyme de Robert Merle, le long métrage retrace quelques jours de la vie d’un groupe de soldats français dans la poche de Dunkerque et subissant les bombardements continuels de l’aviation allemande. L’action se focalise sur l’un d’entre eux, le sergent Maillat (Jean-Paul Belmondo), qui tente sans succès d’échapper à la léthargie qui s’est emparée de ses compagnons d’armes, afin d’embarquer avec les troupes britanniques, dans l’espoir de poursuivre la lutte. Grâce à des moyens hollywoodiens (nombre de figurants et de véhicules d’époque26, moyens pyrotechniques, etc.), Verneuil a pu entreprendre ce dont nul autre cinéaste hexagonal n’aurait jamais osé rêver : une reconstitution à grand spectacle de la bataille des Flandres et qui, rétrospectivement, apparaît par la même occasion comme l’œuvre patrimoniale du cinéma français sur la défaite de mai-juin 1940.
Il faudrait aussi citer la trilogie de La Septième Compagnie, de Robert Lamoureux, dans l’héritage direct, mais quelque peu affadi de La Grande Vadrouille, et dont les deux premiers volets, Mais où est donc passée la septième compagnie ? (1973) et On a retrouvé la septième compagnie (1975), présentent la particularité de recouvrir exactement la période. Empruntant au comique troupier, ces réalisations s’inscrivent dans leur époque, car elles proposent une relecture dédramatisée de l’histoire tragique de 1940, tout à fait représentative d’une société française post-gaulliste qui s’éloigne peu à peu des représentations héroïques de la guerre27. Les films narrent les aventures picaresques d’un trio de Français moyens sous l’uniforme, le sergent-chef Chaudard (Pierre Mondy) flanqué de deux hommes de troupe, Pithivier (Jean Lefebvre) et Tassin (Aldo Maccione, puis Henri Guybet), présentés comme assez débrouillards pour, d’une part, éviter les combats meurtriers de 1940 et, d’autre part, ne pas être faits prisonniers par des Allemands victorieux, mais benêts. 3,9 puis 3,7 millions de spectateurs valideront cette lecture ludique et simpliste de la déroute nationale28.
En 1979, le ton est tout autre, car Un balcon en forêt de Michel Mitrani ramène les spectateurs sur le terrain du drame historique et délaisse cette fois-ci les grands moyens dont bénéficiait Verneuil pour une adaptation fidèle et intimiste du roman de Julien Gracq. Comme dans le texte d’origine, les combats de la mi-mai 1940 constituent à l’écran l’aboutissement logique des longs mois d’attente qui ont précédé, et par là même la toute dernière partie du long métrage. Commandée par le lieutenant Grange (Humbert Balsan), la maison forte des Hautes-Falizes, aux avant-postes de la forêt ardennaise, voit tour-à-tour l’exode des civils belges, la montée en ligne des unités françaises combattantes, leur repli, puis l’arrivée des Allemands. Cette réalisation est historique car, depuis sa réalisation, soit depuis plus de quarante ans, aucun film français n’a cherché à explorer le versant militaire de la défaite de 1940, même si de rares téléfilms n’y renonçaient pas, à l’image de Trois jours en juin29 (2005), de Philippe Venault, évoquant, sans toutefois les montrer, les combats de retardement sur la Loire. On verra que cette occultation est devenue constitutive de l’appréhension par le grand écran des épisodes militaires de 1940.
Les œuvres cinématographiques françaises les plus récentes n’ont pas renoncé à interroger la défaite de 1940 et ses ressorts. On en retient des œuvres puissantes ou plus anecdotiques, intimistes ou grand public, mais dont l’inaltérable point commun réside dans l’effacement total des combattants. En réalité, toutes s’inscrivent dans le sillage du film fondateur de René Clément, Jeux interdits, sorti en 1952 et qui semble depuis lors avoir fixé la vision nationale de la défaite : celle-ci n’est plus une affaire de militaires vaincus, mais une tragédie dans laquelle les civils sont laissés à eux-mêmes. Jeux interdits rappelle en effet de façon réaliste le grand trauma de mai-juin 1940, qui n’est autre que l’exode30. Huit millions de civils, environ un cinquième de la population française métropolitaine d’alors, errent sur les routes de la moitié nord du pays en espérant échapper à l’envahisseur. La première scène du film correspond à une séquence mémorielle forte, puisqu’elle montre le mitraillage par les avions allemands d’une route encombrée de réfugiés. Parmi les victimes, les parents de la jeune Paulette, cinq ans (Brigitte Fossey – c’est son premier rôle), qui, devenue orpheline, est recueillie par une famille de paysans.
Le sillon tracé par René Clément va s’avérer extrêmement fécond, car tous ceux qui vont prétendre dépeindre la défaite de 1940 vont s’y inscrire résolument. Tour à tour, Jean Gourguet relate la confection d’un radeau improvisé par un petit groupe de fuyards dans La Traversée de la Loire (1962), Pierre Granier-Defferre une romance née de l’évacuation des civils dans Le Train (1973), Jean-Paul Rappeneau le départ à Bordeaux d’une cocotte et de son amant ministre dans Bon voyage (2003), André Téchiné l’errance champêtre d’une jeune veuve et de ses enfants dans Les Égarés (2003), Dominique Cabrera celle d’un groupe d’handicapés mentaux dans Folle embellie (2004), Christian Carion la fuite hypothétique d’un village entraîné par son maire dans En mai, fais ce qu’il te plait (2015). Même lorsque le mouvement s’inverse, la représentation demeure bel et bien celle des civils, en particulier des femmes, dans une lecture érotisée, somme toute très classique, illustrant le remplacement du vaincu invisible de 1940 par son omniprésent vainqueur31. C’est particulièrement le cas de ces jeunes Françaises accueillant bon gré mal gré l’arrivée des Allemands dans le village bourguignon de Suite française (2014) de Saul Dibb32.
Les combats de mai-juin 1940 : une image impossible à représenter sur grand écran
Au-delà de ces exemples, le traumatisme mémoriel de 1940 ouvre sur l’incapacité de créer des images pour le représenter. Et, non sans paradoxe, c’est la télévision qui l’exprime le mieux. En juillet 2017, les téléspectateurs ont pu visionner sur RMC Découverte un documentaire historique de Serges Tignères, « 1940 : le sacrifice de Dunkerque33 ». Dans les séquences qui entrecoupaient les images d’archives et les interviews de spécialistes, se trouvaient des reconstitutions montrant des acteurs en costumes militaires en train de mimer les combats. On n’y a pas pris garde, et pourtant ces scénettes illustratives étaient exceptionnelles, car il n’existe pratiquement aucune image de fiction montrant sur grand écran les soldats français de 1940 faisant usage de leurs armes.
Le cinéma français n’est pas parvenu à produire de telles représentations. Week-end à Zuydcoote, illustre d’ailleurs l’aporie jusqu’à la caricature, car ses héros sont symboliquement désarmés. Maillat traverse tout le film, sans jamais tenir une arme à la main, si ce n’est en une seule occasion. Et, s’il fait feu, ce n’est pas contre les Allemands, mais contre deux déserteurs français sur le point de violer une jeune réfugiée (Catherine Spaak). Moins d’une décennie plus tard, la séquence trouve un étonnant contre-point avec cette scène du Train, dans laquelle un gradé ridicule (Marcel Dallio), en charge de faire sauter un pont de la Loire ne parvient à utiliser son arme de poing que pour se tirer une balle dans le pied. Sans s’attarder outre-mesure sur la lourde symbolique du plan, il se trouve que, dans les deux cas, l’armée française s’avère incapable d’utiliser son armement réglementaire contre un ennemi réel, mais par ailleurs totalement invisible à l’écran34, et pour cela d’autant plus effrayant ou invincible35.
Et le problème, justement, c’est que lorsqu’on les voit pour de bon, les Allemands sont travestis par le cinéma. Dans Week-end à Zuydcoote, Pinot, « le gars d’Bezons » (Georges Géret), abat deux soldats ennemis avec son FM 24/29. Seulement, ce ne sont pas de ces militaires en tenue feldgrau, tels que tous les films traitant de l’Occupation en habitueront les spectateurs. Ils sont en effet déguisés en bonnes sœurs, reprenant au passage l’un des poncifs de la propagande de guerre française de 1940 sur la « cinquième colonne ». Cette invention illustre l’idée plus générale d’une guerre « truquée » par Hitler, ressentie à l’époque, avant que le cinéma français ne l’entérine à son tour. La scène du film de Verneuil n’est d’ailleurs pas la seule du genre, puisqu’on en retrouve une très comparable dans Mais où est passée la septième compagnie ? Lui-aussi doté d’un fusil-mitrailleur, Tassin tue d’une rafale deux Allemands, à ceci près que ces derniers sont affublés d’uniformes de gendarmes français, car ce sont également des espions. Dans cette inversion des codes, est-il alors vraiment surprenant que les héros du film traversent une bonne partie de son déroulement… habillés en Allemands ? Ou comment duper ceux qui ont dupé la guerre.
Lorsqu’on quitte le mythe ou la comédie pour la reconstitution historique, le plus étonnant est que le principe du travestissement se modifie, mais ne cesse pas pour autant. Dans les deux films les plus réalistes consacrés à la défaite de 1940, l’ennemi prend en effet l’apparence, non des fantassins allemands, mais des instruments effrayants de la Blitzkrieg, cette tactique militaire qui a écrasé l’armée française. Week-end à Zuydcoote montre ainsi Pinot, décidément très en verve, être le seul soldat français à ne pas s’en laisser compter lors d’une attaque aérienne, et tandis que tous ses camarades cherchent à fuir ou à se cacher, il reste debout pour viser posément l’avion ennemi qu’il atteint de son tir. Michel Mitrani n’a pas oublié la leçon, si bien que dans Un balcon en forêt, l’ennemi emprunte le même parti pris mécaniste, si ce n’est qu’il prend désormais la forme d’un véhicule de reconnaissance annonçant ces Panzer appelés à rompre le front des Ardennes à Sedan. Mais, pas plus dans un film que dans l’autre, on ne verra l’ennemi sous sa forme connue36, comme s’il était impossible de représenter le soldat allemand réel, en uniforme de la Wehrmacht, face aux militaires français. Cette distance, comme ailleurs le déguisement de l’ennemi, fonctionnent à la manière de procédés d’évitement du réel qui semblent les seuls capables de pouvoir expliquer l’ampleur de la défaite de 1940. De même, les deux derniers procédés filmiques évoqués codifient-ils l’écrasante disproportion des forces en présence : un soldat contre un avion, quatre militaires contre un char invisible, mais qui détruira leur abri et les tuera. Et la conclusion logique qui peut en être tirée s’impose : dans ces conditions, la guerre ne pouvait qu’être perdue. De là à la résignation, il n’y a qu’un pas que le cinéma franchit, car Pinot et Tassin représentent des exceptions par rapport à leurs contemporains : le premier s’oppose aux compagnons d’infortune de Maillat qui n’ont d’autre préoccupation que d’installer dans les dunes dunkerquoises une popote leur permettant de recréer un embryon illusoire de vie civile, alors que la bataille fait rage tout autour ; le second détonne par l’usage de son arme, car ses camarades n’utiliseront jamais la leur. L’un et l’autre, qui incarnent pourtant l’image type du combattant de 1940, font figure d’intrus dans leur environnement immédiat qui n’aspire qu’à retrouver la paix au milieu de la guerre.
Dans les films les plus récents, l’absence du soldat français de 1940 ne dépend plus des moyens engagés pour réaliser un film, voire du désintérêt supposé du public auquel s’adresserait l’œuvre. C’est même tout le contraire, car les financements existent, les effets spéciaux permettent beaucoup et la débâcle intéresse toujours autant. C’est donc que la lacune guerrière de 1940 est entérinée par le cinéma hexagonal lui-même. On la déplorait plus haut chez Christopher Nolan, et cependant un réalisateur français, Christian Carion, l’avait précédé de deux ans dans un registre proche. Sorti en 2015, son film En mai, fais ce qu’il te plait entendait décrire l’exode des habitants d’un village du Nord plongés dans la tourmente des combats de mai 1940. Or, la réalisation offre une double omission cinématographique, qui procède à l’évidence de l’autocensure mémorielle. La première concerne les acteurs : les deux principaux protagonistes, que l’on montre comme étant les seuls à combattre l’invasion nazie les armes à la main, sont respectivement un soldat écossais coupé de ses bases (Matthew Rhys) et Hans, un antifasciste allemand (August Diehl), quand leurs homologues français ne sont que des civils passifs et désarmés, le maire du village (Olivier Gourmet) ou ses proches (Laurent Gerra, Jacques Bonnaffé). Contre l’évidence historique, aucune troupe française ne semble présente dans la région. Non moins intéressante, la seconde omission est quant à elle chronologique : un peu plus tard, le récit met en présence Hans et le commandant d’une batterie d’artillerie se préparant avec ses hommes à un combat d’arrière-garde, et d’autant plus perdu d’avance qu’on ne le verra jamais à l’écran ; inversement, une scène ultérieure montre l’antifasciste parcourant un pré parsemé de cadavres allemands et français. C’est donc que l’on s’y est battu, mais la séquence elle-même n’existe pas, on est constamment dans l’avant ou dans l’après, jamais dans le pendant.
Le même constat s’applique d’ailleurs aux productions britanniques, Dunkerque montrant la barricade française se préparer à l’affrontement imminent (on l’entend même ouvrir le feu), Reviens-moi, une jeune infirmière anglaise (Romola Garai) accompagnant le dernier souffle d’un officier français grièvement blessé à la tête (Jérémy Régnier). Dans tous les cas, et contrairement à tout autre conflit, la bataille de 1940 demeure systématiquement hors-champ37. Ironie du sort, pour un sujet aussi grave, la seule scène connue provient d’un film comique, Mais où est passée la septième compagnie ? quand Français et Allemands se retrouvent par inadvertance face-à-face et que Tassin tue deux ennemis d’une rafale. Or, l’exception valide la règle : les combats de mai-juin 1940 sont l’image impossible du cinéma français38.
En une époque où ces mêmes images fondent les représentations, et par là-même les vérités historiques, il est toujours loisible de s’interroger sur les fondements de ce que le cinéaste Rithy Panh nommait « l’image manquante », à propos du génocide cambodgien39, et que les historiens de la Seconde Guerre mondiale connaissent bien, à propos des façons de représenter la Shoah. En ce sens, peut-être existe-t-il une sorte d’incapacité française à filmer les guerres perdues, comme l’avait illustré en son temps le Dien-Bien Phu (1992) de Pierre Schoendorffer, étrange film reconstituant une bataille sur le mode contemplatif, et sans la moindre scène d’affrontements. Le postulat n’est pourtant pas universel, car des réalisateurs étrangers n’ont pas craint de montrer les revers de leurs pays respectifs à l’écran, qu’il s’agisse donc de Pearl Harbor, mais aussi de Stalingrad et de Berlin, vus du côté allemand ou encore de la défaite finale du Japon40. Par ailleurs, on reprendra volontiers la formule de Baudrillard selon qui les Américains ont perdu la guerre du Vietnam, mais l’ont gagnée au cinéma41. En France, c’est tout le contraire, et un trauma castrateur42 l’a emporté sur la volonté de représentation de la déroute nationale, pour peut-être mieux exorciser les souffrances provoquées par celle-ci. À ce titre, la bataille de mai-juin 1940 a été deux fois perdue par les Français : d’abord sur le champ de bataille, puis sur les écrans43.