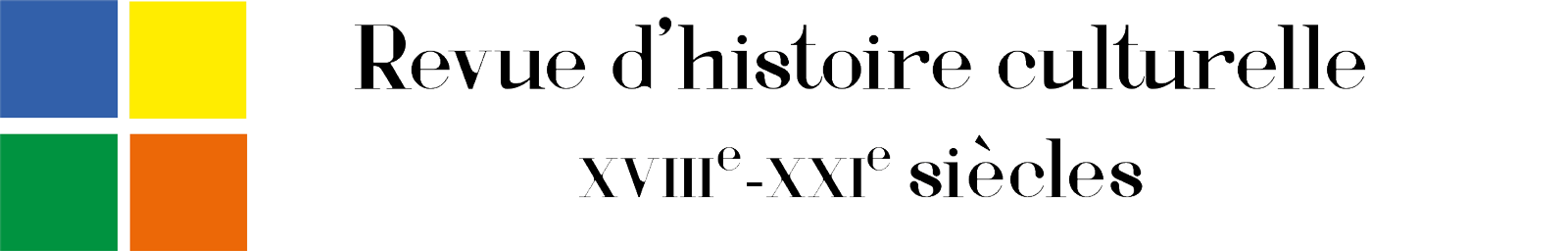Ce livre de Pascal Ory est nécessaire. Présenté comme un hommage à Léon Poliakov « premier grand historien de l’antisémitisme », il apporte, dans un essai qui s’assume comme tel, des éléments historiques documentés aux débats sur les « nouveaux » antisémitismes. Cette réflexion, apportant la dimension du temps long, s’affranchit de bien des aspects qui donnent lieu à des polémiques. Il importait qu’un contemporanéiste fasse le point sur les travaux étudiant les « racines » de la haine dont les Juifs sont victimes et les rapproche des événements récents. La comparaison des antijudaïsmes chrétien et musulman peut ainsi être posée de façon non polémique. Il importait aussi de rappeler avec force que l’étude de l’histoire de l’antijudaïsme n’est pas l’affaire des seules victimes. L’auteur n’hésite pas à se dire goy (p. 13 et 14) et à dire que « cela tombe bien » car « il n’y a pas de question juive » mais une « question antijuive » qui relève bien de l’histoire et non de la philosophie.
Avant de dérouler une chronologie aussi lointaine que possible, Pascal Ory interroge les mots, en particulier celui d’« antisémitisme » formé en 1879 par le théoricien allemand Wilhelm Marr, et se range aux côtés de ceux qui préfèrent utiliser le terme de « judéophobie », apparu en 1882 dans des écrits de Léon Pinsker et utilisé plus récemment dans les travaux de Pierre-André Taguieff.
L’évocation historique d’une histoire de la haine des Juifs n’établit pas a priori de gradation entre un antijudaïsme religieux, qui accepterait les individus passés par la conversion, et un antijudaïsme racial les condamnant définitivement même après leur conversion. Elle s’applique à reconstituer les différents contextes de diaspora (jusqu’aux communautés de Boukhara ou de Samarcande ou aux « Juifs noirs » du Kérala), dans lesquels une identité juive s’est construite et Pascal Ory insiste sur la dimension éminemment politique de cette construction. Une des affirmations centrales de l’essai est que « la religion n’[est] jamais que la symbolisation du politique » (p. 23). Pascal Ory apporte ainsi des éléments peu connus par les non-spécialistes sur les conditions de vie des Hébreux à Babylone. Il bouscule les certitudes en remettant en cause l’idée d’une persistance « identitaire » juive comme une forme de résistance héroïque contre un projet de destruction porté par les empires antiques dominants (sassanide, hellénistique ou romain. Selon Pascal Ory, dans l’Antiquité, la révolte est « l’exception », l’extrémisme d’une émancipation politique un échec, des élites juives coexistent avec les pouvoirs. Mais, dans des récits comme celui d’Esther contre le « méchant » Haman, c’est bien à une construction identitaire que l’on assiste. La répression des révoltes juives est alors politique plus qu’« ethnique » ou religieuse. Une phase d’hellénisation des Juifs culmine à Alexandrie d’Égypte. Une attitude judéophobe nouvelle apparaît dans les discours haineux du prêtre égyptien Manéthon, connus grâce au Contre Apion de Flavius Josèphe, associant les Juifs au danger de la lèpre. Puis, dans l’Empire romain, un autre « intellectuel » égyptien, Apion est cité comme auteur d’un des premiers textes antijuifs. Le pogrom qui eut lieu à Alexandrie en 38 après J.-C. a abouti en 41 à un jugement de l’empereur Claude invitant les non-Juifs à respecter les Juifs. La Paix romaine implique un ordre « tout politique » : il y aurait « une erreur de perspective » à penser qu’il existe dans le monde antique polythéiste « une judéophobie spécifique ». Or cette erreur a été « entretenue par les radicaux des deux camps » : les antijuifs qui veulent donner une image « inassimilable » des Juifs, celui des Juifs qui veulent montrer qu’il n’y a aucun espoir d’être acceptés par un monde non-juif immuablement hostile.
L’opposition de la nouvelle religion chrétienne au judaïsme est analysée de prime abord de façon historique, dans le contexte de l’échec des dernières révoltes juives. Les deux branches monothéistes se différencient et se séparent. Le christianisme se moule dans la société romaine impériale alors que le judaïsme se reconstruit sur l’Exil. Pascal Ory évoque des auteurs chrétiens influents et souvent oubliés, voire rejetés de l’Église : Marcion, Origène, Méliton de Sardes. « La formule du "déicide" s’installe peu à peu dans l’espace judéophobe ». Devenant religion officielle au IVe siècle, le christianisme éradique le polythéisme des vaincus. Après la mort de Julien l’Apostat (363), la logique de coexistence des religions et des cultures disparaît. Le polythéisme ayant quasiment disparu, les Juifs sont les seuls témoins d’un passé et d’un présent minoritaire qui échappe à l’universalité chrétienne. La théologie dénonçant le judaïsme emplit alors une mission politique. La judéophobie devient la norme juridique, avec des variations liées aux différents contextes du monde chrétien.
L’apparition de l’islam au VIIe siècle crée une situation qui modifie la place historique du judaïsme. La religion nouvelle conserve des références communes avec les deux autres « religions du livre ». Les premiers musulmans combattent les tribus arabes qui pratiquent le judaïsme et, avec leur victoire militaire, imposent une forme nouvelle de sujétion. Pascal Ory insiste sur le fait que dans le monde musulman, il ne s’agit pas de tolérance dans le statut des « dhimmis » juifs ou chrétiens. Pour la communauté musulmane (diverses formes de discrimination sont mises en place), le judaïsme est sans doute perçu comme moins dangereux que le christianisme car il ne bénéficie pas de l’appui d’un État extérieur. Des princes musulmans pratiquent des politiques violentes alors qu’avec l’Empire ottoman, le statut des juifs devient « acceptable » au moment où les mesures antijuives de l’Espagne de la Reconquête ont tendance à s’aggraver. La logique de croisade a en effet contribué à un nette détérioration de la situation des Juifs en Europe et dans les zones musulmanes conquises. Les villes de Rhénanie ont été le cadre d’une violence populaire favorisée par le discours clérical, en particulier du bas clergé et des ordres « mendiants ». Les mythes du crime rituel et de la profanation de l’hostie apparaissent, malgré une enquête diligentée par l’empereur Frédéric II Staufen au XIIIe siècle, enquête dont les résultats ont été bien oubliés. Au XVIe siècle, l’Empire ottoman, les territoires pontificaux et le Royaume de Pologne semblent des terres de refuge. En Espagne, apparaît une dimension « biologique » : l’Inquisition se méfie des « conversos » et des marranes au nom de l’idée de « pureté du sang » (limpieza de sangre). L’exception néerlandaise de tolérance naît précisément dans un pays qui échappe à la domination espagnole.
Dans le troisième chapitre sur « la haine athée », Pascal Ory s’intéresse à la façon dont la modernité, des lois d’émancipation à la politique d’extermination, voit coexister une persistance de « la vieille judéophobie monothéiste » et l’invention ou la recréation de nouvelles formes « non moins culturelles » (p. 78) d’expression de la haine. Le terrain de la Réforme protestante est déjà remarquable par son ambiguïté (avec des textes violemment antijuifs de Martin Luther). On retrouve une certaine ambiguïté dans les textes des Lumières. Même pour l’abbé Grégoire, les Juifs peuvent être émancipés mais ils doivent d’abord s’émanciper d’eux-mêmes. La judéophobie change de visage dans les courants remettant en cause le libéralisme à la fin du XIXe siècle. De nouveaux mythes apparaissent depuis les explications complotistes de la Révolution française : associant les Juifs aux francs-maçons ou aux bolcheviks, avec la diffusion du Protocole des sages de Sion, élaboré dans des officines policières tsaristes, texte diffusé par les émigrés russes blancs et repris par des personnalités comme Henry Ford. Le mouvement sioniste a dès sa naissance été associé à la « narration conspirationniste ». L’antijudaïsme n’est pas absent du courant socialiste pour lequel cependant s’engagent de nombreux Juifs. Des socialistes associent systématiquement sémites et ploutocrates. Édouard Drumont fait la synthèse de toutes les judéophobies et séduit une partie non négligeable de la gauche. Mais l’élément nouveau est l’émergence d’une nouvelle forme de pensée à prétention scientifique : le racisme. Pensée qui réintègre la haine du juif dans la classification et la hiérarchie des races. Mais, pour Pascal Ory, il faut se dégager de l’idée que la politique nazie découle mécaniquement des idées racistes qui fleurissent depuis le XIXe siècle. Il ne s’agit pas d’histoire des idées mais d’histoire « de la société politique ». Dans sa description de l’usage différent de la judéophobie par des régimes non démocratiques de l’ensemble de l’Europe (de la Finlande aux Balkans), l’auteur présente le contexte germano-autrichien dont Hitler est issu, en citant Karl Lueger, maire de Vienne, mais pas l’autre Carl, Carl Schönerer que les travaux classiques de Carl Schorske avaient bien mis en évidence dans la présentation de la formation viennoise d’Hitler. L’ouvrage considère le cas italien comme un « alignement progressif du fascisme italien » sur le modèle allemand en matière de politique antijuive, qui « s’explique par la soumission géopolitique de l’Italie » à l’Allemagne. Or Marie-Anne Matard-Bonucci a fait apparaître une autre logique, interne au fascisme italien, de (re)mobilisation totalitaire, touchant par exemple les intellectuels signataires du « Manifeste de la race », tous n’étant pas favorables à un simple alignement sur le nazisme qui s’est engagé dans la logique génocidaire.
Dans le quatrième chapitre sur la « haine mondialisée », Pascal Ory s’intéresse surtout à l’audience que trouvent les reformulations du discours judéophobe. Il y eut d’abord un répit, les « Trente Glorieuses de la judéophilie » rendues possibles par le sentiment de culpabilité du monde après la découverte de la Shoah. Les grandes puissances victorieuses, divisées par les prémisses de la Guerre froide, reconnaissent unanimement la proclamation de l’État d’Israël en 1948 (p. 112).
La violence de la politique judéophobe de Staline (« Nuit des poètes assassinés » (1952), « complot des blouses blanches », 1953…) est alors une exception. Dans un pays comme la France, quelques dérapages verbaux essentiellement de l’extrême-droite, quelques épisodes comme « la rumeur d’Orléans » ne remettent pas en cause le renversement favorable global de l’opinion. L’ouvrage ne mentionne pas tous les dérapages (les « Français innocents » de Raymond Barre à propos des victimes non juives de l’attentat de la rue Copernic en 1980) mais ce que Pascal Ory a appelé « la Révolution de 1975 » est passé par là. Le négationnisme est à l’œuvre. Faurisson bénéficie de soutiens, y compris dans des milieux issus de la gauche. La forte audience acquise par une nouvelle judéophobie minoritaire résulte précisément du fait qu’elle peut se présenter comme une posture contestataire révélant un « anticonformisme » global, remettant en cause le « Système » (p. 125). Mais, peu à peu, la judéophobie quitte cette marginalité et peut réactiver de vieux réflexes (en Hongrie, Georges Soros). En France, le complotisme qui resurgit sur les réseaux sociaux à l’occasion des crises connaît un phénomène que Pascal Ory décrit comme une forme de « cristallisation ». L’antisionisme est devenu la forme contemporaine de l’antijudaïsme dans des contextes différents, occidentaux et orientaux. Il réunit dans une détestation partagée les nationalistes arabes laïques (Constantin Zureik qui a forgé le concept de Naqba, « catastrophe » pour désigner l’exode palestinien de 1948) et les religieux islamistes (renforcés, entre autres, par l’effondrement de l’URSS). L’analyse de Pascal Ory tient compte d’une évolution complexe : « l’antisionisme de gauche, amplifié un peu par le droitissement continu de la politique et de la société israéliennes, mais surtout par l’effondrement mondial du modèle marxiste ». L’antisionisme recouvre l’antijudaïsme comme, dans les périodes précédentes, l’antijudaïsme chrétien pouvait « accueillir » l’antisémitisme racial. Et Pascal Ory conclut son livre dans une réflexion, utile à tous, sur la place de la haine dans l’histoire des sociétés, sur ce que signifie individuellement et collectivement le ressentiment. Une belle page qui invite à interroger l’histoire avec la lucidité de ceux qui n’y cherchent pas de solution aux malheurs du monde, en posant, cependant, l’idée optimiste qu’une « unhappy end n’est pas fatale » et que « la question d’Israël » peut trouver une « réponse non tragique » dans « la reconnaissance réciproque de deux États souverains ».