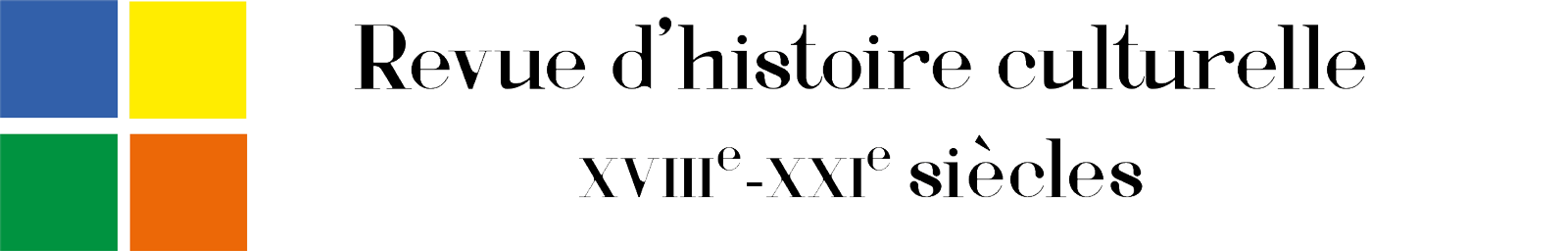1/ — RHC : Comment, dans vos parcours d’historien.ne.s avez-vous rencontré l’histoire matérielle ?
— Clément Fabre : Mon rapport à l’histoire matérielle a d’abord été implicite et plutôt marginal, que ce soit dans mes lectures ou dans mes propres recherches. Dès la classe préparatoire, la découverte de l’histoire des sensibilités d’Alain Corbin, et notamment de ses Cloches de la terre, me faisait tâter déjà l’intérêt d’étendre les réflexions sur les sensibilités et les imaginaires à l’environnement sensible et matériel des sociétés du passé, tandis que le programme « Santé et hygiène en Europe de la fin du XVIIIe siècle aux lendemains du premier conflit mondial », que je préparais pour le concours de l’ENS en 2011-2012, attirait mon attention sur le rôle des objets et des instruments dans l’histoire des sciences et des savoirs. Parmi les enseignements que j’ai ensuite suivis à l’université Paris 1, sans doute est-ce le séminaire « Traces de guerre » qui m’a confronté le plus directement, à travers la question des traces matérielles de la guerre, à cette historiographie, et j’ai commencé alors à m’intéresser, à travers les usages quotidiens du monument aux morts de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, à la question de la matérialité de la mémoire et des pratiques mémorielles.
Je peux, de même, rattacher rétrospectivement mon premier objet de recherche, la langue chinoise dans le Paris du XIXe siècle, à une histoire matérielle de la langue, articulant l’histoire des discours sinologiques et profanes autour de la langue chinoise à celle de sa présence matérielle dans la capitale, mais je n’aurais guère songé à l’époque à qualifier mon approche d’histoire matérielle. C’est véritablement au fil de mes recherches sur les savoirs pratiques des missionnaires, diplomates et médecins anglophones et francophones autour des corps chinois, des années 1830 aux années 1920, que la dimension matérielle – tout à fait absente au début de ma thèse – s’est progressivement renforcée. Je me suis intéressé notamment aux liens entre savoirs sur les corps et les pratiques vestimentaires : l’adoption de vêtements chinois, en particulier par les missionnaires, soulève au XIXe siècle toute une série de questionnements sur les corps chinois, qui tiennent autant à la nécessaire adoption de l’hexis et de l’étiquette chinoises qu’impliquerait ce changement de costume, qu’à l’écart qui distinguerait les corps chinois des corps occidentaux – aussi bien en matière de sensibilité et de morphologie que de résistance au climat. J’étudie également la manière dont, à travers certains objets – les baguettes notamment –, l’environnement matériel chinois impose aux résidents occidentaux en Chine l’incorporation de gestes chinois, et au rôle de cette difficile incorporation dans les réflexions sur l’écart – d’habilité en l’occurrence, et de contrôle sur soi – qui séparerait les corps chinois des corps occidentaux, et donnerait une consistance aux premiers : les corps chinois apparaissent ainsi, dans ces réflexions pratiques, comme des corps ajustés à l’environnement – matériel entre autres – de la Chine.
Ce glissement progressif vers l’histoire matérielle tient sans doute à un certain air du temps : on note en France, depuis quelques années, un véritable engouement pour l’histoire matérielle, aussi bien dans la recherche que dans l’histoire publique – les deux phénomènes étant liés, et se nourrissant l’un l’autre. J’ai d’ailleurs fait moi-même l’expérience de ces effets de résonance entre recherche et histoire publique : mon intérêt pour l’histoire matérielle est en bonne partie porté par mon expérience de rédacteur du magazine « Faire l’Histoire », diffusé depuis 2021 sur Arte. Si je n’avais pas travaillé pendant ma thèse, dans le cadre de cette émission, avec des spécialistes d’histoire matérielle, et ne m’étais pas confronté ainsi à la richesse de ce champ historiographique, j’aurais probablement moins exploré la dimension matérielle de mon sujet.
Patrick Boucheron et Yann Potin ont pensé ce magazine davantage comme une émission d’histoire générale à partir des objets que comme une émission d’histoire matérielle à proprement parler, mais le choix de cette entrée par les objets me paraît malgré tout assez révélateur de l’essor de l’histoire matérielle, laquelle s’est déclinée à tel point dans la quasi-totalité des champs historiographiques qu’il est désormais possible d’aborder à peu près n’importe quelle problématique à partir de son versant matériel. C’est ce que montre bien, aussi, le récent Magasin du monde, dirigé par Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, auquel ont contribué nombre d’auteurs et d’autrices qui, sans être forcément spécialistes d’histoire matérielle, maîtrisent des historiographies où les objets sont désormais suffisamment présents pour pouvoir aborder, à partir d’eux, différents pans de la mondialisation du XVIIIe siècle à nos jours.
L’intérêt, pour l’histoire publique, de cette entrée par les objets ne se limite pas, toutefois, à l’extension progressive du champ de l’histoire matérielle : elle permet également, comme nous essayons de le faire dans « Faire l’Histoire », de donner à voir la diversité des sources qui constituent les corpus historiens, et des méthodes qu’historiennes et historiens adoptent face à ces corpus hétéroclites. C’est, indissociablement une réflexion sur la matérialité des sociétés du passé, et sur la matérialité des pratiques historiennes qui la mettent au jour.
— Pascale Goetschel : Mon intérêt pour les approches matérielles est né de manière très différente. C’est d’abord comme lectrice que je suis entrée dans une histoire des objets plus qu’une histoire matérielle : Georges Perec invitait ses lecteurs à le suivre sur les traces de l’infra-ordinaire dans Les Choses, et on lui emboîtait volontiers le pas dans sa description des intérieurs « modernes » des années 1960. Cependant, j’ai commencé par rencontrer l’histoire matérielle dans le cadre de mes études, à l’université de Nanterre dans les années 1980 : l’accent y était alors mis sur ce que l’on appelait alors la culture matérielle, les objets de la vie quotidienne, avec cette grande attention portée au banal, à l’ordinaire, en particulier en histoire ancienne renouvelée par l’approche archéologique, ou, en histoire moderne grâce aux apports, entre autres, de Daniel Roche (La Culture des apparences. Une histoire du vêtement 17e-18e siècles) ou de Philippe Perrot (Les Dessus et les dessous de la bourgeoisie, une histoire du vêtement au XIXe siècle, 1981). Un peu plus tard, mes lectures se sont plutôt portées sur les travaux de Michel de Certeau, qui avait fait paraître en 1990, grâce à l’édition de Luce Giard, L’Invention du quotidien. L’attention qu’il portait alors aux arts de faire de l’homme ordinaire échappant à la raison technicienne, aux codes et aux normes imposées nous conduisait à regarder la « société de consommation ». J’ai souvent repris ses réflexions autour des ruses, des braconnages, des tactiques dans les premiers cours que je donnais, à la fin des années 2000, d’initiation à l’histoire culturelle du contemporain. Je suis frappée de constater, à la relecture de l’ouvrage co-écrit avec Emmanuelle Loyer L’Histoire culturelle et intellectuelle de la France de la Belle Époque à nos jours, paru en 1994 (le titre a ensuite été modifié), combien nous accordions de l’importance aux conditions matérielles de production, de diffusion et de réception, des phénomènes étudiés...
Plus précisément, c’est par l’histoire du théâtre que j’en suis venue à m’intéresser aux conditions matérielles de la représentation. Alors qu’en thèse, je m’étais intéressée aux politiques publiques, aux répertoires aux mises en scène, aux publics, sans guère croiser la question des matérialités, les années passant, plusieurs objets ont attiré mon attention : le chapeau des femmes qui, porté haut, au théâtre, a fait l’objet de polémiques, en particulier à la fin du XIXe siècle, et dont la dénonciation n’était pas dénuée de misogynie ; le fauteuil de théâtre, à la Comédie-Française, à l’Odéon ou dans les « petites bonbonnières », ces théâtres créés à Paris dans les années 1920, dont l’allure, la couleur ou le matériau en disaient beaucoup sur le désir grandissant de confort d’alors. Lorsqu’avec Jean-Claude Yon, nous avons organisé des journées d’étude relatives à la sortie au théâtre, nous avons accueilli avec le plus grand intérêt les auteurs, tel Manuel Charpy, qui faisaient la part belle aux aspects matériels : avant le spectacle, l’affiche de la pièce, le kiosque mais aussi les interminables queues de spectateurs dans la rue ; pendant le spectacle, le jeu de la mode sur scène et dans la salle ; après le spectacle, la critique de papier, les objets dérivés...
Dans mon compagnonnage avec Christophe Granger, qui s’est traduit par la mise en place de plusieurs séminaires, la question du matériel, au sens de ce qui est et fait matière, s’est à plusieurs reprises immiscée. Dans le cadre de celui consacré au « corps à l’épreuve », c’est le corps faisant matière qui nous intéressait : le corps torturé, flagellé, redressé (pour ma part, j’avais fait porter la recherche sur l’éprouvant travail de conformation du corps de la jeune danseuse du ballet de l’Opéra de Paris dans les premières décennies du XXe siècle, alors soumise, de surcroît, à l’obligation scolaire). Et, quand, plus récemment, nous avons souhaité saisir, en historiens mais dans des échanges transdisciplinaires, avec en particulier des sociologues et des ethnomusicologues, la dimension sonore des sociétés, nous avons invité les contributeurs du séminaire, puis les auteurs d’un numéro dédié aux « sons et cultures sonores » dans la revue Sociétés & Représentations, à réfléchir à l’histoire des « objets sonores », moins entendus dans le sens de Pierre Schaeffer comme des objets d’expériences, définis comme tels par Pierre Schaeffer et expérimentés par lui au Studio d’Essai de la RTF (Traité des objets musicaux. Essais interdisciplinaires, 1966), que comme des moyens d’appréhender les multiples manières dont la matière sonore s’incarne dans des supports, dont elle façonne des conduites, dont elle modifie la perception et les usages du temps (Ludovic Tournès l’a montré dans Du photographe au MP3, XIXe-XXe siècle. Une histoire de la musique enregistrée). Au fond, il s’agit d’une invitation à pratiquer une histoire des corps, des sensibilités et des émotions en lien avec les objets.
Il faut ici rappeler que Christophe [Granger] avait créé une éphémère collection aux Éditions Autrement, intitulée « Leçons de choses » et dont le propos liminaire était éclairant : « Les objets sont le lieu d’une mémoire silencieuse. Compagnons de vie, personnages inanimés des histoires de famille, marqueurs des appartenances sociales, ils portent sans le dire la trace du temps, des goûts et des humeurs dont est fait le tissu de nos existences. À qui veut bien poser sur eux un regard désaccoutumé, ils forment ainsi l’archive vivante de nos musées imaginaires ». La barricade (Éric Hazan), la banderole (Philippe Artières), le chien, histoire d’un objet de compagnie (Victoria Vanneau), le cadeau de Noël (Marlyne Perrot) et un curieux Le vase de Soissons n’existe pas. Et autres vérités cruelles de l’histoire de France (C. Granger et V. Vanneau) la composent.
Enfin, depuis 2017, et avant même que l’histoire des objets ne soit largement investie dans l’espace public, j’ai proposé un cours consacré à l’histoire culturelle des objets, que je co-anime désormais avec Fabien Archambault. Je me permets de reprendre un extrait de la brochure de présentation de L3 qui situe le projet : « les méthodes de l’histoire culturelle sont mises à l’épreuve d’un front pionnier de la recherche. Cette année, sera présentée une histoire des “objets” évoqués à la fois dans leur matérialité, leur ancrage social et leur dimension symbolique. De la “machine parlante” au Cd-Rom et au jeu vidéo, du cadeau de Noël à la robe de mariée, des objets courants de consommation esthétique à ceux alimentant différentes identités sociales, culturelles ou politiques, plusieurs exemples donneront lieu à des analyses d’une histoire culturelle envisagée sous le prisme du triptyque production-médiation-réception ». Tout était dans le programme : la matérialité, le social et le symbolique ; l’objet comme objet d’études et comme mode d’approches. Est-ce pour autant de l’histoire matérielle ? Nous y reviendrons.
— Fabien Archambault : Pour ma part, c’est grâce à un historien de l’antiquité romaine et enseignant exceptionnel, Yvon Thébert, que j’ai été confronté pour la première fois dans mon cursus universitaire à des objets, en l’occurrence des tessons de poterie romaine, dans le cours général d’introduction au monde romain qu’il dispensait en première année à l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud. Je ne sais pas si Thébert aurait défini son approche et son usage de ce type de sources comme relevant de l’histoire matérielle, dans le sens d’un champ spécifique, à distinguer de l’histoire économique ou de l’histoire sociale, à la rigueur plutôt comme une histoire matérialiste ; mais cela tombait sous le sens pour un historien marxiste, qui se revendiquait par conséquent du matérialisme historique, mais d’un marxisme où infrastructures et superstructures étaient indissolublement liées. Car Yvon Thébert ne se contentait pas de nous faire l’histoire de la production de ces céramiques – et de la mise en place du MPE, le mode de production esclavagiste, au IIe siècle avant notre ère –, mais les insérait dans une réflexion plus générale sur les circulations commerciales et économiques bien sûr, mais surtout culturelles et politiques au sein du bassin méditerranéen. Á partir de l’étude d’un fragment de pot de chambre retrouvé dans les latrines d’une villa patricienne fouillée au Portugal – c’était à l’occasion d’un voyage d’étude qu’il nous avait présenté la pièce –, Thébert cherchait à comprendre comment et pourquoi des pratiques corporelles et de soin du corps propres à ce qu’on désigne habituellement comme la civilisation romaine avaient pu se développer dans une région où jamais un légionnaire romain n’avait mis ne serait-ce qu’un orteil. C’était selon lui l’indice de la mise en place d’un modèle à la fois culturel et politique, proposé plus qu’imposé par les élites romaines et adapté, reformulé par les différentes élites locales dans leurs sociétés respectives, aboutissant sur le temps long à la création d’une koiné méditerranéenne.
Pour les apprentis historiens que nous étions, c’était une leçon de méthode : les objets et les vestiges archéologiques plus généralement étaient insérés dans des problématiques générales sur la nature de l’impérialisme romain, sur le fonctionnement des sociétés antiques, toutes choses que Thébert a développées dans un des chapitres du premier tome de l’Histoire de la vie privée, dirigé par Paul Veyne, ou dans sa thèse d’État, publiée après sa mort, sur Les Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen. Ces réflexions s’inscrivaient par ailleurs dans les recherches collectives impulsées en Italie dans les années 1970 autour de l’Institut Gramsci, avec entre autres Filippo Coarelli, Mario Torelli, Guido Carandini (Analisi di classe e società antiche, 1978). Ces derniers, qui s’étaient appropriés les observations du préhistorien australien Vere Gordon Childe sur l’importance fondamentale de la culture matérielle pour parvenir à une connaissance, littéralement, objective, cherchaient en outre à se déprendre des interprétations, héritées du XIXe siècle, d’un impérialisme essentiellement militaire, opposant un centre à des périphéries progressivement soumises, et ce sur tous les plans. Dans les cours de Thébert, cela aboutissait à des conclusions résumées dans des formules défrisantes – « Il n’y a pas eu de conquête romaine » par exemple, ou « Le christianisme n’a jamais existé », mais c’est là un autre sujet, encore que… –, et surtout cela nous faisait découvrir le marxisme italien, un marxisme un peu particulier, marqué par la lecture des Cahiers de prison de Gramsci, où la dimension culturelle avait toute sa légitimité et ne se réduisait pas à des affèteries ou des ornements qui ne feraient qu’illustrer des processus fondamentalement économiques et sociaux. Dans cette perspective, chaque objet, révélé par l’archéologie, devenait le laboratoire d’une histoire totale où toutes les dimensions – économiques, sociales, politiques, culturelles – interagissaient entre elles à chaque moment de la « vie » de ces objets – depuis leur idéation puis leur création, leur production, jusqu’à leur usage, leur circulation, etc.
Par la suite, les recherches que j’ai menées sur l’histoire des rapports entre football et politique dans l’Italie contemporaine se sont fondées principalement sur des sources classiques, manuscrites, agrémentées de photographies, d’extraits de films, d’entretiens, de chansons – en somme, le corpus canonique des vingtièmistes –, sans que je me pose la question de la matérialité ou de l’incarnation dans des objets des phénomènes que j’étudiais. Ce n’est que récemment que je me suis intéressé à cette dimension, un peu par hasard, en raison d’une commande que m’avait passée il y a deux ans Corinne Legoy, pour le numéro thématique de la revue Modes pratiques, qu’elle dirige avec Manuel Charpy, consacré aux « Affections », et pour lequel elle me demandait de réfléchir au(x) maillot(s) de football. Article qui a, quelques mois plus tard, nourri ma participation à un numéro de « Faire de l’histoire », préparé avec Clément Fabre – l’heure est bien aux objets, comme cela vient d’être expliqué. Nous aurons l’occasion d’y revenir, cette histoire des objets ou par les objets ne conduit pas nécessairement à raconter la même chose d’un point de vue – pour moi – inhabituel, mais peut conduire à se poser des questions qui restaient à formuler.
— Manuel Charpy : Pour ma part, et à la différence de ce qui vient d’être décrit, le chemin est inverse : il débute par les objets pour aller au texte. Difficile donc de se dérober à une forme d’ego-histoire s’agissant d’un rapport personnel au monde matériel. Il y a au départ sans doute le fait de grandir dans un monde rural où l’on bricole constamment pour prolonger la vie des objets et des machines d’un côté et de l’autre un monde qui était fait de décharges à ciel ouvert, de carcasses abandonnées de machines agricoles de l’entre-deux-guerres – « Esthétique du machinisme agricole », dit Pierre Bergougnioux –, de baignoires réformées qui servent d’abreuvoirs, de boîtes de conserve clouées qui empêchent que les poteaux fichés dans le sol ne pourrissent par la tête… Dans les campagnes des années 1980 et du début des années 1990, une partie du monde matériel – les supermarchés n’étaient pas encore implantés en montagne – se présentait sous la forme de catalogue de vente par correspondance – et ils avaient leur antidote, découvert tôt : le Catalogue des objets introuvables publié en 1969 par Jacques Carelman, dentiste, peintre et graphiste proche de Queneau et Perec.
La proximité d’un champ de fouilles – une zone occupée pendant le mésolithique et le début du néolithique – a sans doute joué aussi : la patiente identification des objets par le dessin et l’attention permanente et nécessaire aux configurations qui est finalement la seule réelle documentation conduisent à penser ensemble gestes et positions, espaces et objets/artefacts, systèmes techniques et paysages… Le travail d’archéologie préhistorique est aussi un jeu permanent d’interprétation : à l’extrême du positivisme (on mesure, on date, on pèse, on analyse les matières…) et à l’extrême des sciences humaines spéculatives, avec une obligation continue de proposer des récits et des lectures structurales qui donnent sens, le plus souvent à quelques pierres, morceaux d’ocre, de charbon et de terre cuite.
Mais il est sans doute un tournant plus important : une très modeste expérience dans le cinéma – Claude Chabrol, L’Enfer – en tant qu’assistant accessoiriste alors que je m’apprêtais à entrer dans les études supérieures. J’y ai appris par exemple qu’un paquet cadeau selon les scènes doit être vide pour faire du bruit ou au contraire être lourd, qu’un mobilier bien choisi raconte une ascension sociale laborieuse, qu’un peigne impose à un acteur un geste… Monde social et culture matérielle y font corps et les accessoires étaient au centre de la chorégraphie des corps – y compris des technicienn·e·s, de la cadreuse ou du cadreur…
Partant de là, il était tentant en montant à Paris de vouloir épouser la théorie la plus sèche – tout en menant paradoxalement des études d’arts appliqués et en lisant Balzac et Perec. Ce parcours personnel sans beaucoup d’intérêt aboutit à une chose : la difficulté à reconstruire un appareil théorique qui permette de dire cet intérêt pour la culture matérielle et pour en faire à la fois un sujet et un outil d’enquête. Car dans le monde intellectuellement complexé des études techniques domine une forme de platonisme intimidant qui fait de la ville avec ses grandes écoles le territoire de l’abstraction. La lecture d’un Jacques Bouveresse racontant comment il démontait pièce à pièce des tracteurs aide à articuler théorie et pratiques, tout au moins les pratiques des autres. Car Jacques Bouveresse parlait depuis sa rude campagne du Doubs – une figure inversée de l’universitaire Matthew Crawford faisant l’éloge du carburateur : chez Bouveresse, il y avait une sorte de miroir entre la mécanique d’un moteur de tracteur et la réflexion sur la logique du langage à l’aide de Wittgenstein. Les figures intellectuelles sont nombreuses qui aident à ce passage. À titre personnel, l’historien Michel Vernes a joué un rôle central, à la fois dans le fait de prêter attention aux choses et aux espaces mais aussi dans la capacité à ne pas trier, à ne pas hiérarchiser. Il faut dire qu’après un passage en histoire de l’art, la soif à la fois d’une lecture sociale du monde et le désir de matérialité se font tenaces. Du côté du l’histoire des objets, notamment pour les XIXe et XXe siècles, dominaient les « histoires du design », étranges coffee-table books qui égrainaient les « créations » signées par des « grandes figures ». Escamotage consciencieux du quotidien.
Les textes décisifs sont en l’espèce nombreux et comme pour de nombreuses et nombreux historien·ne·s, la lecture de Daniel Roche – La Culture des apparences, Histoire des choses banales… – a été décisive. Ces travaux inscrivaient l’attention aux objets ordinaires dans une historiographie longue de l’économie et du social. Il s’agissait de faire l’archéologie de l’intimité ou l’archéologie de la société de consommation tout en s’arrêtant au seuil de l’âge industriel alors même que ses textes adoptaient une perspective marxiste. Ces travaux saisissaient un monde où via les inventaires il était pertinent de mesurer l’apparition des choses tout en mettant les marchandises en circulation. Or avec le XIXe siècle, ce n’est plus tant la question – en particulier lorsque l’on travaille sur la bourgeoisie. Il convenait de saisir la nature changeante des objets et les usages sociaux qui s’y rattachent plus que de questionner des inventaires.
Un article tout à fait poli mais assassin de Dominique Poulot (1997) m’a convaincu d’assumer un virage vers les usages, non pas tant en négligeant le quantitatif, la consommation et les prix mais en l’articulant aux usages, aux pratiques sociales. Là encore la littérature peinait à dire les usages. Avoir n’est pas utiliser : souvenir du robot-mixer soigneusement conservés dans son emballage chez les paysans encore dans les années 1990, comme dans les quartiers populaires du Maghreb. Dominique Poulot signalait que dans le monde anglo-saxon, l’histoire de la culture matérielle s’attachait à ses dynamiques, aux circulations, aux changements de nature et de statuts. Il a ouvert une fenêtre sur toute une production qui arrivait à peine en France – The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption de Baron Isherwood et Mary Douglas (1979) par exemple rabattait les cartes. Il restait néanmoins une étrangeté : la masse de l’historiographie concernait le monde pré-industriel, comme si l’histoire de l’industrie se substituait pour les XIXe et XXe siècles à la culture matérielle. Sans aucun doute elle semblait – la « société de consommation » – très proche. Les années 1990-2000 avec des mutations profondes dans le quotidien – généralisation de l’électronique, effondrement du prix des vêtements… – ont sans doute joué sur toute une génération qui a voulu questionner à neuf la culture matérielle industrielle. En l’espèce, les travaux des anthropologues étaient les plus avancés. Bien sûr le livre programmatique – d’autant plus fécond en histoire qu’il appelle de ses vœux une enquête quasi impossible – d’Arjun Appadurai bien sûr (traduit en français seulement en 2020) mais aussi les nombreux travaux de l’anthropologue Daniel Miller à la frontière de l’histoire de la consommation et de l’anthropologie des objets. La revue Techniques & culture a joué un rôle important en cela pour diffuser des études de cas, souvent de terrain. Les sociologues et historiens de la consommation comme Frank Trentmann – même s’ils prêtaient peu d’attention à la matérialité des objets – invitaient aussi à penser les cycles de vie des objets, les circuits commerciaux, la marchandise… L’histoire industrielle faisait, elle, peu de cas des objets produits – ou alors dans le cadre d’une histoire promotionnelle des entreprises. Du côté de l’archéologie industrielle, des chercheurs comme Thierry Bonnot avec sa fascinante étude des poubelles d’une usine sur quelques centaines de mètres carrés montraient qu’une archéologie de terrain d’industries modestes pouvait faire sens (La vie des objets).
Sur l’âge industriel, les travaux étaient donc rares. Philippe Perrot (Les Dessus et les dessous de la bourgeoisie) était une des exceptions qui invitait à explorer ce continent. On donnait encore dans les années 1990 à lire aux étudiant·e·s en histoire comme en arts appliqués, Siegfried Giedion (Mechanization takes command) et Jean Fourastié (Machinisme et bien-être). Gilbert Simondon passait en contrebande, par les enseignants de philosophie, parfois par les historien·ne·s de la technique.
Tout un pan théorique venait aussi de la critique de la « société de consommation ». Les Mythologies (1957) de Roland Barthes jouaient un rôle central dans la manière d’articuler objets, esthétique et société. Et là encore Perec avec Les Choses – sous-titré dans la première édition « une histoire des années soixante » (1965) – nourrissait une lecture critique et matérielle du monde industriel. Et du côté de Jean Baudrillard, encore très lu dans les années 1990, son premier ouvrage (1968), Le Système des objets : la consommation des signes, proposait les outils les plus efficaces à mettre en œuvre. Cette littérature marquée par la « société de consommation » avait pour elle d’être rassurante en proposant une lecture politique du monde des objets via la consommation. En un sens, la découverte tardive pour moi, après la Critique de la vie quotidienne d’Henri Lefebvre – mais essentielle comme l’a déjà souligné Pascale Goetschel – de L’Invention du quotidien Michel De Certeau et cet étrange ouvrage en deux volumes avec Luce Giard (1. : Arts de faire et 2. : Habiter, cuisiner), à la fois puissante réflexion historiographique et étude de terrain sur les « arts de faire » et les braconnages.
Dans un sens, plusieurs historiennes répondaient à ce programme : la lecture du tome 4 de l’Histoire de la vie privée, dirigé par Michelle Perrot, fausse synthèse tant elle amorce quantité de chantiers, a fait du quotidien un espace d’enquête, le lieu – foucaldien – des relations de pouvoirs, qu’ils soient sociaux, économiques ou sexuels. Dans ce sillage, et étrangement, un livre comme celui de Dominique Veillon (La Mode sous l’Occupation) introduisait une donnée centrale : on pouvait lire la culture matérielle comme un soubassement braudélien installé dans la longue durée mais aussi dans un temps plus court, en l’occurrence de crise. Les arrangements – à tous les sens du terme – des Parisiennes et des Parisiens avec la mode en temps de pénurie éclairent à la fois l’histoire d’une période, d’une culture matérielle et du quotidien.
2/ — RHC : Comment décrire aujourd’hui le paysage de l’histoire matérielle et ses dynamiques en histoire ?
— Clément Fabre : Au-delà des disciplines travaillant par définition sur les objets et les questions matérielles – archéologie et histoire de l’art notamment –, l’histoire matérielle, telle qu’elle s’est développée à partir surtout des années 1970, s’est focalisée d’abord sur deux objets d’études, eux-mêmes étroitement liés entre eux : l’histoire de la consommation et l’histoire des vies ordinaires. À mesure qu’historiennes et historiens s’attachaient davantage à restituer la vie des gens ordinaires, qui souvent avaient laissé derrière eux peu d’écrits, la nécessité de trouver d’autres sources pour documenter leur expérience a attiré l’attention sur la consommation de biens matériels, notamment à partir de la révolution de la consommation que connaît l’Europe à l’époque moderne. Le titre et le sous-titre du célèbre ouvrage de Daniel Roche, Histoire des choses banales : naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles (XVIIe-XIXe siècles), disent bien ce double décalage vers l’ordinaire et vers la consommation. Et c’était déjà pour étudier les masses que Fernand Braudel s’était intéressé, à la fin des années 1960, au temps long de la civilisation matérielle. C’est autour de ces deux premiers objets que s’est développée ce que l’on appelle l’histoire des cultures matérielles, soit l’histoire des rapports entre les hommes et les femmes du passé et leur environnement matériel, et du sens dont ils investissaient cet environnement. La naissance de la consommation a ainsi été étudiée comme l’essor d’un nouveau rapport, affectif autant qu’économique, aux choses, et cette étude de la culture par sa matérialité rejoignait opportunément deux évolutions contemporaines des études culturelles : intérêt pour la « culture du pauvre » – pour reprendre le titre français de l’ouvrage classique de Richard Hoggart – et pour les pratiques culturelles concrètes – dont témoignent aussi bien les travaux de Michel de Certeau que l’histoire des pratiques de lecture.
En se focalisant ainsi sur l’histoire des consommations ordinaires, les spécialistes de l’époque moderne ont par ailleurs rapidement pris la mesure de la pénétration, jusqu’au creux du moindre foyer, d’objets venus du monde entier, portés par l’essor de circulations à l’échelle du monde : on pense bien sûr au Chapeau de Vermeer de Timothy Brook, sur la Delft du XVIIe siècle et ses connexions globales, mais les travaux dans cette veine sont légion, qui n’ont cessé d’étendre, spatialement et chronologiquement, l’histoire matérielle de ces circulations transnationales – songeons seulement au Rhinocéros d’or de François-Xavier Fauvelle, ou aux travaux d’Anne Gerritsen sur la circulation globale des porcelaines de Jingdezhen.
Ces trois problématiques – histoires de la consommation, des vies ordinaires et des circulations globales – demeurent au cœur de nombreux travaux récents, mais l’histoire matérielle s’est également déclinée aujourd’hui dans la quasi-totalité des champs historiographiques. On sait désormais ce que l’histoire du politique doit à la matérialité des techniques de vote et de tirage au sort, et l’histoire du pouvoir à ses insignes autant qu’à l’accumulation des trésors médiévaux ; l’histoire religieuse s’est enrichie du parcours des reliques et du commerce des objets de dévotion, et l’histoire de la mémoire de la matérialité des souvenirs ; l’histoire du genre a intégré les objets à son questionnaire et s’est ouverte aux apports de l’archéologie du genre ; l’histoire du corps, à mesure qu’elle s’éloigne d’une histoire des seules représentations des corps, trouve dans l’environnement matériel au contact duquel ils évoluent un moyen de s’ancrer dans les pratiques ; et une riche historiographie, synthétisée dans le récent Voir les savoirs de Jean-François Bert et Jérôme Lamy, a suffisamment montré combien la matérialité des pratiques savantes, y compris du travail intellectuel a priori le plus désincarné, est indispensable pour en écrire l’histoire : on ne saurait plus comprendre l’œuvre de Marcel Mauss ou de Michel Foucault sans étudier leur bibliothèque, et Françoise Waquet a montré combien la fiche avait joué un rôle déterminant dans le travail des historiens, depuis l’école méthodiste de la fin du XIXe siècle.
Si je choisis ces quelques exemples parmi mille autres, c’est que je pense que l’une des promesses auxquelles l’histoire matérielle doit aujourd’hui une partie de son succès est justement d’approcher de manière plus concrète et incarnée des objets d’histoire qui avaient longtemps été étudiés de manière plus abstraite et éthérée. Il ne s’agit donc plus uniquement de saisir, par les objets, une histoire différente – celle d’hommes et de femmes négligés par les travaux historiques, ou de circulations insoupçonnées –, mais d’aborder différemment des histoires déjà bien connues, de les enrichir et de les éclairer d’un jour nouveau. C’est pourquoi, dans leur ouvrage cité plus haut, Jean-François Bert et Jérôme Lamy rapprochent le material turn du spatial turn et du practical turn : il s’agit dans ces trois cas, en restituant l’importance des lieux où se déroulent les activités savantes, des gestes et des pratiques qu’ils mobilisent, et des objets qu’ils mettent en jeu, de complexifier la vision d’un travail purement intellectuel, de mettre en lumière les collaborations – avec les artisans, par exemple, qui confectionnent les instruments scientifiques – sans lesquelles on ne saurait comprendre le travail savant, et l’environnement qui le permet autant qu’il le contraint.
C’est là un deuxième point sur lequel, à mon sens, l’histoire matérielle rejoint d’autres problématiques centrales dans les renouvellements récents de la recherche historienne. Depuis notamment les travaux de Bruno Latour – dont La Vie de laboratoire est contemporaine d’ailleurs des travaux sur les consommations matérielles mentionnés plus haut –, la nécessité de considérer les objets comme participant à l’action au même titre que les acteurs, si elle reste débattue parmi les spécialistes d’histoire matérielle, attire néanmoins l’attention sur l’agency de l’environnement matériel, et sur la futilité de concevoir les activités humaines hors sol, indépendamment de cet environnement. En ce sens, l’histoire matérielle rejoint les préoccupations de l’histoire environnementale comme de l’histoire des animaux, qui l’une comme l’autre s’efforcent d’étendre le champ des acteurs et des facteurs déterminants pris en compte dans les réflexions historiennes.
Enfin, l’histoire matérielle est, depuis ses origines, indissociable d’une histoire de l’intime qui connaît aujourd’hui d’importants renouvellements dans l’historiographie française. Non seulement l’histoire matérielle permet de saisir des vies qui n’ont pas pu être mises par écrit, mais elle ouvre également une porte sur des pans de vie que nul n’aurait songé à écrire : la lecture d’un inventaire après décès – l’une des sources privilégiées de l’histoire matérielle – tient presque du voyeurisme, et donne en tout cas l’illusion d’être au plus près de l’intimité de ces vies saisies dans le détail et le désordre des objets recensés au fil des pièces, des armoires et des poches inventoriées. Ce n’est pas un hasard si l’ouvrage dirigé en 1988 par Annick Pardailhé-Galabrun sur les inventaires après décès des foyers parisiens au XVIIe-XVIIIe siècle était intitulé Naissance de l’intime, et le récent Tous ceux qui tombent de Jérémie Foa dit bien la puissance évocatrice intacte que conservent ces documents. Cette entrée matérielle sur l’intime est d’autant plus fructueuse que l’attachement aux choses documente des pans de la vie subjective qui échappent bien souvent à l’écrit. C’est vrai tout particulièrement des objets portés dans les poches, à même le corps – que ce soit par souci de sécurité, par croyance ou par attachement – et que l’on connaît notamment par l’inventaire des objets retrouvés sur les cadavres. Françoise Bayard s’était intéressée déjà, en 1990, aux objets retrouvés, au XVIIe-XVIIIe siècle, dans les poches des cadavres de Lyon, du Lyonnais et du Beaujolais, et Ariane Fenneteaux prolonge cette étude dans son récent ouvrage The Pocket, reconstituant par exemple à partir du contenu de ses poches multiples le quotidien et les derniers jours de Catherine Eddowes, l’une des victimes de Jack l’Éventreur, assassinée en 1888 dans l’Est londonien, et dont seules les poches permettent de connaître autre chose que sa fin tragique.
— Pascale Goetschel : Je commencerais par proposer ma définition de l’histoire matérielle : une histoire sociale, politique, économique, sensible, symbolique de ce qui se manifeste dans ou par de la matière. En ce sens, le « matériel » est héritier de filiations multiples, définit des identités propres, obéit à des usages changeants, donne lieu à circulations variées. Cette histoire n’est pas seulement une histoire de la culture matérielle, des techniques ou des objets. Elle est aussi celle de son intellection et des systèmes de significations dans lesquels elle s’insère. Forte de cette définition qui ne demande qu’à être discutée, je relève des filiations identiques et différentes à celles évoquées par Clément Fabre.
Cette histoire matérielle me semble être d’abord héritière de toute une histoire des techniques attentive aux gestes, pour faire vite de Leroi-Gourhan (L’Homme et la matière), en passant sur l’attention portée aux circulations internationales (Yves Cohen et Dominique Pestre (dir.), « Histoire des techniques », Annales, Histoire, Sciences Sociales, vol. 53, n° 4-5, 1998), jusqu’aux travaux liant technologie et industrialisation (Kristine Bruland, Anne Gerritsen, Pat Hudson, Giorgio Riello (dir.), Re-inventing the Economic History of Industrialisation, McGill-Queens University Press, 2020) et aux recherches publiées dans Artefact. Techniques, histoire et sciences humaines ( https://journals.openedition.org/artefact/). À ce titre, le parcours de Liliane Hilaire-Perez, élève de Daniel Roche, me semble édifiant. Elle a d’emblée proposé une approche sociale et politique des inventeurs en s’interrogeant en particulier sur les institutions dans lesquelles ils œuvraient. Ses travaux mettent l’accent sur les savoir-faire, leur transmission ou leur persistance (La Pièce et le geste : artisans, marchand et savoir technique à Londres au XVIIIe siècle, 2013). Dans une perspective comparatiste et croisée, elle traque les processus de fabrication des objets en mettant l’accent sur l’organisation de la production, et en particulier la manière dont sont mobilisées les ressources humaines du processus initial de transformation à la commercialisation. Préférant les études dédiées à des objets précis, au ras-du-sol, elle les aborde en mobilisant l’histoire des savoirs et des savoir-faire, l’histoire des normes et des règles, l’histoire des usages et des pratiques. Aussi accorde-t-elle toute son importance aux “circulations longues”, à la fois dans le temps et dans l’espace tout en cherchant à saisir les accidents de l’histoire. Enfin, ses recherches se définissent par une forte dimension réflexive inspirée des réflexions d’Hélène Vérin qui propose une histoire intellectuelle des techniques (histoire des pratiques d’invention prises dans un “espace de la technique” conçu comme un corps distinct de savoirs et non une simple science appliquée). À sa suite, l’importance que Liliane Hilaire-Perez accorde aux systèmes d’intellection est cruciale et, tout en ne travaillant pas sur l’histoire des techniques je m’en sens l’héritière. Il faut rappeler d’ailleurs combien Pascal Ory, définissant l’histoire culturelle, accordait une place décisive au “facteur technique” (L’Histoire culturelle, 1992).
— Fabien Archambault : Pour rebondir sur ce qui vient d’être dit, la prise en compte du « facteur technique » me semble en effet un des éléments qui contribuent à enrichir la palette de l’historien du culturel tout en élargissant le champ de ses questionnements. En ce qui concerne le maillot de football, par exemple, lorsque je me suis interrogé sur la matière dont sont faits ces maillots, il m’a fallu établir la chronologie et les étapes du passage de la chemise en coton jersey, celle des Britanniques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, aux maillots en fibre synthétique dominant aujourd’hui. Et le tournant intervient non pas en Grande-Bretagne mais en Champagne, où, dans les années 1920, les industriels du textile de Troyes mettent au point la technique de confection dite du « petit piqué », consistant à tisser un maillot avec non plus un mais deux fils de jersey, ce qui permet de fabriquer une pièce plus résistante, plus aérée, qui tient mieux les couleurs – et qui entraîne et autorise la diversification de la gamme chromatique. C’est cette technique qui est adoptée par René Lacoste pour ses « chemises » L1212, destinées à la pratique du tennis, alors encore réservée à une élite, mais surtout par l’entreprise qui prendra après-guerre le nom de Le Coq sportif et qui s’impose en France sur le marché du maillot de foot, alors en plein essor. On rejoint là une problématique classique de l’histoire des sciences, celle des liens entre l’innovation scientifique et la société qui tout à la fois s’en empare et la suscite : la démocratisation et la première massification de la pratique du football – la seconde intervenant dans les années 1960 avec les fibres synthétiques – a à la fois été rendue possible par la mise au point du « petit piqué », qui en outre est mécanisé chez Le Coq Sportif alors qu’il reste manuel chez Lacoste tout autant qu’elle a créé le besoin et la nécessité de disposer d’un produit mieux adapté à une nouvelle pratique sportive, en voie de massification, et, par conséquent, à un moindre coût de production et de commercialisation. Pour l’historien, la difficulté de faire une telle histoire tient à la découverte et la maîtrise, forcément imparfaite, de données techniques – relevant ici de l’industrie textile – alors que les travaux spécialisés manquent ou commencent seulement à être mis en œuvre. Dans sa notice sur le ballon de football, dans le Magasin du monde, Julien Sorez nous indique ainsi la voie à explorer : la dimension matérielle de cet objet essentiel au jeu, qui d’une certaine manière est le jeu même, reste encore à écrire.
— Pascale Goetschel : Une deuxième orientation me semble devoir être mentionnée, celle qui interroge la matérialité des objets du point de vue esthétique. Des historiens de l’art traquent ainsi les objets au cœur même des œuvres qu’ils étudient et analysent les représentations qu’ils véhiculent. Tel est le cas de la « nature morte », ce concept né au XVIIe siècle mais utilisé depuis des temps antédiluviens, dont s’est emparée Laurence Bertrand-Dorléac (Pour en finir avec la nature morte, 2020). Il s’agit ici non d’une histoire des objets mais d’une histoire de leurs représentations et de leurs significations (signes du divin, images de l’humble, fétiches du fétiche, le « rien du tout ».). Cette réflexion personnelle, qui se prolonge dans le cadre d’un séminaire (https://www.sciencespo.fr/artsetsocietes/fr./) et d’une exposition (Les choses. Une histoire de la nature morte depuis la préhistoire (12 octobre 2022-23 janvier 2023), envisage leur biographie au cœur même des œuvres. Ces travaux entrent en écho avec d’autres qui traquent les expositions d’objets au sein des institutions patrimoniales ou, de manière neuve, dans la chose littéraire (Philippe Hamon, Rencontres sur tables et choses qui traînent. De la nature morte en littérature, 2019 ; Marta Caraion, Comment la littérature pense les objets. Théorie littéraire de la culture matérielle, 2020). Le point commun entre ces approches, qui permet de les distinguer d’une seule histoire des objets, est la question de ce que leur usage fait à l’art, en général, et à la littérature, en particulier. Pour Philippe Hamon, la « nature morte » littéraire constitue ni plus ni moins qu’un « genre » (avec ses institutions, sa « tradition », sa « grammaire », ses remises en cause et des effets d’attente) et, au-delà, se présente comme un véritable « manifeste incorporé » au sein des œuvres. Marta Caraion invite, quant à elle, à une « lecture matérialiste des objets en littérature » – on revient à une filiation évoquée plus haut par Fabien Archambault. Pour elle, les objets romanesques, loin de refléter uniquement les mutations sociales du XIXe siècle, contribuent à ancrer le réalisme littéraire, dans un jeu où la description des objets, telle celle de la locomotive Lison dans La Bête humaine de Zola, entre en concurrence, ou en complémentarité, avec les panoramas des personnages. Saturés de signifiants, ces mêmes objets deviennent dans la littérature du Nouveau Roman des marques de la plus grande insignifiance. En définitive, ces propositions permettent de penser la culture matérielle ou, plus exactement, de réfléchir à ce que le matériel fait aux œuvres qui les contiennent. La littérature précède-t-elle les sciences sociales ? Peut-être, en tout état de cause –, et ce sera la troisième orientation –, les approches structuralistes qui entendent démonter le « système des objets », synecdoques de la « société du spectacle », cette société de consommation spectacularisée honnie par Guy Debord, me paraissent devoir être prises en compte. Là, ces objets forment tous ensemble un système où prime le fonctionnel. Ces approches ne sont pas exclusives de la démarche entreprise par Arjun Appadurai et d’autres qui insistaient sur la vie sociale des objets (The Social Life of Things, Commodities in Cultural Perspective, 1986). L’on y retrouve le souci d’établir une biographie des objets, de repérer les lieux où ils ont émergé, de traquer les circulations auxquelles ils donnent lieu, de penser leurs métissages et l’évolution de leurs significations symboliques, précisément en dehors de leur contexte initial de fabrication. À ce titre, l’ensemble des domaines de la vie sociale est concerné, y compris dans une dimension politique. Prenons l’exemple de l’ouvrage de Yulia Karpova, Comradely Objects: Design and Material Culture in Soviet Russia, 1960s-1980s (2020). Soucieuse de proposer une histoire du « socialisme tardif » en Union soviétique par le biais d’objets de la vie quotidienne et des intérieurs domestiques tout comme par celui des institutions en charge de les produire, elle distingue un « tournant esthétique » sous l’ère Khrouchtchev et un « tournant antifonctionnaliste » à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Le cas des « céramiques-images » illustre, à propos, la désintégration de l’objet socialiste dans les années précédant la Perestroïka : ces théières soufflées à la main et assemblées en sculpture (Tea Couple, 1966) incarnent une créativité encouragée mais aussi limitée par les institutions étatiques, représentatives d’une forme expressive d’art décoratif sans but fonctionnel. On est loin ici des stéréotypes réduisant les objets soviétiques à des choses de piètre qualité, qui témoigneraient du faible intérêt porté à la consommation. Au contraire, ces évolutions du design, héritier des avant-gardes des années 1920, suggèrent un ordre symbolique particulier, entre fonctionnalisme imposé et créativité grandissante, entre injonctions pratiques et goût de la liberté.
— Manuel Charpy : Comme cela a été souligné, l’approche en termes de culture matérielle crée parfois de nouveaux objets d’histoire mais surtout bouscule des champs existants, permet de reprendre des questions.
C’est par exemple le cas pour une histoire des cultures populaires – et là encore Michel de Certeau n’est jamais loin. Cette histoire connaît un renouveau pour les périodes contemporaines par l’histoire de la culture matérielle, ce qui n’est pas surprenant tant à l’origine c’est une forme d’approche pensée par l’ethnographie comme le moyen de documenter les « peuples sans écrit ». L’histoire du vêtement (Vivienne Richmond, Clothing the Poor in Nineteenth-Century England), l’histoire des intérieurs (avec par exemple le livre d’Anaïs Albert, La Vie à crédit. La consommation des classes populaires à Paris (années 1880-1920), l’histoire des luttes politiques et syndicales évoquées par Fabien Archambault (MATOS)… C’est aussi un des accès à des cultures marginales et/ou marginalisées, à ce qu’il est convenu d’appeler des subcultures – la réédition de la formidable enquête de Jean Monod (Les Barjots) sur les blousons noirs ou encore le texte de Justin Gandoulou sur les Sapeurs (De Paris à Bacongo) ont ouvert la voie à des travaux sur des groupes marginaux par leurs objets et vêtements. Nombre d’étudiant·e·s et d’enquêtes abordent aujourd’hui ces sujets en s’intéressant aussi bien aux Zooters (Luis Alvarez) qu’aux Vogueurs, aux travestis, aux émigrés… Autrement dit des groupes pour qui la question matérielle est un investissement et une manière d’exister. Il s’agit bien alors de comprendre les bricolages culturels, leur sens social et leur historicité.
Paradoxalement, la nécessité pour les historien·ne·s d’aller chercher des textes d’ethnologie et d’anthropologie a conduit nombre d’entre eux à se saisir aussi de pratiques populaires du présent. En ce sens, Techniques & culture ou Modes pratiques que nous animons avec Corinne Legoy et Patrice Verdière, sont des lieux où les historien·ne·s mettent à l’épreuve du présent des techniques d’enquête et bien souvent sur des terrains où le texte fait à priori défaut. Je pense par exemple à des médiévistes comme Gil Bartholeyns ou Pierre-Olivier Dittmar ou à un spécialiste de la Renaissance comme Thomas Golsenne : ils se risquent volontiers dans des enquêtes sur le présent avec l’outillage de l’histoire de la culture matérielle. Il ne s’agit pas simplement d’interdisciplinarité mais de mises à l’épreuve : à Senarpont (Somme) par exemple nous avons cherché à documenter et comprendre des arbres à loques, soit des vêtements ordinaires noués aux arbres à des fins curatives ou propitiatoires.
L’étude des apparences – vieille affaire au moins depuis Daniel Roche – connait une vraie vitalité : la notion de culture matérielle invite à quitter le monde de la haute-couture pour le vêtement du quotidien, ordinaire comme extraordinaire. Interface entre le corps et la société, il devient réellement un objet d’histoire sociale totale pour paraphraser Roland Barthes. Avec la création de Modes pratiques, nous avons réuni des auteur·e·s qui écrivaient déjà sur le sujet mais aussi avec l’idée de faire écrire sur le sujet, d’expérimenter cette approche. La culture matérielle dans le domaine permet de penser production – industrie textile, de la confection …– et consommation – des magasins jusqu’aux manières de porter les vêtements ou de les réparer. Autrement dit, il s’agit souvent de réarticuler des travaux déjà amorcés en plaçant au centre usages et pratiques sociales.
Le domaine des images, comme l’a noté Pascale Goetschel, a été lui aussi revisité sous un angle matériel. La matérialité oblige à penser des chaînes de production et de consommation, des acteurs, de situations d’exposition… Les restitutions qui secouent le monde des musées aujourd’hui y ajoutent. Une historienne comme Noémie Étienne cherche ainsi à documenter la production matérielle et esthétique des dioramas indiens aux États-Unis ou à comprendre comment les restauratrices et restaurateurs se débrouillent des objets africains et amérindiens dans les musées européens. L’histoire matérielle a conduit à penser les images par l’anthropologie : quels sont les gestes, les pratiques, les lieux, les temporalités qui leur sont attachés ? Un portrait n’est pas le même s’il est accroché sous un verre dans un salon ou s’il est enfermé dans un écrin de velours et glissé dans une poche.
L’histoire des techniques, comme l’a déjà souligné Pascale Goetschel, est à la fois à l’origine de la notion de culture matérielle mais a en retour bousculé les grands récits de la discipline. En s’intéressant à la mise en œuvre des techniques dans le quotidien des situations précises, l’histoire des techniques ne cherche plus un grand récit mais à comprendre comment les techniques cohabitent, comment elles sont appropriées, parfois refusées… On peut dire que l’arrivée du tirage photographique ouvre une nouvelle ère du portrait, et c’est vrai. On peut aussi dire que dans le même temps, une partie de la bourgeoisie continue à préférer le daguerréotype et que de nombreuses familles aristocratiques refusent de se faire photographier. Par l’histoire de la culture matérielle, il s’agit plus de savoir comment les techniques modifient la trame du quotidien et comment en retour le quotidien change les techniques. Les travaux de David Edgerton (Quoi de neuf ?) mais aussi de François Jarrige font en cela référence, en pensant les « techniques créoles », les résistances et les cohabitations de techniques.
Enfin un mouvement coiffe en quelque sorte les autres champs : une approche globale, connectée. Paradoxalement, cette histoire qui s’est occupée des langues communes et des mesures communes s’est tôt occupée de la circulation des objets. Les historien·ne·s de l’époque moderne – notait tôt la mondialisation des objets plus rapide que celles des hommes – et les recherches de François-Xavier Fauvelle notamment rappellent que dès l’époque médiévale des objets circulent à très grande échelle. Les travaux sur la période moderne sont nombreux, de Timothy Brook déjà évoqué à Giorgio Riello (sur les tissus de coton indiens) par exemple, évoquant à la fois les chemins des marchandises et des hommes – aventuriers, migrants ou esclaves. Sur la période contemporaine, les travaux sur le mouvement Swadeshi (C. A. Bayley) ou sur les appropriations des produits occidentaux à Shanghaï (Frank Dikotter) montrent à quel point suivre des objets de près permet à la fois de reconstruire les linéaments de la mondialisation et les appropriations locales. Dans la perspective de l’histoire coloniale, l’étude de la culture matérielle tente aussi de saisir localement les effets d’une mondialisation marchande. Dans le Congo colonisé des années 1890, arrivent des costumes de tweed et des casques aérifères puis dans les années 1920 des chaussures et des singlets japonais. Mais ce qui fait sens ce sont les usages : et quand des boys élégants inquiètent l’administration vers 1900 puis quand des militants meurent dans les années 1930 parce qu’ils sont trop bien habillés, on devine qu’il ne s’agit pas simplement d’une imitation mais d’une complexe et subversive appropriation.
3/ — RHC : Au sein de ce foisonnement, quelle place prend aujourd’hui l’histoire des objets depuis les travaux stimulants qui en ont questionné la « vie sociale » ou l’agency ? Que nous disent-ils de nos rapports aux choses ?
— Clément Fabre : Du paysage historiographique survolé plus haut, il ressort clairement que l’on peut distinguer, au sein de l’histoire matérielle, histoire des objets et histoire par les objets. Si l’histoire des circulations matérielles globales, rejoignant en cela l’essor de la micro-histoire globale, s’est souvent focalisée sur des parcours d’objets individuels, les objets sont également intégrés, comme sources ou comme environnement matériel, à des études dont ils ne constituent pas la cible première. C’est là, je pense, le signe du succès rencontré aujourd’hui par l’histoire matérielle – et qui permet d’ailleurs d’en faire un outil si efficace d’histoire publique : elle devient suffisamment banale pour pouvoir être intégrée aux études les plus diverses, et croisée avec d’autres méthodologies, y compris dans des travaux qui ne se revendiquent pas explicitement, ou pas en premier lieu, de l’histoire matérielle. Prenez la récente étude de Vincent Lemire sur le quartier maghrébin de Jérusalem : la culture matérielle du quartier, préservée paradoxalement par sa destruction soudaine et brutale en 1967, y fait l’objet d’une analyse fouillée, sans pour autant que l’ouvrage se présente comme une étude d’histoire matérielle.
— Fabien Archambault : La distinction opérée par Clément Fabre entre histoire des objets et histoire par les objets me semble importante, ce qu’illustre bien la manière dont on a tenté jusqu’ici d’écrire l’histoire du football. Les historiens se sont en général efforcés, dans le cadre de monographies réalisées à l’échelle d’une ville, d’une région ou d’un pays, d’articuler les dimensions politiques (entre encadrement des masses, fabrication du consensus et affirmation symbolique du prestige de la communauté, quelle qu’elle soit), sociales (modalités, conditions et conséquences de la diffusion et de l’enracinement de la pratique dans les différents groupes sociaux), culturelles (entre logiques d’industrialisation des cultures de masse et stratégies d’appropriation multiples), économiques (origines et ampleur des investissements, émergences et reconfigurations des marchés des joueurs et des entraîneurs à différentes échelles), religieuses (la culture du football devenant par exemple en France et en Italie le fer de lance d’un projet de reconquête et de redéfinition d’une societas christiana), etc. Il est bien sûr possible de partir de l’objet spécifique que constitue le maillot de football en en contextualisant l’apparition, les usages, les évolutions, mais avec le risque de l’utiliser ainsi comme prétexte à l’exposition de résultats de la recherche obtenus par ailleurs sans qu’il représente le centre de la réflexion. En revanche, le considérer comme l’objet même de l’enquête, en étudier la forme, la matière, les couleurs, révèle des processus dont il est le produit et qu’il incarne dans sa matérialité. Si l’on s’intéresse, par exemple, à la circulation mondiale des premiers maillots à la fin du XIXe siècle, le football apparaît bien, en tout cas de manière bien plus éclatante que si l’on en reste aux discours produits par les acteurs, comme une des manifestations les plus complètes, tant sur les plans économiques, sociaux que politiques et symboliques, de l’« impérialisme du libre-échange » identifié par les historiens britanniques depuis les années 1950.
— Pascale Goetschel : Je dirais donc que ne peuvent pas exactement être mises sur le même plan une histoire des objets, qui consiste à observer l’évolution des formes et l’usage des matériaux (Raymond Guidot, Histoire des objets. Chronique du design industriel, 2013), et une histoire par les objets. Dans ce dernier cas, c’est moins l’existence de l’objet que les multiples sens de son caractère matériel qui sont interrogés. Reprenons le cas de l’évolution du fauteuil de théâtre (rappelons que les spectateurs sont assis au parterre dans les salles en Europe depuis le milieu du XVIIIe siècle). Elle nous en dit autant sur les hiérarchies sociales (entre l’orchestre et le poulailler), sur le polissage des mœurs tout au long du XIXe siècle (que l’on songe, en parallèle, au droit de siffler), sur l’embourgeoisement des salles à la fin du siècle, que sur le souci de plus en plus grand à partir du début du XXe siècle du confort, à un certain goût du luxe (usage du velours, couleurs rouge ou bleue le plus souvent) qui voit s’édifier des salles de cinéma sur le modèle de salles de théâtre.
— Manuel Charpy : La question est délicate car histoire des objets et histoire de la culture matérielle se confondent souvent. Cependant, peut-être que l’histoire monographique d’un objet rencontre les mêmes limites que l’histoire d’une personne ou d’une œuvre : c’est une mise en récit efficace mais qui peut être restreinte. À l’image de la prosopographie, l’histoire des objets devrait parvenir à mettre les objets en réseau. Nous avons tous participé à des histoires collectives où le risque de catalogue menace toujours. C’est que l’histoire des objets n’est souvent pas une histoire de la culture matérielle mais avant tout un dispositif narratif. Clément Fabre l’évoque, l’engouement récent – à la télévision (« A History of the World » (BBC), « Faire l’histoire » (Arte)…), dans la presse (hors-série de Libération « Les objets du siècle », des séries dans Le Monde…) … – soulève aussi en retour une série de questions pour cette historiographie. Il oblige notamment à se demander ce qui relève de la nostalgie dans cet engouement, alors nous n’avons jamais autant fréquenté les vide-greniers, les brocantes et les antiquités… Ce peut être une histoire rassurante (les objets sont toujours transitionnels) à la manière des leçons de choses – souvenons-nous de l’histoire de la civilisation industrielle à travers l’histoire de l’aiguille métallique par l’éditeur Pellerin… Il y a aussi sans doute une ambiguïté sur la nature même de cette histoire : le succès de l’histoire des objets vient sans doute aussi parfois d’une forme de positivisme.
4/ — RHC : Au-delà de la grande diversité de ses objets d’étude et de l’opposition fondatrice à une histoire des textes et des discours, est-il possible de définir une épistémologie commune, une unité des pratiques, une heuristique de l’histoire matérielle ?
— Clément Fabre : L’histoire de la culture matérielle, focalisée d’abord sur les significations dont étaient investies les objets, les a étudiés dans un premier temps principalement sur un mode symbolique – comme signes d’appartenances et de logiques de distinctions sociales –, qui n’impliquait pas de véritable renouveau méthodologique. Depuis plusieurs années en revanche, l’ambition croît d’utiliser les objets comme documents historiques à part entière – ce que Giorgio Riello qualifie d’« histoire à partir des choses »1. Ce nouveau front pionnier de l’histoire matérielle requiert un renouveau autrement plus conséquent des pratiques historiennes, qui passe principalement par la transdisciplinarité. Dans la mesure où les objets avaient longtemps été négligés par les historiennes et les historiens, leur premier réflexe, au moment de les mobiliser comme documents, a été de se tourner vers d’autres disciplines où leur étude avait été plus précoce – anthropologie, archéologie, histoire de l’art – et vers les musées, dont les conservateurs participent pleinement de ce renouveau historiographique. Cette collaboration entre disciplines demeure d’ailleurs un des enjeux centraux de l’histoire matérielle : tant que la critique externe des sources matérielles demeure un angle mort des formations historiennes classiques, travailler avec des spécialistes d’autres disciplines, y compris de sciences dures – une pratique déjà courante dans les laboratoires d’archéologie – est indispensable pour pouvoir exploiter véritablement la richesse des sources matérielles. Gianenrico Bernasconi a proposé en 2016 un survol des méthodes descriptives développées pour faire parler des « objets muets » (Jules Prown), en y traquant notamment l’indice des gestes et des pratiques dont ils ont été l’instrument et l’objet – les historiens s’inspirant ici directement de la description ethnographique des gestes techniques, autant que des méthodes de la tracéologie préhistorique et de l’archéologie expérimentale. La question, par exemple, de l’incorporation pratique des gestes techniques, longtemps monopolisée par les préhistoriens – grâce notamment aux rebuts collectés sur les sites de taille, vestiges d’un apprentissage progressif par observation des tailleurs les plus expérimentés – et par les anthropologues – grâce à l’observation directe de ces apprentissages – a ainsi pu intégrer le domaine des investigations historiques grâce à l’apport des sources matérielles : Ariane Fenneteaux met par exemple au jour l’apprentissage des gestes de couture par les fillettes dans le point maladroit des poches de poupées.
Gianenrico Bernasconi insiste toutefois également sur la nécessité, y compris pour étudier la matérialité même des objets, d’en croiser l’étude avec celle des textes et des archives. Il est donc difficile de placer au cœur de l’heuristique de l’histoire matérielle une opposition à l’étude des textes et des discours. L’enjeu d’inclure les objets dans l’horizon du travail historien est certes de revisiter nombre de domaines dont l’étude exclusive des textes et des discours avait pu nourrir une vision biaisée, mais la plupart des travaux les plus novateurs en histoire matérielle s’appuient justement sur l’étude croisée de ces différents registres de sources. L’histoire du livre, qui a précocement intégré à son questionnaire la matérialité du livre au même titre que le texte qu’il véhicule, et que les pratiques dont il fait l’objet, illustre d’ailleurs depuis plusieurs décennies l’intérêt de cette approche inclusive.
— Fabien Archambault : La question de la méthodologie de cette histoire matérielle est en effet décisive. Nous nous la posons par exemple dans le cadre d’un programme de recherche initié et coordonné par Paul Boulland et Barbara Bonazzi au sein du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains, qui vise à analyser les objets produits en contexte militant. Étendards, statuettes, badges, t-shirts, médailles, tasses, stylos : tout ce MATOS (Mémoires, Archives et Transmissions des Objets militantS) invite à revisiter l’histoire des mobilisations au prisme d’une politique des objets – objets qui sont à la fois des symboles, des marqueurs d’appartenance et des produits qui servent à la promotion et au financement des organisations et des luttes. La difficulté réside dans l’articulation entre étude des pratiques politiques et militantes, mais aussi l’histoire économique, l’histoire de l’art et des cultures populaires. Les historiens que nous sommes mobilisent d’abord des sources habituelles pour nous : les archives des organisations, notamment pour identifier les mécanismes concrets de la production, les choix (graphiques, esthétiques) voire les débats et les compromis dont ces objets résultent ; la presse militante, pour y repérer les circuits de vente ; les sources iconographiques et audiovisuelles, pour y relever la présence et les usages des objets. Car beaucoup sont fabriqués en série et par conséquent insérés dans des circuits de production, de diffusion et de commercialisation, et des marchés (nationaux et internationaux) qui structurent et sous-tendent une économie singulière. Mais certains de ces objets sont des pièces uniques, ce qui interroge les frontières entre objets artisanaux, objets décoratifs et œuvre d’art et implique, pour nous, d’aller voir du côté de l’histoire de l’art, du design, dont nous connaissons peu les méthodes.
— Pascale Goetschel : justement, ces méthodes ont été un peu évoquées plus haut. On peut aller encore plus loin. Je songe à ce que nous apprennent les promotrices d’une histoire de la mode en plein renouvellement. Elles partent de l’observation des objets mais font fonctionner d’autres sens que ceux de la vue ; elles sentent les tissus, elles touchent la matière, elles l’écoutent, bref, elles rendent grâce à la matérialité de l’objet. Évidemment, quand il s’agira d’objets gigantesques (la roue du parc d’attraction, la Tour Eiffel, le mur, que sais-je encore...), l’opération s’avèrera plus compliquée. L’idée de prendre en compte les différents sens mérite cependant d’être retenue, tant elle contribue, selon moi, à une histoire matérielle dans son acception pleine et entière. Serait-ce une méthodologie commune ? Je dirais davantage une série d’indispensables procédures. Encore faut-il que l’objet soit toujours accessible aujourd’hui...
Cela dit, l’on peut suggérer un autre moyen commun de procéder, que l’objet soit accessible ou non : celui qui consiste à systématiquement mettre au nombre des clés d’explication les conditions matérielles. Je m’explique : j’ai tenté dans mon ouvrage consacré à la « crise du théâtre », un objet discursif qui prend corps au début des années 1890 en France avant de s’éteindre comme controverse intellectuelle nourrie du sentiment national d’un inexorable déclin (pour être remplacée par d’autres crises), de montrer combien les éléments matériels avaient une place de choix dans la recherche des causes du mal. Et les pourfendeurs d’énumérer l’inconfort des salles, le « parcours du combattant » subi par le spectateur qui doit subir l’assaut des guichetiers, de l’ouvreuse... Loin d’être anecdotiques, ils sont essentiels...
Enfin, la question des usages me semble aussi devoir systématiquement être interrogée. Ces emplois, réemplois, détournements permettent de saisir la nature de regroupements, éphémères ou plus pérennes, d’acteurs sociaux, d’interroger leur sens et leur évolution dans le temps. L’on pourrait ainsi faire des objets des traits d’union mais aussi et surtout des acteurs à part entière qui alimentent des découpes sociales originales : amis, amateurs, passionnés, collectionneurs, jusqu’au fétichisme, à la dépendance ou à l’addiction. La détection de cette fonction de rassemblement autour des objets demande – bien sûr – à être complétée par ses pendants : la division, les tensions, les rivalités. Les objets contournés ou déplacés, confisqués ou détruits invitent, en particulier, à penser la dimension matérielle non comme accessoire mais comme essentielle dans les luttes de pouvoir. Le monument réaffecté, le drapeau brûlé, la statue déboulonnée, la lutte pour occuper l’espace public par les affiches, les graffiti ou autres signes graphiques, la concurrence de messages sonores et en constituent autant d’exemples.
— Manuel Charpy : Il y a une heuristique de l’étude de la culture matérielles mais c’est d’abord une poïétique : en regardant attentivement les choses – et Georges Pérec n’est à l’évidence jamais loin –, il s’agit de se défaire de leur familiarité, autrement dit de créer l’étrange familiarité qui relie une machine à coudre, un parapluie et une table de dissection – n’oublions pas que les Chants de Maldoror datent de 1864. Ce travail est à la fois nécessaire pour rehistoriciser des objets qui nous sont encore familiers et reconstruire des objets – nombreux – dont l’usage est perdu.
Retrouver l’étrangeté des objets et des systèmes d’objets, c’est une manière de revenir à des questions simples : comment les utilise-t-on ? – et les réponses sont toujours beaucoup plus étranges et complexes que l’on croit – Comment apprend-on l’usage des objets ? Qui achète tel ou tel objet ? Comment les répare-t-on ? Que fait-on des objets obsolètes ? Deux exemples : rien de plus familier qu’un ascenseur ou que le réseau électrique domestique. Or, dès que l’on reconstruit ces systèmes dans les détails, on découvre que l’ascenseur à la fin du XIXe siècle était manœuvré par le concierge, interdit à la descente, utilisé essentiellement par les habitants du 1er étage… Quant à l’électricité, on découvre qu’avant l’avènement des réseaux, pendant près de trente ans, entre 1860 et 1890, les appartements bourgeois utilisaient tous des dizaines de piles, pour l’éclairage et pour commander les domestiques à distance.
Suivre un objet ou une série d’objets, soit à travers les classes sociales de la société, soit dans l’espace, conduit à repenser les identités sociales et locales. C’est par exemple le cas avec la fripe : le discours qui dénonce les imitations voire les usurpations rendues possibles par la seconde main conduit à lire ce commerce comme le lieu où les classes modestes imitent les classes supérieures. Or, à la fin du XIXe siècle, et on en a la trace grâce aux nombreuses archives que laisse cette activité, il est évident que c’est un commerce qui participe à consolider les groupes sociaux. En ce sens, les travaux d’histoire de la culture matérielle prêtent tous une attention à la consommation au sens plein, c’est-à-dire à la fois aux manières d’user des objets et aux manières de les acquérir, de les revendre, de les transformer par la consommation. Il s’agit de réintroduire les choses dans une dynamique sociale en tentant de saisir la vie sociale des objets.
L’attention aux espaces, que l’on trouve en histoire comme en histoire de l’art, souligne un double mouvement : d’une part, un objet n’a pas le même sens ni les mêmes usages selon son contexte ; et en miroir, la présence d’objets qualifie un espace. Tout le courant de l’histoire connectée va en ce sens : suivre les circulations interrégionales et internationales des choses permet d’identifier et de décrire la nature des contacts et des échanges.
Les histoires de la culture matérielle partagent aussi sans doute le désir de bousculer les hiérarchies, en particulier celles construites à postériori. C’est évident en histoire de l’art où l’attention à la culture matérielle est une manière de ne plus s’en tenir uniquement aux objets exceptionnels. Un exemple : on peut penser le portrait depuis les grandes catégories techniques – la peinture, le dessin, la photographie… Mais si l’on s’attache aux usages et surtout aux objets qui circulent dans la société du XIXe siècle, les portraits mêlent volontiers photographies et peinture, photographies et mèches de cheveux… et ces images sont mises en scènes dans des cadres étranges et sous du verre plat, bombé, en bloc… Il y a donc un double mouvement à faire : penser la matérialité des œuvres et dans le même temps déconstruire cette catégorie, tout au moins si l’on vise une histoire sociale et culturelle. S’intéresser aux marchands de couleurs, aux cadres et signatures (Charlotte Guichard) est un moyen de regarder autrement les œuvres. Il ne s’agit en rien d’effacer la question esthétique mais au contraire, en naviguant entre objets singuliers et objets génériques, de penser qu’aucun objet ne peut échapper à une lecture esthétique.
En bousculant ces hiérarchies, l’histoire de la culture matérielle se propose finalement d’être une méthode d’histoire sociale – parmi d’autres – qui saisit les articulations entre les groupes, les pratiques plus ou moins distinctives, les appropriations, les braconnages… Les objets sont bien souvent « frontières » : ils sont bien souvent des dispositifs de pouvoir entre groupes sociaux, entre sexes, entre dominants et dominés… Les objets sont comme des nœuds sociaux d’où partent des séries de fils.
La culture matérielle est aussi un moyen de penser la manière dont les groupes sociaux font corps, au sens propre et figuré. Les objets – une chaise comme un corset, une montre comme un haut-de-forme – sont des dispositifs orthopédiques, des manières de modeler les corps, les gestes, les sensibilités… et tous les travaux qui mobilisent la notion de culture matérielle partagent me semble-t-il ce projet de faire une histoire sensible. Si les groupes sociaux s’évertuent à partager les objets, c’est que les objets ne sont pas que des témoins mais aussi des instruments. Nous demandons aux objets de nous guider, aussi bien dans la manière de marcher dans la ville que dans nos relations sexuelles ou nos manières de nous souvenir.
Enfin, la culture matérielle longtemps marquée par une forme de fonctionnalisme, dans le sillage notamment d’André Leroi-Gourhan, conduit à prêter attention aux usages concrets et par là aux détournements, mésusages, abandons… Pour exemple, dans le Congo en cours de colonisation des années 1900, l’installation de pendules et d’horloges peut être lue comme la tentative d’imposer un temps européen aux populations congolaises – et de nombreux travaux observent ce processus (David S. Landes, Giordano Nanni…) à l’échelle mondiale. Le fait que les jeunes urbains arborent tous de belles montres atteste cette incorporation d’un temps nouveau qui travaille la trame du quotidien. Cependant, on peut aussi noter qu’archives et récits indiquent qu’ils portent tous des montres cassées. Naïvetés et incompétences de population face à un objet technique nouveau ? Il se pourrait que ce soit une manière délibérée de conserver le prestige d’un objet tout en refusant ce qu’ils imposent. Avoir un objet et ne pas l’utiliser ou ne pas l’utiliser comme il se devrait fait sens. La partition utilisée depuis le milieu du XXe siècle par les designers entre « valeur d’usage » et une « valeur d’estime » est une commodité qui ne restitue pas la complexité du monde social.
In fine, faire de l’histoire de la culture matérielle c’est peut-être ainsi vouloir maintenir les interprétations ouvertes, échapper à une lecture positiviste et se tenir plus proche des enquêteurs de police ou des préhistoriens pour proposer des hypothèses d’interprétation.
5/ — RHC : Daniel Roche posait dans un entretien célèbre la question de la possibilité de faire l’histoire des objets sans les objets. Quels sont dans vos domaines de recherche les problèmes particuliers de conservation des sources matérielles ?
— Clément Fabre : Au-delà des enjeux méthodologiques que soulève l’étude des sources matérielles, une difficulté majeure de cette histoire tient effectivement à l’inégale conservation de ces documents : les spécialistes des périodes les plus récentes déplorent ainsi que les couches archéologiques qui en conservent le vestige et la trace aient longtemps été négligées au profit des couches plus anciennes, et le long désintérêt pour les matérialités ordinaires a plus largement favorisé leur disparition, compliquant d’autant leur étude aujourd’hui. L’inventaire des objets conservés dans les collections des musées autant que dans nombre de fonds d’archives constitue donc un enjeu crucial, et qui renforce encore la nécessité de collaborations accrues avec conservateurs et archivistes.
Reste que cette conservation sélective des objets du passé pose un autre problème, à caractère plus épistémologique : le rêve historien d’exhumer avec ces objets un ordinaire dont les textes n’auraient pas laissé de traces achoppe bien souvent sur les logiques des conservations familiales comme muséales, lesquelles ont généralement privilégié des objets exceptionnels – que ce soit par leur charge affective, par leur valeur économique ou par leur rareté –, ou sélectionné les objets qui illustraient le mieux un certain discours sur le passé. Cela nécessite donc de ne pas aborder naïvement ces sources matérielles comme autant de reflets objectifs du passé, mais d’étudier leur parcours et les logiques qui ont guidé leur conservation – la biographie matérielle proposée naguère par Arjun Appadurai constituant ainsi un préalable nécessaire à l’étude de nombreux objets dont il convient de savoir pourquoi ils ont été conservés plutôt que d’autres.
Cela renforce également la nécessité de croiser ces sources matérielles avec d’autres types de sources. Pour ce qui est par exemple des pratiques vestimentaires des missionnaires, catholiques comme protestants, dans la Chine du XIXe siècle, les articles vestimentaires conservés par les familles et les musées missionnaires sont bien souvent ceux que le missionnaire a choisi d’envoyer ou de rapporter de son terrain de mission, ceux qui illustrent le mieux l’adaptation des missionnaires aux pratiques chinoises, et une tenue unique est généralement conservée, ces différents facteurs contribuant à une vision caricaturalement homogène des pratiques vestimentaires en question. Aussi est-ce bien plutôt à travers les livres de comptes des procures, les correspondances et les journaux intimes, ou encore les sources photographiques, que l’on peut véritablement s’approcher de la diversité et de l’hybridité de ces pratiques, et étudier les enjeux qui s’attachent à la matérialité même de ces articles vestimentaires – depuis l’opacité opportune des lunettes chinoises teintées pour les missionnaires désireux de voyager incognito, et les faux pas vestimentaires qui menacent quiconque négligerait de passer sa tenue au crible d’une expertise chinoise, jusqu’à l’inconfort des souliers chinois pour des pieds inaccoutumés.
— Fabien Archambault : Une des finalités du programme MATOS consiste précisément à recenser des milliers d’objets qui dorment dans les réserves de centres d’archives ou de musées. Jusqu’à présent, les supports imprimés (livres, brochures, tracts, affiches) ou audiovisuels (disques et enregistrements sonores) ont été largement pris en charge, donnant parfois lieu à des campagnes de numérisation systématiques. En revanche, d’autres objets, hétéroclites, ne bénéficient pas de la même attention et restent négligés. Dans les centres d’archives, ils posent des questions spécifiques en termes de conservation, de valorisation ou de diffusion. Rarement exposés, ils n’ont quasiment jamais bénéficié de campagnes d’inventaire et d’archivage numérique. Leur conservation physique elle-même pose problème, faute de moyens ou de savoir-faire adaptés. L’objectif de MATOS vise par conséquent à mutualiser les ressources et les savoir-faire des centres d’archives regroupés au sein du CODHOS (Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale) – dont le périmètre comprend des institutions publiques – musées (MUCEM), centres d’archives (archives du monde du travail de Roubaix, archives départementales de Seine-Saint-Denis), bibliothèques (Grand équipement documentaire du Campus Condorcet, La Contemporaine à Nanterre) – ou privées – fondations (Jean Jaurès, Gabriel Péri), syndicats (CFDT, CGT, FO), etc.
— Pascale Goetschel : Pour mon domaine – celui des spectacles qui, pour aller vite, sont qualifiés de vivants –-, la question sonne curieusement. De fait, la conservation du fauteuil de Molière, des « machines parlantes » qui enregistrent les voix, des costumes de scène, des maquettes, planes ou non, est complexe, tant les espaces qui doivent les accueillir ne ressemblent guère à des compactus. Il existe alors des institutions dédiées, tels le Centre national du Costume de scène et de scénographie, ou le Musée des arts forains (cela dit, en France, contrairement aux États-Unis, notamment, il n’existe pas de musée du théâtre stricto sensu).
Cependant, la difficulté, lorsque l’on travaille sur des représentations éphémères, est de tenter de saisir ce qu’il en demeure. Dans un ouvrage dédié aux sources des spectacles (Marianne Filloux-Vigreux, Pascale Goetschel, Joël Huthwohl, Julien Rosemberg (dir.), Archives et spectacle vivant, 2014), je formulais ainsi quelques questions : « Comment saisir ces fugitive materials, les voix, les intonations, les gestes ou les postures ? Et que faire de ce qui ne figure pas immédiatement dans le champ de la représentation ? De ce qui est hors cadre, en dehors du champ ? » Et de constater que, paradoxalement, « l’historien-ne du spectacle, et plus généralement tout observateur des arts de la scène, doit donc composer avec l’absence. Mais pas toujours. Car, de manière assez curieuse et contradictoire, c’est sur ce même terrain que se sont développées des pratiques de reliques, amoureusement ou religieusement conservées : tel portrait d’acteur ou d’actrice, tel costume ou tel objet… ». Face à ce paradoxe qui consiste à faire face à peu de traces mais aussi à des pratiques reliquaires, l’intérêt est d’accorder toute sa place à ce qui reste des traces matérielles du passé : maquettes et décors, enregistrements sonores, costumes et objets de scène… Ce passage par l’histoire matérielle conduit alors à s’interroger sur les voix, les intonations, les gestes, à s’intéresser davantage au processus qu’au résultat.
— Manuel Charpy : Il y a une difficulté ancienne et qui perdure du fait même de la nature des musées, lieux chargés de la conservation des objets. Les observateurs qui sont au Congo dans le sillage de la colonisation à la fin du XIXe siècle notent que les tombes des chefs sont couvertes d’objets les plus divers importés d’Europe : assiettes, brocs, nains de jardins en céramique, statuettes en plâtre, canotiers, parapluies… Ils s’étonnent que ces objets soient systématiquement brisés ou déchirés, avant d’être placés sur les tombes. Certains interprètent cela comme le désir d’empêcher les vols. On peut le lire comme un acte simple et efficace pour mettre les objets hors d’usage et n’en préserver que le pouvoir symbolique. Les musées européens font au même moment exactement la même chose – et il n’est pas impossible qu’ils continuent. Il y a naturellement la sélection même des objets qui entrent dans les musées : on ne collecte que l’exceptionnel – et dans un sens c’est un moyen de ne pas mourir étouffé –, plus volontiers le rare et le cher. Nous avions cherché pour une émission de radio en 2012 la robe la plus ordinaire dans le musée Galliera : elles étaient très rares et jamais exposées2. L’objet anonyme et ordinaire peine à franchir le seuil du système muséal car le musée fonctionne sur l’objet esseulé – or un objet anonyme fait sens en série, en système… Il faudrait déverser des quantités d’objets sur une bâche comme le font les marchands aux puces et savoir comment les ranger et les scénographier. En dehors du MUCEM et de ses réserves – et des quelques musées qui retiennent les « traditions populaires », en général « perdues », la France possède peu de lieux conservant des objets ordinaires, si ce n’est dans des musées très locaux et thématiques. Point d’ensemble comme peuvent le proposer le Werkbundarchiv – Museum der Dinge à Berlin, le Musée d’ethnographie de Neuchâtel, le musée de la Vie quotidienne à Gand, le Museo Guatelli – Il Museo del quotidiano près de Parme… Le paradoxe étant que dans le même temps personne ne veut d’expositions faites uniquement de textes et de papier. Le chemin entre bazar nostalgique et chefs-d’œuvre est difficile à trouver et nécessiterait aussi une autre manière de travailler avec les scénographes.
La numérisation des objets – même si elle soulève quantité de questions – est sans doute un moyen de donner accès à des fonds qu’on peut appréhender comme des séries – on peut penser à la très récente mise en ligne des Dessins et modèles (1847-1961) par les Archives de Paris – et articuler et confronter avec d’autres fonds. Les débats autour des restitutions permettent aussi de repenser les choses : rendre les objets comptent mais plus encore toutes les données qui leur sont attachés et qui permettent véritablement d’en écrire l’histoire.
Car l’autre difficulté est que, bien souvent, quand ils existent et qu’on peut les manipuler, les objets sont décevants. D’une part, ils sont isolés et donc décontextualisés et, d’autre part, en les restaurant, les traces de leur usage sont en général soigneusement effacées. Remonter aux gestes peut être alors plus difficile encore qu’en archéologie. Un musée fait exception : le MUCEM qui collecte – avec fiche à l’appui – des objets et les conserve en l’état. Pour exemple, les vêtements par exemple, ils demeurent avec leurs tâches, accrocs, usures…
Il faut peut-être aussi assumer un paradoxe : manipuler les objets donne des indications centrales sur leur fabrication leur esthétique… mais ils demeurent silencieux – et il faut ajouter que nous sommes formés à intégrer du texte dans du texte, peu des images et encore moins des objets. Finalement les objets sont utiles quand ils peuvent être réinsérés dans leur gangue de textes, de récits, de chiffres…
J’avais construit ma thèse (sur la culture matérielle bourgeoise du XIXe siècle) autour d’un vide : l’inaccessibilité aux dizaines de milliers de dépôts de dessins et modèles des Archives de Paris. C’était peut-être rétrospectivement une chance : cela obligeait à assumer le fait que l’histoire de la culture matérielle vise toujours à faire des objets des témoins – d’une histoire technique, sociale, culturelle, politique… – mais aussi que c’est toujours une histoire au 3e degré en quelque sorte : on cherche des sources écrites, visuelles, techniques pour évoquer des objets qui ensuite doivent permettre de saisir, questionner, penser des pratiques, des relations sociales. Cette pratique du détour espère saisir ce qui ne se dit pas – dans la bonne société notamment – et ce que les gens ne peuvent dire – dans les milieux populaires.
6/ — RHC : Existe-t-il dans le champ académique actuel un enseignement de l’histoire matérielle ?
— Clément Fabre : L’enseignement académique de l’histoire matérielle se développe, mais de façon encore très inégale, et dépend surtout des pôles universitaires où la recherche en la matière est la plus dynamique. C’est le cas notamment à l’université de Warwick, centre particulièrement actif en histoire des cultures matérielles, où cette dernière est enseignée dès les undergrad studies, et dont deux professeurs – Anne Gerritsen et Giorgio Riello – ont d’ailleurs publié en 2015 un manuel du supérieur, Writing Material Culture History, explicitement destiné à alimenter de tels enseignements, et à favoriser leur généralisation.
— Pascale Goetschel : Depuis plusieurs années, je propose au sein de mon université, à Paris 1, un enseignement intitulé « Pour une histoire des objets à l’époque contemporaine », que je partage désormais avec Fabien Archambault. Cette proposition était destinée à illustrer un cours d’initiation à l’histoire culturelle du contemporain en L3. En cette fin d’entretien, je songe que cette unité d’enseignement relève peut-être plus d’une histoire matérielle au sens où elle a été discutée plus haut que d’une histoire des objets.
Au-delà de la dimension épistémologique importante qui fait l’objet des premières séances, il s’agit de prendre les objets comme biais pour comprendre les évolutions des attitudes corporelles, de la consommation ou de la mobilité, des formes de conflits armés, des luttes sociales ou politiques, des pratiques ludiques, sportives ou médiatiques. À chaque fois, les questionnements autour de « l’univers des formes » se doublent de diverses interrogations : autour des mythologies qui les accompagnent ; sur leurs usages, rassembleurs ou conflictuels ; sur les configurations sociales qui s’organisent autour et par les objets ; sur les rapports au monde qu’ils supposent. Plus avant, l’ambition est de s’interroger sur ce que les matérialités, soit les caractères matériels de problèmes, de faits, de notions font à la compréhension historique. En fin de semestre, un travail de « micro-recherche », présenté à l’ensemble du groupe, conduit les étudiantes et les étudiants à s’approprier les objets qu’ils ont choisis en faisant parler leur matérialité. De la poupée Barbie au sex toy, du perfecto à « ce que dit le wax de l’Afrique… ou pas », de la lampe de poche à la chaussure de randonnée, de la poussette ou au bâton de marcheur, chacun.e essaie à sa façon, de faire parler son « objet ».
— Fabien Archambault : Pascale Goetschel a évoqué le cours d’histoire culturelle des objets que nous assurons à Paris 1 en 3e année de licence. Pour nous, enseignants, c’est l’occasion de satisfaire notre curiosité et de choisir des objets, déjà croisés ou auxquels on n’avait ou n’aurait jamais pensé ; l’idée est de présenter différents types d’objets : cette année, par exemple, nous passons de la vespa au nain de jardin ou à la banderole.
Mais c’est aussi l’occasion pour les étudiants d’effectuer un premier travail d’initiation à la recherche : beaucoup des objets choisis par eux sont étudiés de manière fine, approfondie, rigoureuse – ils nourriraient facilement plusieurs tomes supplémentaires du Magasin du monde…
— Manuel Charpy : Les difficultés à enseigner l’histoire de la culture matérielle tiennent à ce que j’évoquais plus haut : les musées sont finalement rares et les musées d’enseignement plus encore. Il existe à l’Université de Brighton un « musée d’enseignement » (la Dress History Teaching Collection), animé par Lou Taylor. Il est consulté et constitué par des étudiant·e·s aussi bien en art qu’en histoire. Et par définition, il ne conserve pas les mêmes objets qu’un musée de la mode : Lou Taylor y a par exemple fait entrer des pièces rapiécées des dizaines de fois, véritables loques… et uniques témoignages sur les manières de se vêtir dans les milieux très populaires des années 1900-19503. Les équivalents en France sont rares – les musées des universités sont toujours du côté du patrimoine, jamais des collections dynamiques, en cours de constitution – et les musées qui avaient cette mission n’osent plus faire manipuler les objets. De façon significative, les rails dans le musée des Arts et métiers servaient à faire entrer les machines dans le musée mais aussi à les déplacer pour les cours. Ils sont aujourd’hui comblés pour éviter les chutes. Reste que les enseignements sont aujourd’hui nombreux, en anthropologie mais aussi en histoire et en histoire de l’art : on peut songer aux cours et séminaires de Natacha Coquery à Lyon, d’Ariane Fennetaux et Géraldine Chouard à l’Université Paris-Cité (Digital Materialities), du séminaire que nous avons mené pendant huit ans à Lille avec Gil Bartholeyns (Culture matérielle et visuelle), au séminaire Usages (historiens) des objets co-organisé avec Noémie Étienne… Il me semble que cette manière de passer par les objets dans l’enseignement de l’histoire a gagné un peu dans les lycées et les licences – les étudiant·e·s sont sensibles à cette approche qui permet de rendre tangible la recherche en montrant comment on construit des problématiques à partir d’objets – au double sens du terme – en apparence simples. Il faut ajouter que dans de nombreuses écoles d’arts et d’arts appliqués, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis mais aussi en France, au Pays-Bas, en Allemagne… des enseignant·e·s construisent des cours d’histoire de la culture matérielle.
Il faut souligner que cet enseignement se diffuse grâce à la multiplication des monographies mais aussi des readers et manuels – même s’ils sont rares en français. On peut penser aussi bien à Writing Material Culture History d’Anne Gerritsen et Giorgio Riello (Bloomsbury) ou à La Culture matérielle de la France, XVIe-XVIIIe siècle de Marjorie Meiss (Armand Colin).