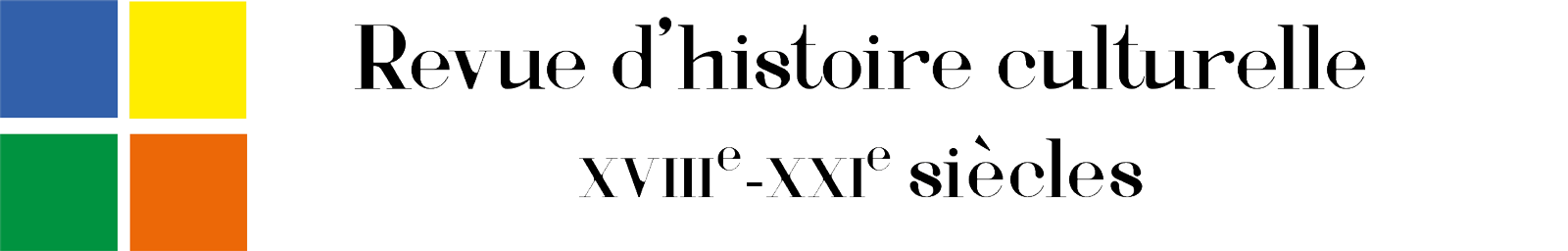Comment définir d’un point de vue juridique la liberté académique ? Existe-t-il des particularités du statut actuel des enseignants-chercheurs français en cette matière ?
Avant de vous répondre sur le fond, je ferai une clarification sémantique : en toute rigueur, on doit utiliser le mot de liberté académique au singulier. C’est la traduction normale de l’expression allemande « Akademische Freiheit », qui est devenue célèbre sous son vocable anglais de « academic freedom ». En France, nous n’avons jamais reçu ce concept, ayant seulement à notre disposition celui des « libertés universitaires ». Le simple fait que l’on parle des « libertés académiques », au pluriel, en dit long sur l’ignorance française sur la question qui redouble celle sur le concept même d’université qui a été si peu étudié en France.
Sur le fond, comme il n’y a pas de concept de liberté académique en France, il n’y a donc pas de définition juridique de la liberté académique. D’une manière générale, le concept de liberté académique n’est pas un concept juridique et même lorsqu’il est mentionné dans un acte juridique comme c’est le cas dans la Charte européenne des droits de l’homme, il n’est jamais défini. Il existe dans certains pays des concepts qui lui sont liés comme en Allemagne le concept de « liberté de la science » (art 5 de la loi fondamentale). Le concept français de libertés universitaires n’est pas davantage défini par des textes de droit. Pour savoir ce qu’il recouvre, il faut lire soit la thèse de Bernard Toulemonde, qui date de 1971, soit celle, plus récente, de Camille Fernandes (2017), soit mon livre sur Les libertés universitaires à l’abandon ? (2010). Il existe seulement des fragments de cette liberté reconnus soit dans la loi Faure de 1968 qui reconnait la liberté d’expression (art 34) soit dans la loi Savary qui reconnaît le pluralisme des opinions.
La question centrale est celle de la finalité de la liberté académique. Au lieu de reprendre votre vocabulaire utilitariste (à quoi sert-elle ?), je dirais plutôt que la liberté académique est la condition d’exercice du métier d’universitaire – je n’utilise plus du tout l’expression déplorable d’enseignant-chercheur1. Pour qu’un universitaire puisse faire correctement son métier, il doit pouvoir jouir d’une triple liberté : la liberté de recherche, la liberté d’enseignement et la liberté d’expression (que ce soit dans son cours ou en dehors de son cours). Cette liberté peut et doit être opposée à tous les pouvoirs qui peuvent la menacer, soit de l’extérieur (pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir économique) soit de l’intérieur (l’administration, les étudiants, voire les collègues des universitaires).
Une erreur courante est d’identifier la liberté académique à la liberté d'expression, ce qui est un grave contre-sens. La première est une liberté professionnelle accordée à certaines personnes qui ont accédé à un statut en raison de travaux scientifiques jugés pertinents par leurs pairs, tandis que la seconde est un droit de l’homme qui permet à quiconque doué de raison d’exprimer des opinions. La liberté académique implique la liberté d'expression du professeur qui parle en cours ou qui écrit, mais celle-ci n’est pas illimitée2. En cours, un professeur ne peut pas exprimer de pures opinions sur des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence. Un professeur de mathématiques n’a pas à donner ses opinions, politiques ou religieuses, sur telle ou telle affaire brûlante de l’actualité. Il faut comprendre à ce propos que la liberté académique ne doit pas dégénérer en anarchie académique et qu’elle ne peut pas être exercée sans un garde-fou qui est l’éthique académique. C’est peu compris par certains universitaires français qui ont une compréhension un peu trop « souple » des devoirs déontologiques
La protection de cette liberté varie suivant l’acception que l’on adopte de cette expression. Pour la liberté académique « institutionnelle » (qui concerne le corps professoral), les garanties sont institutionnelles : c’est l’autonomie du corps, le principe de cooptation et le principe d’élection des dirigeants de l’université. Il suffit de songer a contrario à la façon dont Erdogan veut mettre au pas l’université du Bosphore en nommant lui-même un proche à la présidence de cette université. C’est ce que j’appelle les « garanties institutionnelles » de la liberté académique et elles sont assez fortes en France. Elles le sont d’autant plus que les universitaires français sont des fonctionnaires d’État et qu’ils jouissent par là d’un bien inappréciable : ils ne peuvent pas être « révoqués » (licenciés) s’ils ont déplu à leurs dirigeants d’université ou à leur ministre. Quant à la liberté académique individuelle (avec ce triptyque cité plus haut), elle est assez mal protégée, faute d’ancrage constitutionnel ou législatif de cette liberté. Elle l’est d’autant moins que le Conseil d’État fait peu de cas des libertés des universitaires, comme j’ai eu l’occasion de le démontrer dans mon livre de 2010.
Pour résumer, je dirais que la singularité française, issue de l’histoire, est double. D’une part, l’universitaire en France jouit d’une protection parce qu’il est fonctionnaire et qu’il n’est pas un fonctionnaire comme les autres. On lui accorde une plus grande liberté individuelle et institutionnelle, une plus grande liberté d’expression, tout comme on lui confère une protection plus grande car il ne peut pas être révoqué par l’Administration ou le ministre, mais uniquement par ses pairs, par la juridiction disciplinaire. La récente réforme législative confiant la présidence de la juridiction universitaire (le CNESER disciplinaire) à un conseiller d’État est à mon avis un recul inquiétant qui n’a pas assez attiré l’attention des universitaires.
D’autre part, une autre singularité tenait au fait que ces libertés universitaires étaient reconnues et garanties par des usages et des coutumes et que faute de loi, de telles libertés sont précaires à la merci de n’importe quel décret ou même arrêté. Une telle singularité est en passe de disparaître face au rouleau-compresseur de la bureaucratie ministérielle (de la rue Descartes) qui agit par des textes réglementaires.
Quel est l’ancrage historique de la notion : existe-t-il des liens avec les « libertés » des anciennes universités, puis avec les « garanties universitaires » du XIXe siècle ?
En France, l’ancrage historique est manifeste avec l’université de type médiéval, comme le prouvent l’expression de libertés universitaires. En effet, celles-ci incluent les fameuses « franchises universitaires » qui sont, d’une part, la franchise de police, et d’autre part, la franchise de juridiction. Autrement dit, les forces de police ne peuvent pas pénétrer, sauf cas de flagrant délit, dans une enceinte universitaire sans l’autorisation du responsable de l’établissement en question. D’autre part, on l’a vu plus haut, la justice à l’égard des universitaires est spécifique dans la mesure où le pouvoir disciplinaire est exercé uniquement par les universitaires eux-mêmes : en cas de faute professionnelle, la juridiction compétente est de type échevinal, composée uniquement d’universitaires, sous l’exception faite de la réforme récente du CNESER. Le lien est donc patent avec le système médiéval et celui des « garanties universitaires » du XIXe siècle. C’est parfaitement documenté dans la thèse hélas, non publiée de Bernard Toulemonde, citée plus haut.
Dans quelle mesure peut-on parler d’une recrudescence actuelle des attaques contre la liberté académique, qu’elles émanent du pouvoir politique ou de mouvements militants ?
Il me semble manifeste qu’il y a de nos jours une recrudescence des attaques contre la liberté académique, mais je crois que la focalisation sur la question de « l’islamo-gauchisme » empêche de voir le tableau dans son ensemble qui est préoccupant et qui est différent de l’image qu’en donnent les médias (qui apprécient surtout le sensationnel). Ce n’est pas propre à la France, car si on laisse de côté les pays autoritaires où la liberté académique est toujours la première attaquée (il suffit de songer à la Chine, à la Turquie ou à la Hongrie), on s’aperçoit que dans tous les pays dits libéraux, la liberté académique est en ce moment malmenée. Le phénomène prend des formes différentes selon les pays. Il va de soi que, aux États-Unis, par exemple, la liberté académique est malmenée des deux côtés, à droite par le populisme et ce qu’on a appelé la « patriotical correctness » et à gauche par les mouvements militants étudiants qu’on englobe aujourd’hui sous le vocable de Cancel Culture, qu’on appelait naguère la « politically correctness ». Le phénomène s’accentue de nos jours avec des excès proprement ridicules, aux États-Unis et au Canada anglophone. En réalité, tout cela remonte aux années 1960 où aux États-Unis comme en France sont apparus de nouveaux ennemis de la liberté académique, à savoir les étudiants (au sens restreint évidemment des étudiants militants et radicaux).
Le phénomène s’est amplifié depuis lors et on voit arriver cela dans les universités en France, même si cela reste marginal, les « trois causes sacrées »3 qui sont agitées par les étudiants (et parfois, rarement, par quelques universitaires militants) : « la cause des femmes », la « cause anti-raciste » et « la cause LGBT » affectent assez peu la liberté académique en France, même si l’on voit ce triple mouvement arriver. La question est de savoir s’il s’agit d’une vague ou si cela sera un tsunami. Mais d’ores et déjà, je peux affirmer, au vu de mes recherches en vue d’un livre en voie d’achèvement4 que, au sein des résultants des causes « identitaires », la plus dangereuse pour la liberté académique est celle dont on parle le moins, « la cause des femmes » telle qu’elle est mobilisée par le féministes activistes ou radicales qui ne font pas dans la nuance. Sait-on par exemple que le domaine des sciences dures — qui a été longtemps épargné par les trois causes « identitaires » — commence à être pénétré par ce féminisme militant ? Un physicien au CERN de Genève a été récemment ostracisé parce qu’il a dans un séminaire de recherches osé prétendre – statistiques à l’appui – qu’il n’y avait pas de discrimination à l’embauche des physiciennes. On n’a pas discuté ni réfuté son propos, mais on l’a simplement accusé d’être sexiste et « misogyne ». En France, des féministes ont empêché qu’on diffuse et qu’on discute à l’université du film de Polanski, J’accuse. Et on pourrait multiplier les exemples en ce sens. Certains vont même jusqu’à défendre au nom de la parité une affirmative action en faveur du recrutement des femmes comme professeurs d’université, ce qui est contraire à la liberté académique au sens institutionnel du terme. Mais, répétons-le, le surgissement des causes « identitaires » dans les universités françaises n’est pas le phénomène actuel le plus préoccupant, et il est loin d’être le plus important. C’est pour cela que je défends l’idée qu’il faut sortir de cette absurde polémique sur l’islamo-gauchisme que la ministre a cru bon d’agiter pour des raisons d’ailleurs purement politiques.
En effet, dans le panorama plus vaste qu’il convient de brosser, il faut d’abord prendre en compte ce que j’appelle la résurgence d’anciennes menaces. La menace politique réapparaît à travers le fait du Prince quand la revue de l’Agence française pour le développement censure un numéro d’Afrique aujourd’hui qui faisait un tableau critique de l’intervention de la France au Mali. La résurgence de la menace économique est aussi évidente. La plupart des universitaires se plaignent à juste titre des conditions difficiles de financement des recherches. La concentration des moyens par l’ANR est une mauvaise chose, typique de la mauvaise administration à la française. Mais on devrait aussi mentionner la tendance récurrente des grosses entreprises à vouloir interdire la parole professorale par des poursuites judiciaires abusives dénommées « procès-baillons ». Les juristes et économistes en ont été victimes, par des tycoons du genre de Xavier Niel ou d’entreprises comme CHIMIREC ou Veolia. Ici l’atteinte à la liberté d'expression est patente. Les historiens ont d’ailleurs été les premiers concernés par ces questions puisqu’il faut rappeler que Bernard Lewis a été condamné en justice pour avoir contesté la notion de génocide arménien et que l’historien, Olivier Pétré-Grenouilleau a fait l’objet d’une plainte au civil par une association DOM (Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais et Mahorais) pour avoir affirmé que la traite négrière n’était pas un génocide, même si la plainte a été retirée en 2006.
Par ailleurs, dans le cas français, on ignore un second danger récurrent qui est l’autoritarisme administratif. Personne n’en parle car la plupart de ceux qui s’expriment dans les médias n’enseignent pas à l’université… et ne connaissent pas le quotidien parfois grisâtre qui peut y régner. Or, pour l’homo academicus français « moyen », le bureaucrate – que ce soit le grand bureaucrate (le ministère, ou le président d’université) ou le petit bureaucrate – est devenu un ennemi de sa propre liberté académique. En France, c’est un fait majeur curieusement passé sous silence. Il y a d’abord un fait historique : l’État français peut toujours à tout moment abuser de ses pouvoirs et cela vaut pour les universités comme pour le reste. On semble avoir oublié que le sociologue Maffesoli, savant très contesté dans sa discipline, a été nommé à l’Institut Universitaire de France à la suite d’une intervention politique, sans que beaucoup ne s’en émeuvent alors que c’était un cas typique de fait du Prince. C’est l’autoritarisme étatico-ministériel.
De même, la loi LRU de 2007 (dite loi Pécresse) a donné des pouvoirs importants aux présidents d’université qui parfois, se comportent en roitelets ou tyranneaux. Chaque universitaire trouvera tout seul les exemples innombrables de décisions autoritaires de leurs nouveaux « chefs ». De même, la caporalisation de l’université se répand en cascades car on a créé des structures bureaucratiques potentiellement autocratiques comme les écoles doctorales. Dans le livre, précité, je donne des exemples proprement édifiants d’abus de pouvoirs de directeurs d’école doctorale qui violent autant la liberté académique du directeur de thèse que la liberté du thésard. Enfin, la petite administration – le personnel administratif donc – est en train de conquérir du pouvoir car on ne compte plus les cas d’abus de pouvoir de chefs de service qui croient être en mesure de « commander » aux universitaires en ayant la regrettable tendance à se décharger sur eux de tâches purement administratives. Faut-il pourtant rappeler que, dans leur statut (le décret de 1984), ceux-ci n’ont pas à effectuer de telles tâches ? La liberté de recherche est gravement quoiqu’indirectement, affectée par ce transfert de charges vers les universitaires. C’est moins médiatique que les dérives identitaires de tel ou tel groupe d’étudiants ou le prétendu islamo-gauchisme, mais pour l’universitaire de base, c’est le cœur de son métier qui est atteint, par tous ces « administrateurs » qui n’ont aucun respect pour la liberté académique.
Enfin, pour évoquer les nouvelles menaces contre la liberté académique, comment ne pas mentionner le harcèlement par internet ? Ce nouveau medium et son corollaire, les réseaux sociaux, transforment profondément la parole professorale qui peut devenir à tout moment une parole « publique », par des diffusions vidéos (illégales au demeurant). À cet égard, les témoignages affluent et sont confondants. A l’étranger, les lecteurs qui suivent ces questions doivent avoir en tête cette terrible affaire de l’Université d’Ottawa (nov. 2020) où une pauvre enseignante (au statut précaire de chargée d’enseignement) a subi une campagne de haine pour avoir utilisé le mot de « nègre » dans une visée pédagogique pour expliquer comment les écrivains noirs américains avaient su retourner le stigmate contre ceux qui l’utilisaient alors qu’elle faisait un cours sur la théorie queer (cela s’enseigne au Canada). Elle fut dénoncée par une étudiante qui non seulement donna son nom sur internet, mais aussi son adresse personnelle. Au lieu de sanctionner l’étudiante en question, le président de l’université a suspendu de ses fonctions l’enseignante et il a hurlé avec les loups au lieu de la protéger contre cette attaque insane. Mais, bon, on est au Canada anglophone comme le prouve le fait que seuls les professeurs québécois, ou presque, ont signé la pétition pour défendre la professeure lynchée. On n’en est pas encore là en France. Mais quand même, internet y fait aussi des ravages et de plus en plus. Deux professeurs de droit l’ont appris à leurs dépens en octobre et en décembre 2020 lorsqu’ils eurent le malheur d’exprimer sur l’affaire du mariage pour tous et sur la religion musulmane des positions personnelles qui ont été diffusées, tronquées le plus souvent, sur des réseaux sociaux, et qui ont été lynchés médiatiquement. Nous avons, plusieurs collègues et moi, défendu le premier d’entre eux dans Le Point (en octobre 2020) au nom de la liberté de parole professorale5.
L’enjeu est clair : c’est la défense du métier d’universitaire par la défense de la liberté académique sous toutes ses formes, y compris par la liberté de la recherche et par la liberté d'expression.
Au-delà du flou sémantique qui entoure la notion, que penser des appréciations de Frédérique Vidal et Jean-Michel Blanquer concernant la politisation de l’enseignement et de la recherche et la diffusion de prétendues tendances « islamo-gauchistes » chez les chercheurs, notamment dans les domaines des sciences humaines et sociales ? Que peut le droit face à une telle situation conflictuelle ?
Je pense que ce débat lancé par les politiques l’est sur de mauvaises bases et ne rend pas du tout compte de la façon dont, objectivement, la liberté académique est aujourd’hui menacée en France. Le débat est totalement piégé puisque la querelle ne fait intervenir que les extrêmes sur des thèmes, l’islamisme en premier lieu et aussi en second lieu ce qu’on appelle la « pensée décoloniale » qui sont peu éclairants pour comprendre la situation universitaire en France. Ce pseudo-débat fonctionne comme un rideau de fumée, cachant les autres véritables problèmes énumérés plus haut. Ceci dit, et en toute hypothèse, cette idée d’une enquête sur ce qu’écrivent et ce que pensent les universitaires constitue une régression car on ne peut pas en même temps vouloir défendre la liberté académique et vouloir introduire une sorte de nouvelle « chasse aux sorcières ». En outre et surtout, le véritable problème sur ces questions provient plutôt des étudiants militants et d’un syndicat comme l’UNEF, syndicat déliquescent qui n’est plus le premier syndicat étudiant.
Le droit ne peut pas faire grand-chose à mon avis, sauf à poursuivre disciplinairement les étudiants qui abusent de leur liberté. Toutefois, Mai 68 plane en France comme une ombre sur l’université et les présidents d’université sont le plus souvent tétanisés lorsqu’il s’agit de sévir contre les excès estudiantins. Je rappelle aussi que porter atteinte à la liberté d'expression constitue dans certains cas un délit pénal. La meilleure garantie devrait être à mon avis la défense par les universitaires de la liberté académique mais on en est loin car ceux-ci ne la connaissent pas tandis que, par ailleurs, l’université française est dans un état d’anomie et profondément divisé politiquement. On le voit bien quand Étienne Balibar attaque ceux qui veulent défendre la liberté académique en les taxant de « corporatisme »6. Or, précisément, défendre la liberté académique, c’est défendre la liberté d’une profession et cela suppose d’être prêt à défendre la liberté d’un collègue dont on déteste les opinions politiques parce que, justement, c’est un collègue. Cela n’est pas dans l’ADN de l’homo academicus français qui est rarement un « libéral ».
D’un point de vue médiatique, la polémique débutée à l’automne dernier n’a guère concerné que les universitaires eux-mêmes. Les débats n’ont rencontré qu’un écho modeste auprès de la société civile, principalement par le jeu des tribunes ou d’appel. Comment peut-on expliquer ce relatif isolement universitaire ?
Comment voulez-vous qu’il en soit autrement ?... L’université en France est la « voiture-balai de l’enseignement supérieur » pour reprendre l’expression de mon collègue et ami, le sociologue François Vatin. Pour faire bref, je me contenterai de renvoyer vos lecteurs à l’article que nous avons écrit ensemble: « L’université française, la mal aimée de la République »7.