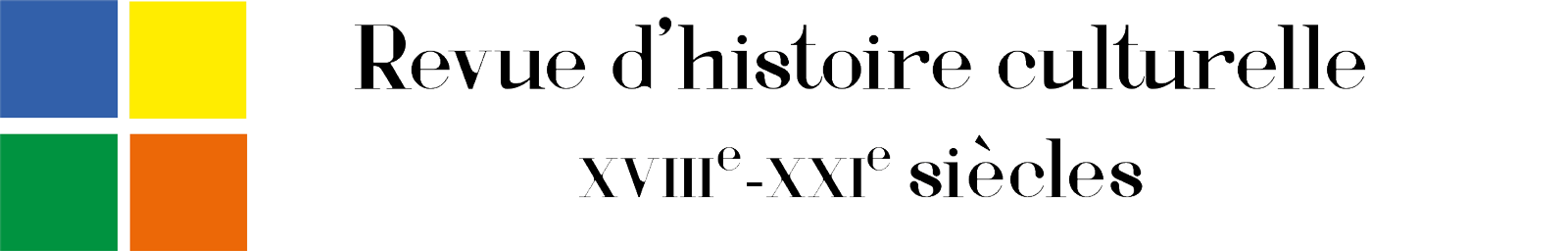Certains d’entre nous avaient le sentiment que l’histoire qui nous était racontée en France nous insultait. Elle était faussée, transformée par le prisme déformant d’une idéologie apologiste, voire complice, du camp génocidaire. Une histoire officielle était en train de s’écrire et nous n’en voulions pas.
Bruce Clarke, « Les hommes qui voulaient être debout : imaginer le génocide », in Rwanda, 1994-2014. Histoire, mémoires et récits, Dijon, Les Presses du réel, 2017, p. 437-438.
Le 7 avril 2019, à l’occasion de la 25ème commémoration du génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda, est présentée à Kigali la performance théâtrale Umurinzi, créée par le dramaturge rwandais Dorcy Rugamba. Diffusée à la télévision nationale, la représentation vise à entretenir la mémoire individuelle des disparus de 1994 dont les noms tendent trop souvent à s’effacer derrière les bilans statistiques catastrophiques des massacres. Deux jours plus tôt, à Paris, le président français, Emmanuel Macron, annonçait la nomination d’une commission chargée « de consulter l’ensemble des fonds d’archives françaises relatifs à la période pré-génocidaire et celle du génocide lui-même »1. Le choix des membres de la commission et les conditions de leur nomination suscitent d’emblée une vive polémique : pétition2, tribunes, affrontements par articles de presse interposés3, l’écho de cette dispute parisienne résonne jusqu’à Kigali, puisque quelques heures avant que ne s’élèvent les chants d’Umurinzi, le journaliste Jean-François Dupaquier4 interpelle personnellement l’historien Vincent Duclert : « Vous avez accepté de présider une commission sur les archives encore secrètes de la France au Rwanda. Vous découvrez pour la première fois le Rwanda aujourd'hui. Je suis étonné que vous ayez accepté cette mission avant même de connaître ce pays »5.
Dans un contexte d’hommage aux victimes, l’historien se voit ici défié par le journaliste avec, pour toile de fond, une nouvelle initiative politique française concernant ce que certains considèrent comme l’un des plus grands scandales de la Cinquième République6. Depuis 1994, l’État français est en effet accusé d’avoir joué un rôle crucial dans le déroulement des événements rwandais qui ont conduit au génocide des Tutsi du Rwanda d’avril à juillet 1994 19947 : entrainement de miliciens, soutien militaire aux Forces armées rwandaises, appui diplomatique apporté au Gouvernement intérimaire rwandais qui orchestre le génocide, sauvetages sélectifs en avril puis en juin 1994, les accusations portées par des journalistes, des militants ou d’anciens militaires sont lourdes et le plus souvent solidement étayées8.
La création d’une commission d’historiens et de juristes bénéficiant d’un privilège d’exclusivité dans l’accès à certaines archives publiques de l’État français est-elle une option pertinente scientifiquement au regard de l’état de l’historiographie et des questionnements actuels de la recherche ? Quels sont les difficultés et les pièges rencontrés par les historiens qui tentent de dégager une voie entre les stratégies du pouvoir politique, les témoignages des acteurs et les démarches militantes et journalistiques ? Quelle garantie, quels soutiens et quels moyens l’institution universitaire peut-elle apporter dans un contexte national où apparaissent certaines tentatives de remise en cause des libertés académiques ?
Ce texte propose quelques éléments de réflexion fondés sur une recherche en cours consacrée à l’étude des relations franco-rwandaises depuis 1973. Celle-ci s’intéresse notamment aux formes d’engagement des acteurs français avant, pendant et à l’issue du génocide ainsi qu’aux effets produits par les débats publics autour de la « question française » sur l’écriture de l’histoire. Cette réflexion a aussi été nourrie par plusieurs séjours de recherche de l’auteur au Rwanda entre 2017 et 2020 et par sa participation à quelques projets collectifs consacrés au génocide des Tutsi9.
Écrire l’histoire du génocide des Tutsi et du rôle de la France
Un défi lancé aux SHS ?
Les chercheurs qui travaillent sur le génocide des Tutsi du Rwanda n’ont de cesse de le répéter depuis plus de vingt-cinq ans : l’écriture de l’histoire du génocide constitue un véritable défi pour l’historien et pour les chercheurs en sciences sociales10.
Ce génocide, reconnu par la communauté internationale dès 1994, est en effet un événement hors norme, la concrétisation d’un projet politique de destruction totale de la population tutsi. Pensé et organisé par certaines élites politiques et intellectuelles rwandaises, ce projet se déploie avec une célérité inédite entre le 6 avril et le mois de juillet 1994. En moins de 100 jours, entre 800 000 et plus d’un million de personnes sont massacrées en raison de leur appartenance ethnique supposée, sans que la communauté internationale intervienne pour stopper les massacres. Milices, garde présidentielle, militaires des Forces armées rwandaises sont mobilisés aux côtés des services de l’État (administration, médias, voierie pour le ramassage des corps…) pour tendre vers la plus grande efficacité possible dans le crime11. Les massacres d’hommes, de femmes et d’enfants sont accompagnés de scènes de sévices, de viols et d’actes de torture témoignant du désir des génocidaires d’humilier, d’animaliser, de faire souffrir des victimes traquées jusque dans les marais où elles trouvent parfois refuge.
La compréhension d’un événement de cette nature interroge l’efficience des concepts, des méthodes et des questionnements habituels des sciences sociales. Comment comprendre que des centaines de milliers de civils aient pu participer à une telle entreprise de destruction totale de leurs collègues, de leurs voisins voire de leurs proches ? Comment approcher les motivations des tueurs et les différentes logiques qui ont motivé leurs actes ? Comment expliquer la passivité de la communauté internationale alors même que les alertes se sont multipliées dès le début des années 1990 et que des soldats belges et français, des journalistes occidentaux et des casques bleus sont témoins de l’ampleur des massacres ?
Si l’historiographie de la Shoah et des autres génocides offre des ressources aux historiens du génocide des Tutsi, ces derniers sont aussi confrontés à une série d’obstacles spécifiques qui rendent la tâche particulièrement ardue. En premier lieu, les archives rwandaises du génocide ont été partiellement détruites, détériorées ou dispersées du fait de la guerre, du pillage de certains bâtiments administratifs et de l’exil du Gouvernement intérimaire rwandais. Ensuite, le travail de collecte, d’inventaire, de protection et de mise à disposition des archives n’est devenu une priorité de l’État rwandais qu’à partir des années 200012. De ce fait, l’accès aux archives a été depuis 1994 – et reste aujourd’hui – un des enjeux cruciaux de l’écriture de cette histoire. Une autre difficulté notable réside dans l’existence de discours de négation qui relativisent le génocide, inversent les responsabilités ou dissimulent le crime de génocide en accusant le nouveau régime rwandais d’en être le principal responsable13. Les anciens génocidaires et leurs alliés tordent les faits, produisent de faux documents, livrent de faux témoignages, notamment devant la justice internationale, un engagement déterminé qui a régulièrement fait écran à la recherche de la vérité et à la réception des travaux des historiens par le plus grand nombre.
Une historiographie française marquée par la pluralité des approches
Consciente de ces difficultés, la recherche académique française - et francophone14 - s’est rapidement emparée du sujet. Des historiens, au premier rang desquels Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier, produisent des travaux de référence dans les mois qui suivent le génocide à l’aide de documents (presse écrite, rapports d’ONG, documents officiels rwandais…) et de témoignages collectés avant, pendant et à l’issue du génocide. Ils investiguent notamment la montée de la racialisation de la société rwandaise au cours du XXe siècle15, le rôle des médias extrémistes16 ou encore l’évolution du jeu politique des acteurs rwandais17. Leurs recherches dénoncent les explications simplistes données à l’époque par certains commentateurs qui mobilisent une grille de lecture interethnique liant les massacres à des haines ancestrales entre Hutu et Tutsi sur une terre d’Afrique dont le destin serait irrémédiablement celui de la violence et de la barbarie18. Par la suite, les historiens profitent aussi des acquis de l’historiographie de la Shoah pour enrichir les questionnements, les concepts ou encore les grilles d’analyse mobilisés19. La micro-histoire éclaire quant-à-elle certaines logiques génocidaires, à l’échelle d’une commune ou d’une préfecture20. Depuis une dizaine d’années, une nouvelle génération d’historiens tente d’enrichir la connaissance de l’après-génocide en étudiant les usages politiques de la mémoire, la mise en mots et en images du génocide ou encore les apports de la justice à l’écriture de l’histoire21.
Ces voix historiennes dialoguent depuis 1994 avec des chercheurs d’autres disciplines académiques, politistes, sociologues, anthropologues, psychanalystes, juristes et littéraires, français et étrangers. Des études de terrain ont permis la collecte de données empiriques (témoignages, photographies, objets…) documentant le passage à l’acte, l’effondrement des barrières psychologiques et sociales, l’embrigadement de la population22. Juristes, politologues et sociologues se sont aussi essayés à l’écriture de l’histoire, générant parfois des tensions qui portaient autant sur certains aspects discutables de leurs résultats que sur des rivalités disciplinaires, personnelles ou de réseau23.
Les productions historiennes cohabitent également avec de nombreux travaux de journalistes, de militants et d’observateurs de la région - certains constituant des références du fait du recours à de nombreuses archives inédites rwandaises, françaises, belges ou onusiennes collectées après le génocide24. La méthode historique doit ainsi se déployer dans un contexte où s’expriment une profusion de narrations, certaines faisant foi et constituant un véritable crédo sur l’événement, d’autres appartenant clairement à une démarche de négation du génocide, quand d’autres encore, frayent avec le négationnisme du fait des voies qu’elles explorent pour tenter de relativiser l’événement. Ajoutons à ces quelques éléments sur le contexte de production du récit historique le fait qu’au Rwanda même, un récit politique officiel s’est progressivement forgé pour établir les différentes dimensions du génocide, prouver le génocide, sa planification, son ampleur ou encore pour légitimer le rôle du Front patriotique rwandais (FPR) comme libérateur du pays25.
L’histoire du rôle de la France, une histoire délaissée ?
Au sein de cette historiographie, il faut accorder une attention particulière aux travaux qui portent sur « la question française ». Quelques historiens se sont en effet précocement intéressés à ce sujet et certains d’entre eux ont joué le rôle de « lanceurs d’alerte » avant même le génocide26. Les mêmes ont tenté d’avertir au moment de l’événement de la nature politique des massacres en cours27. Par la suite, ils se sont efforcés de remettre en perspective les choix français, de comprendre la nature des implications françaises au Rwanda et d’interroger les crispations politiques qui subsistent a posteriori28. Ils ont aussi pu apporter leur expertise lors de procès ou d’enquêtes diligentées en France par le pouvoir politique29. Cependant, les travaux historiens de référence sur le sujet restent rares30 et il faut reconnaître que ce chantier a été beaucoup moins investi par les historiens que par les journalistes, les militants, voire par des chercheurs d’autres disciplines31. Ainsi l’expertise historienne se voit-elle régulièrement accusée de ne pas avoir enquêté suffisamment rapidement sur la question française32.
Cette prudence semble, dans le cas du Rwanda, relever d’abord de facteurs liés aux temporalités et aux méthodes des pratiques historiennes. Un premier élément à prendre en considération est le petit nombre de chercheurs français mobilisés, en historiens, sur le sujet – depuis une quinzaine d’années, en France, moins d’une dizaine de docteurs en histoire travaillent ou ont travaillé sur le génocide des Tutsi. Ces derniers développent des enquêtes qui les ont conduits à devoir s’approprier un « terrain » difficile en apprenant le kinyarwanda, en comprenant les codes qui régissent la société rwandaise ou encore en créant la confiance nécessaire pour avoir accès aux archives publiques et privées rwandaises. Ils ont souvent choisi de privilégier les enquêtes consacrées au génocide lui-même, aux violences extrêmes et à la construction de l’ethnisme.
Ensuite, les conditions d’accès aux archives françaises – délais, classification, filtre de la mandataire de François Mitterrand – ont rendu et rendent encore les conditions de travail des historiens délicates et aléatoires. Le Code du patrimoine et la loi de 2008 fixent des délais de communicabilité dont l’échéance est de 50 ans dans le cas des archives comportant des intérêts fondamentaux de l’État en matière de sûreté de l’État, de politique extérieure, de sécurité publique ou qui sont concernées par le Secret de la défense nationale, ce qui est le cas d’une grande partie des archives « sensibles » sur le Rwanda. De nombreuses pièces bénéficient de la protection supplémentaire de la classification. Malgré les possibilités de dérogation et de déclassification, l’accès à ces fonds, dans leur complétude, reste extrêmement rare33 et les chercheurs essuient parfois des refus motivés de manière lacunaire (« atteinte aux intérêts protégés par la loi » ; « caractère personnel et confidentiel des informations ») sans qu’il soit possible d’évaluer la légitimité des choix effectués autrement que par des recours à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Face à des décisions qu’il considérait comme arbitraires, le chercheur de l’association Survie, directeur de recherche en physique du CNRS, François Graner, intéressé par les archives de la Présidence Mitterrand sur le Rwanda, a engagé, entre 2015 et 2020, plusieurs procédures auprès du Tribunal administratif, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil d’État. Légitimant les demandes de François Graner, la décision du Conseil d’État du 12 juin 2020 encourage l’administration des archives à veiller à un meilleur équilibre entre la protection du producteur et l’accès des usagers. Le Conseil d’État stipule en effet que le génocide des Tutsi revêt « un intérêt public majeur » et que « la protection des secrets de l’État doit être mise en balance avec l’intérêt d’informer le public sur ces événements historiques »34. Une décision qui devrait créer des conditions favorables à une évolution des pratiques des institutions d’archives sur les fonds consacrés au Rwanda.
De même, l’auteur de ces lignes a longtemps retardé son projet du fait des difficultés d’accès aux archives publiques de l’État français. Mobilisant les approches de l’histoire culturelle, il s’est d’abord intéressé à la médiatisation du génocide, au rôle des journalistes dans la fabrique de la mémoire de l’événement ou encore aux apports possibles des collections de presse et des archives audiovisuelles à l’écriture de l’histoire. À la suite du colloque international « Rwanda, 1994-2014 : récits, constructions mémorielles et écriture de l’histoire » organisé en novembre 2014, il s’est engagé dans la collecte des traces des engagements français, au Rwanda et en France, entre 1974 et les années 2000. Il s’avère que l’accès restreint aux archives publiques de l’État français peut être utilement compensé par les archives publiques rwandaises, des fonds d’archives d’associations ou d’ONG, le recours aux collections de presse écrite rwandaise ou à certaines archives privées. L’ouverture des archives de l’exécutif annoncée par François Hollande en 2015 aurait dû permettre la création d’un contexte encore plus propice à la mobilisation des méthodes de l’historien sur un tel sujet.
Marges de manœuvre des historiens et ingérences politiques
En ce début d’année 2021, le terrain reste sensible et il n’est pas sûr que les choix effectués en 2019 par le Président Emmanuel Macron facilitent les travaux des historiens sur le sujet.
Guerres de mémoires françaises : acteurs, logiques et enjeux
Un premier constat doit être fait. Malgré la distance temporelle qui nous sépare des faits, les résistances à la recherche de la vérité restent nombreuses, particulièrement en France.
Une difficulté persistante tient à la détermination de certains acteurs à mobiliser un large répertoire d’actions pour imposer leur récit de l’événement. Il peut s’agir d’anciens génocidaires et de négationnistes prompts à discréditer les chercheurs sur des blogs ou sur les réseaux sociaux. Il s’agit aussi d’anciens responsables politiques et militaires français dont les discours vantent, dans des cercles divers, les mérites des engagements français au Rwanda. Leurs motivations sont variées. Elles vont du souci d’éviter toute mise en cause personnelle et collective dans un crime juridiquement considéré comme imprescriptible jusqu’à la protection de l’image de François Mitterrand, de l’armée française et plus généralement de la France dans le monde. Production d’articles, organisation de conférences et de colloques, publication d’ouvrages, ces acteurs restent présents dans les espaces médiatiques, éditoriaux voire académiques35 et leurs discours bénéficient de soutiens jusqu’au sommet de l’État36.
Le ministère des Armées joue un rôle central dans cette défense de l’image de la France et peut être considéré comme un des « gardiens du temple », discret mais actif, sur la question rwandaise37. Ainsi, en 2019, le ministère des Armées organise-t-il une journée commémorative consacrée à l’Opération Turquoise et structurée autour d’un colloque et d’une exposition réalisée par l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ÉCPAD). Annoncé au dernier moment à la presse et fermé au grand public, le colloque est introduit par l’ancien chef d’état-major de François Mitterrand, l’Amiral Lanxade, en présence de la Ministre Florence Parly, et clos par l’actuel chef d’État-major des Armées, François Lecointre, lui-même ancien de Turquoise. Les quelques journalistes présents relatent les propos louangeurs tenus par le chef d’état-major actuel pour les soldats français et sa dénonciation des critiques faites à l’opération38.
Les anciens de Turquoise sont parmi les plus actifs et plusieurs d’entre eux ont publié leur témoignage pour défendre leur action au Rwanda39. Certains se sont regroupés, dès juin 2006, au sein de l’association France Turquoise dont un des objectifs est de « Défendre et promouvoir, par tous les moyens appropriés, la mémoire et l’honneur de l’armée française et des militaires français ayant servi au Rwanda »40. Dirigée par Jean-Claude Lafourcade, qui a commandé l’Opération Turquoise, l’association anime un blog, met en place des colloques41, lance ou accompagne des procédures judiciaires42 et effectue un travail de lobbying politique au sein des institutions françaises43. L’association, qui prétend travailler « à l’établissement ou au rétablissement de la vérité sur l’action de l’armée française », soutient une version très méliorative du rôle de la France et porte une vision du génocide qui centre l’ensemble des responsabilités sur Paul Kagame et le FPR. Ces interprétations des faits les conduisent à mettre en valeur des auteurs comme Pierre Péan, Charles Onana ou Judi Rever qui légitiment dans leurs ouvrages les mêmes thèses négationnistes développées depuis 1994 et qui tentent, par ailleurs, de discréditer les chercheurs et enseignants-chercheurs44. Défense de l’honneur de la France et relais de thèses douteuses sur le génocide des Tutsi se trouvent alors aller de pair. L’activisme de ce petit groupe d’anciens responsables militaires français – et les soutiens dont ils bénéficient au ministère de la Défense – expliquent sans doute, pour partie, les critiques portées contre la Commission présidée par Vincent Duclert à propos de son choix de faire abriter ses travaux dans les locaux de ce même ministère.
Une commission dans la tourmente
Lors de la 25ème commémoration, alors qu’il a renoncé à un déplacement à Kigali, Emmanuel Macron adopte plusieurs mesures symboliques de reconnaissance du génocide (réception pour la première fois à l’Élysée de l’association de rescapés Ibuka France ; mise en place d’une journée de commémoration officielle en France le 7 avril). Il choisit par ailleurs de nommer une commission d’historiens, de juristes et de personnalités qui bénéficient de privilèges importants au regard des conditions dans lesquelles s’effectue habituellement l’accès aux archives45.
Laissant à l’écart l’expertise académique française sur le génocide des Tutsi46, la commission est d’emblée confrontée à l’expression de doutes sur la légitimité de ses membres47 et aux interrogations portées par les historiens qui connaissent le dossier48. La commission fait aussi face à la démission d’une de ses membres49 puis à la réception critique de la note intermédiaire produite en avril 202050. S’ajoutent à cela, en octobre-novembre 2020, les accusations portées par certains médias français contre une des membres de la commission, Julie d’Andurain, Professeure à l’Université de Lorraine. À la suite de la révélation par Le Canard enchaîné d’un article publié en 2018 sur l’Opération Turquoise51, celle-ci se trouve suspectée de parti pris favorable à l’armée française et de sympathie pour les thèses négationnistes52. La tentative de Julie d’Andurain de mobiliser la profession des historiens contre ce qu’elle considère être « un lynchage médiatique » a contribué à révéler les ambiguïtés d’un texte de commande produit pour l’armée et qui déploie effectivement certaines des thèses classiques des courants négationnistes53. La polémique qui a suivi chez les historiens semble avoir renforcé les interrogations sur les liens entre la composition et les missions de la commission : dans quelle mesure la porosité d’une des membres à la rhétorique des négationnistes a-t-elle influencé le travail de la commission ? Comment expliquer le choix de cette collègue au détriment des spécialistes et était-ce en connaissance de cause ? Les problèmes identifiés par l’association Survie dans la note d’avril 2020, proche à certains égards du texte incriminé, ne sont-ils pas déjà une trace de l’influence de Julie d’Andurain sur les travaux produits ? L’ampleur des enjeux politiques et scientifiques et la nature des manœuvres politiques observées depuis plus de vingt-cinq ans ouvrent la voie à de nombreuses questions que la réaction du pouvoir n’a fait qu’attiser un peu plus54.
Est-ce aux commissions de dire l’histoire ?
Au-delà du cas de la commission présidée par Vincent Duclert, plusieurs commissions ont depuis 1994 tenté de produire des récits historiques. Qu’il s’agisse de la commission sénatoriale belge de 1997, de la mission d’information parlementaire française de 1998 ou de la commission rwandaise Mucyo dont le rapport a été présenté publiquement en août 2008, les pouvoirs politiques français, belges et rwandais ont initié, dans des contextes et selon des modalités variés55, des tentatives de prise en charge de l’écriture de l’histoire. Ces commissions ont eu la vertu de rendre publics de nombreux témoignages et surtout plusieurs centaines d’archives dont un certain nombre de documents déclassifiés. C’est aussi à la suite de la mission d’information parlementaire que circulent, dans un petit milieu intéressé par le Rwanda, les documents rassemblés par Françoise Carles et le corpus d’archives généralement présenté sous l’appellation « archives de l’Élysée »56. Ces commissions ont en outre suscité de nombreux débats et contribué à sensibiliser les opinions publiques à l’importance de l’événement et au rôle fondamental des choix des acteurs français dans le déroulement des faits.
La présentation du rapport de la commission française d’historiens sur le rôle de la France au Rwanda au printemps 2021 aura-t-elle la même influence ? Quels peuvent être ses effets sur les conditions de production du savoir historique sur le génocide des Tutsi et sur le rôle de la France ? Les spécialistes du sujet attendent moins du contenu du rapport que de la présentation de nouvelles pièces d’archives qui pourraient permettre d’approfondir les travaux déjà effectués. Ils espèrent surtout que ce rapport portera avec conviction une demande d’ouverture élargie des archives sensibles sur le rôle de la France. Si le pouvoir exécutif s’engageait sur cette voie et livrait une parole forte sur le sujet, cette ouverture garantirait le dynamisme de ce champ de recherche dans les années à venir, les chantiers à investir étant d’envergure. Si tel n’était pas le cas, nous pourrions nous retrouver avec un rapport faisant autorité, sans que celui-ci puisse être discuté sur une base scientifique, c’est-à-dire en bénéficiant du même niveau d’accessibilité aux archives que les membres de ladite commission. La marge de manœuvre des chercheurs s’en trouverait fortement réduite de même que la soumission à celles et ceux qui auront accédé aux archives. Prévenir un tel écueil exige, dès à présent, un engagement puissant de la communauté des historiens pour éviter qu’un tel piège se referme sur l’écriture de l’histoire.
Ces quelques réflexions sur les conditions de production du savoir historique montrent comment les historiens doivent affronter des difficultés liées à la fois à l’histoire du temps présent, à l’histoire des génocides et à l’histoire des crimes commis par l’armée française, en situation coloniale et post-coloniale. Cette conjonction d’obstacles exige un soutien sans faille de la part de l’institution universitaire – et des institutions de recherche – pour garantir aux chercheurs la possibilité d’enquêter librement et sereinement sur ces sujets sensibles57. Cela signifie à la fois valoriser le choix de telles thématiques de recherche, prévoir des financements pour que soient menées des enquêtes individuelles et collectives, accompagner les chercheurs pour leur permettre de dégager des temps de recherche conséquents adaptés aux terrains sensibles et enfin être prêt à défendre en justice les chercheurs qui seraient attaqués par des groupes négationnistes, des associations militantes ou par certains défenseurs de la raison d’État.
Au-delà de la position de l’institution – et donc des tutelles, il semble aussi nécessaire d’étoffer l’expertise académique afin de pouvoir répondre collectivement aux pressions venant de l’extérieur du monde académique et à l’existence de tentatives d’ingérence du politique. Il s’agit en effet de mieux défendre les normes de la discipline, de mieux garantir l’évaluation par les pairs, de mieux assurer le travail de médiation scientifique. Il s’agit certes d’un travail de longue haleine mais, les exemples récents des attaques subies par les collègues spécialistes de la Shoah en France et en Pologne58 montrent que les recherches portant sur des génocides restent durablement confrontées à des formes de réaction et de négationnisme et il est probable que, sur le Rwanda, le plus dur soit encore à venir pour les historiens.