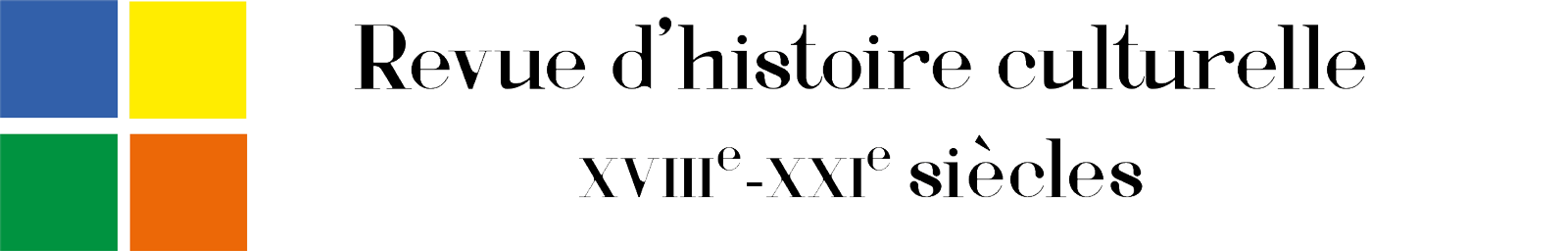Deux semaines après l’annonce de la mort soudaine et brutale de Dominique Kalifa, qu’il avait annoncé pourtant très discrètement en nous disant collectivement « au revoir » sur Twitter et Facebook, l’heure est encore pour beaucoup de ceux et celles qui furent et sont ses élèves à la sidération. Le choc est notre expérience commune, mêlée à une sorte d’incrédulité. Un adieu nous a pourtant été envoyé.
Je fais partie de la première génération des étudiants de Dominique Kalifa, issus des rangs de celles et ceux qui avaient préparé un DEA sous la direction d’Alain Corbin au sein du Centre de recherches en histoire du XIXe siècle. J’ai été sa première doctorante à soutenir ma thèse sous sa direction en 2005. Il a également été le président de mon jury d’habilitation à diriger des recherches en 2018 et j’ai été sa première ancienne doctorante à être élue professeure des universités. Je savais que cela comptait pour lui. Il aimait à le dire à ses nouveaux élèves. Cela faisait partie d’une éthique de la transmission, lui qui fut un disciple reconnaissant de Michelle Perrot et d’Alain Corbin.
Pourtant, je ne l’avais pas choisi au départ pour guider mes premiers pas dans la recherche. En entamant un DEA avec Alain Corbin, j’espérais pouvoir continuer ensuite en thèse avec ce dernier. Le DEA ou Diplôme d’études approfondies, aujourd’hui disparu, servait alors d’étape cruciale et préparatoire à la réalisation d’une thèse, puisque tout l’enjeu de cette unique année d’étude était, du moins dans la discipline historique en France, de prouver la faisabilité du sujet qu’on s’était soi-même donné. Tout avait été discuté en amont avec Alain Corbin. Mais j’ignorais alors que je faisais partie, avec d’autres, de ses derniers étudiants – ou peut-être n’avais-je alors pas pleinement intégré l’information. C’est donc grâce à Alain Corbin que ma route a croisé celle de Dominique Kalifa.
Lorsque je me suis inscrite en thèse sous sa direction au début de l’automne de l’année 2001, je ne le connaissais pas encore très bien – mais qui connaît-on vraiment ? J’avais entendu parler de sa thèse. Dans le séminaire qu’animait Alain Corbin, mais aussi Christophe Charle, à Paris 1 au Centre d’histoire du XIXe siècle, le livre issu de celle-ci était donné à lire et à discuter. Je l’avais entendu aussi, invité par Alain Corbin dans ce même séminaire. Mais ses objets de recherche – sur le crime, les Apaches ou le fait-divers – étaient éloignés de mes préoccupations d’alors : j’avais choisi de travailler sur les gares de chemin de fer au XIXe siècle. Lors de notre première rencontre, menée sous l’égide d’Alain Corbin qui nous avait présenté l’un à l’autre, il m’avait confié que le sujet l’intéressait beaucoup mais qu’il n’y connaissait rien.
J’avais toutefois suivi le séminaire de DEA qu’il co-dirigeait et co-animait avec Marie-Noëlle Bourguet en 2000 à Jussieu sur « les explorations, les enquêtes et les descriptions » tous les mardis soirs au 3e étage d’une tour sur la dalle des Olympiades. C’était alors un jeune professeur qui avait été élu à l’université de Rennes-2. À distance de cette époque et maintenant que j’y repense, je crois que c’est par lente infusion, à force de m’y rendre tous les mardis pendant quelques mois, que je me suis familiarisée avec ces notions et que j’ai les intégrées sans m’en rendre compte dans mon propre travail. C’est bien tout l’intérêt de l’existence de séminaires de spécialité.
Dominique Kalifa était un remarquable enseignant-chercheur, c’est-à-dire quelqu’un qui mêlait étroitement, presque inextricablement, l’enseignement et les questions de recherche. Sa scène première était le séminaire. Pour toutes celles et tous ceux qui ont assisté à ses séances, les souvenirs des échanges, des discussions animées mais toujours cordiales qui se terminaient en toute convivialité et simplicité dans un des cafés du coin restent des moments précieux qui tissaient du lien, marquaient les esprits et réchauffaient les cœurs. Chercheuses et chercheurs confirmés, apprenti.e.s historien.nes s’y mélangeaient sans fausse déférence.
Dominique Kalifa faisait-il de l’histoire culturelle ? Incontestablement, mais il en avait une conception très haute et une définition à la fois très large mais exclusive qu’il défendait avec une grande radicalité au prix, parfois, de certaines tensions dans le champ des historiens du culturel. Je me souviens en particulier, comme beaucoup d’autres collègues qui furent autrefois de jeunes doctorantes et doctorants au début des années 2000, du colloque de 2004 à Cerisy-la-Salle, co-organisé par Laurent Martin et Sylvain Venayre, pendant lequel s’étaient révélées avec beaucoup de clarté les oppositions entre différentes conceptions de l’histoire culturelle du contemporain à la française. Pour Dominique Kalifa, l’histoire culturelle qu’il appelait de ses vœux était alors une histoire des représentations sociales, expression qu’il a progressivement affinée pour retenir le concept plus flou mais qu’il espérait plus efficace d’imaginaire social. Elle ne se définissait pas par des objets d’étude présupposés plus « culturels » que les autres (une histoire de la littérature, du théâtre, du cinéma, de la peinture, de la danse ou des beaux-arts par exemple), souvent étudiés de manière classique ou traditionnelle, suivant une approche d’histoire en réalité plus politique, économique, sociale ou diplomatique que réellement culturelle, mais par une méthode et surtout un regard différent porté sur le social, pensé d’abord comme une construction culturelle à élucider.
L’historienne ou l’historien, qui n’avait jamais affaire qu’à des traces, devait selon Dominique Kalifa se transformer en enquêteur et travailler à déciller son regard. Car, pour accéder au social, pour comprendre une société dont le rapport à elle-même est opaque, il fallait en dénouer les ressorts : quels étaient les mots à l’usage des contemporains, leurs outils de décryptage, leurs ressources imaginaires ? Son travail sur le crime l’illustre magnifiquement. La « marque de fabrique » de Dominique Kalifa, ou sa spécialité peut-être, est la place qu’il a su faire parmi les sources légitimes de l’historien aux fictions populaires qui se gargarisaient d’histoires de crimes et qui étaient vendues et diffusées à des millions d’exemplaires. C’était un grand lecteur de Fantômas, et dans ses séminaires, il parlait fréquemment de Zigomar, de Nick Carter ou de Rouletabille – autant de personnages de fiction qu’il appréhendait comme des figures majeures de l’imaginaire social du crime au XIXe siècle. Il a également donné aux faits-divers et aux récits de presse, aux grands reportages et à la Civilisation du journal une place majeure pour comprendre le rythme et les mythes d’une époque. On lui a d’ailleurs parfois reproché de ne pas être un « vrai » historien, plongeant dans les archives qui seraient le « vrai » lieu pour faire de l’histoire. Il semblait privilégier les fictions et même les moins nobles d’entre elles. Le reproche est injuste et tombe à plat. Dominique Kalifa connaissait et maîtrisait parfaitement les archives. Mais elles étaient secondes, toujours secondes pour lui. C’est tout à fait manifeste dans Biribi qui est pour moi, et pour d’autres, un de ses maîtres-ouvrages. On y saisit avec beaucoup de force sa méthode : la méthode Kalifa. Ce livre est une enquête qui se nourrit au lait de la littérature de trottoir et de la presse grand public qu’il connaît bien. Il part d’un mot aux connotations obscures, perdues, mais gardées vivantes dans la littérature populaire de la Belle-Époque et de grandes enquêtes journalistiques publiées dans la presse entre 1890 et 1930 : « Biribi ». En redonnant de l’attention et une écoute à ces histoires minorées, marginalisées, déviantes, Dominique Kalifa ouvre alors l’accès à un imaginaire social puissant, très ramifié, qui communique avec celui de la pègre, des mauvais garçons et des Bas-fonds, un imaginaire agissant sur les consciences et capables d’ordonner un sens à des expériences qui ont marqué les corps et les chairs de milliers de jeunes hommes. Car « Biribi » est le lieu ou plutôt le non-lieu où se reflète la face sombre d’institutions majeures : un envers de la République fraternelle, de l’honneur militaire de l’Armée et des projets de colonisation. Cet univers dantesque n’est pas fictif : Dominique Kalifa a ouvert la piste qui permet aujourd’hui d’en savoir plus sur ces bataillons disciplinaires, ces prisons militaires outre-mer et ces dépôts de travaux forcés coloniaux dont le souvenir s’est perdu dans les archives de l’armée. Les inventaires de ces fonds lui rendent d’ailleurs hommage. Dominique Kalifa a permis de recomposer partiellement la géographie de cet archipel oublié et les méandres qui reliaient ces prisons du fin fond de l’empire colonial avec les affaires courantes de la métropole. Sans en rester aux descriptions fictives, il s’est attaché à restituer les moindres traces des expériences sensibles qui ont été vécues à Biribi, en s’approchant toujours plus près de la peau même de ceux qui subirent ces châtiments au loin. Imaginaire – pratiques – sensibilités – corps : tels étaient les graals de ce chercheur atypique.
Il avait encore beaucoup de projets personnels et collectifs, suivait de très nombreuses thèses, guidait de nombreux jeunes chercheuses et chercheurs qui sont aujourd’hui sous le choc, privés d’une écoute, d’un savoir vivant, d’une intelligence vive et d’une relation privilégiée qui n’est pas anodine, celle d’un mentor. Qu’il est dur aussi de dire « au revoir », Dominique Kalifa.