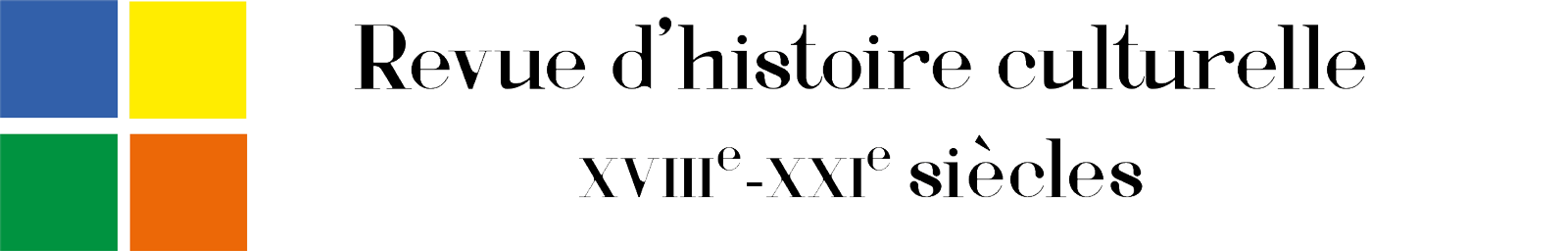En 1909, Maurice Renard, auteur des Mains d’Orlac1 et du Docteur Lerne, sous-dieu2, théorise dans un article à valeur de manifeste3 un genre littéraire méconnu, auquel il donne le nom de « merveilleux-scientifique ». Au sein de cette nébuleuse vont graviter un certain nombre d’auteurs de littérature dite populaire (Guy de Téramond, André Couvreur, Octave Béliard, Gustave Le Rouge, Maurice Leblanc, Jean de La Hire, etc.), jusque dans les années 1930, quand René Barjavel et Régis Messac donneront une impulsion différente à la « conjecture romanesque rationnelle4 ». L’intrigue des récits qui appartiennent à cette école se déroule dans le monde connu du lecteur, à l’exception d’une loi physique, chimique ou biologique qui est modifiée, extrapolée ou inventée pour formuler une hypothèse féconde : bien que les prémisses de cette dernière soient fausses, la suite du récit est conduite selon un déroulement logique parfaitement crédible. Guy de Téramond met ainsi en scène un homme au regard radiographique, après une contamination au radium5 ; Gustave Le Rouge envoie son héros sur l’inhospitalière planète Mars6, à bord d’un bolide mu par l’énergie psychique de milliers de fakirs ; Octave Béliard narre les ambitions démesurées d’un savant, auto-proclamé dieu d’une peuplade minuscule, née à la suite d’expériences en partition cellulaire7. Ces récits paraissent tant sous la forme de romans, chez Jules Tallandier, Pierre Lafitte, Ferenczi et Fils, et Albert Méricant, que sous la forme de feuilletons, dans les revues Je Sais tout et Lectures pour tous, ou encore dans la presse, dans Le Matin ou L’Intransigeant. Si la collection « Les Récits Mystérieux », éditée entre 1912 et 1914 par Albert Méricant, est celle qui se rapproche le plus d’une collection spécialisée, l’étiquette « merveilleuse-scientifique » n’a jamais été apposée sur le moindre ouvrage et les récits paraissent, relativement dispersés, sous la bannière des « romans d’aventures », « romans mystérieux » et autres « dossiers secrets de la Police », sans qu’aucune publication ou maison d’édition n’unifiasse le paysage. La redécouverte de ce pan littéraire, longtemps occulté si ce n’était le travail d’excavation de Pierre Versins, Francis Lacassin, Serge Lehman ou encore Jean-Luc Boutel, s’accompagne aussi du dévoilement de couvertures, illustrations, annonces dans la presse, et compositions de nombreux illustrateurs, parmi lesquels Maurice Toussaint, Charles Garabed Atamian, Henri Armengol ou encore Gino Starace.
Souvent qualifiée de « proto-science-fiction » ou de « science-fiction archaïque » puisque le merveilleux-scientifique est peuplé d’extraterrestres, de personnages de savants farfelus et de théories scientifiques aventureuses, il se démarque de la science-fiction américaine, florissante à la fin des années 1920, sur un point fondamental : il n’a, pour la majeure partie de sa production, pas pour ambition d’imaginer le monde de demain et ne se rapporte donc pas aux récits dits « d’anticipation ». Il n’invente, par ailleurs, que peu de récits de voyages dans le temps passé, et encore moins futur. L’anticipation n’est pas du goût de Maurice Renard, et elle prend des formes plus subtiles, celles d’un écho, d’une réverbération de la temporalité, tour à tour « optogramme » (dernière vision d’un défunt, imprimée sur sa rétine) ou « rétrovision » (visibilité du temps qui passe, sous une forme tellurique).
En se concentrant sur certains romans et feuilletons représentatifs, notre article entend mettre en évidence les spécificités de l’exemple français. Tout d’abord, plutôt que de se propulser vers l’avenir, ces écrivains construisent des univers contemporains crédibles, qui stimulent la sagacité du lecteur (1). Si le merveilleux-scientifique ne cherche pas à prophétiser l’avenir, il s’intéresse pour autant à plusieurs reprises à la visibilité du temps qui passe, au travers de dispositifs de « rétrovision » (2). Enfin, le merveilleux-scientifique se démarque aussi par sa manière d’approcher le savoir scientifique. Il explore les domaines dits « parascientifiques » ou « juxtascientifiques ». Le fakirisme, la télépathie ou l’invisibilité deviennent, dans ces fictions, des phénomènes scientifiques auxquels est donnée une explication vraisemblable, bien qu’erronée, proche du sophisme. L’exemple des optogrammes montre combien l’optique physiologique et la photographie rétinienne se rencontrent pour créer un inspirant mythe scientifique (3).
Ni prophétie, ni anticipation : dire ce qui pourrait être et non ce qui sera
La confusion répétée autour du domaine merveilleux-scientifique et de la science-fiction8 est dommageable à plusieurs titres. D’abord, elle a le défaut de tracer une ligne téléologique entre cet imaginaire scientifique et la plus tardive création américaine. Les termes de scientifiction (Amazing Stories, 1926) puis de science fiction (Science Wonder Stories, 1929), apparus sous la plume d’Hugo Gernsback, désignent en effet une école littéraire plus tardive, différente dans ses intrigues et dans son fonctionnement : revues estampillées, pulps, correspondance entre les auteurs, fandom, courrier des lecteurs.
Plus encore, la simplification qui voudrait que merveilleux-scientifique soit de la « proto-science-fiction » méconnaît l’utilisation spécifique que Maurice Renard fait de l’expression et son étymologie plurielle. Cet apparent oxymore lui permet, d’abord, de désigner la transformation du conte de fées en un « conte à structure savante9 » au début des années 1900. L’une des caractéristiques du récit merveilleux-scientifique, forme de merveilleux moderne selon lui, est de rendre concevables les adjuvants magiques du conte de fées (miroir magique, bottes de sept lieues, cape d’invisibilité, tapis volant, etc.), par l’action de la science. Ainsi, pour se rendre invisible, il n’y a plus à revêtir le chapeau du Prince Lutin, mais à s’exposer aux rayons W chez Pierre Adam. La bonne fée marraine troque sa baguette magique contre des boîtes de Pétri et des machines extrapolées. D’autre part, l’expression hybride souligne l’intérêt de ce mouvement pour les manifestations surnaturelles et parascientifiques, c’est-à-dire restées dans le vestibule de la science, car elles ne sont pas encore reconnues comme des phénomènes réels, bien que certains savants, tels Camille Flammarion et le couple Curie se prennent de passion pour les tables tournantes ou la métempsycose. L’appellation est en effet empruntée au physiologiste Joseph-Pierre Durand de Gros10, qui l’emploie, sans le trait d’union ajouté par Maurice Renard, pour désigner la normalisation du surnaturel et l’intérêt des savants pour la métapsychique11, explorée de manière scientifique. De même, le récit merveilleux-scientifique suggère que la communication à distance, la quatrième dimension ou les fantômes sont des phénomènes bien réels, auxquels la science n’a pas encore trouvé d’explication. Ce que ne peut faire la science, la fiction y parvient, proposant qu’un « idéoscope » lise les pensées, qu’un gaz mystérieux permette de voir des créatures invisibles ou qu’une machine ressemblant à un pianola fabrique des rêves.
Toujours pour affiner la distinction préalable entre science-fiction et merveilleux-scientifique, il faut souligner que le second ne prétend pas deviner l’avenir, avancer des prophéties, mais bien donner à penser le présent autrement. Maurice Renard disait vouloir « patrouiller en marge de la certitude, non pour acquérir la connaissance du futur, mais pour obtenir une plus grande compréhension du présent12. ». Ainsi, bien que lui et ses pairs mettent sous les yeux des lecteurs des perspectives inconnues et nouvelles (une rencontre extraterrestre, une greffe entre les espèces, un voyage dans l’infiniment petit), ils entendent, par un procédé d’analogie, donner matière à penser au lecteur, dans le présent. Ils sont tous, en effet, des adeptes des points de vue inhabituels, de manière littérale (placer le héros dans le corps d’un animal, en l’occurrence un bovin dans Le Docteur Lerne, sous-dieu de Maurice Renard, ou le doter d’une vision animale, comme le fait Guillaume Livet dans L’homme aux yeux de chat13) ou métaphorique (découvrir l’altérité en la présence d’extraterrestres invisibles dans Le Péril bleu14 de Maurice Renard, le dissemblant quand une frange de l’humanité est frappée d’anophtalmie car elle évolue dans des grottes souterraines dans La Cité des ténèbres15 de Léon Groc ou le différent, voire le terrifiant, quand l’environnement silencieux révèle la présence d’êtres vivants sur d’autres plans, dans Dans le monde voisin16 de Gabriel de Lautrec). La multiplicité des métaphores optiques développées par Maurice Renard, tout au long de ses textes théoriques17 (machine à silhouetter, vitrail, verre coloré, aquarium, lorgnette, etc.), montre bien que le récit merveilleux-scientifique s’apparente à un miroir déformant, qui donne à voir le monde présent de manière nouvelle, par l’action d’un ingrédient scientifique fantaisiste. En effet, si les auteurs s’inspirent des découvertes les plus récentes ou du domaine de la métapsychique, ils ne s’évertuent ni à anticiper, ni à prophétiser les avancées scientifiques et techniques et encore moins à faire de la vulgarisation scientifique. Ils aiment mieux utiliser ce tremplin pour l’esprit afin de repousser les limites connues et utiliser le roman comme une paillasse de laboratoire, propre à faire réfléchir le lecteur.
Dispositifs de rétrovision : observer une scène du temps passé
L’écrit merveilleux-scientifique se caractérise souvent par l’apparition soudaine d’une découverte ou d’une avancée scientifique qui donnent au héros la possibilité de voir, plus ou moins littéralement, son quotidien sous un jour neuf. L’un des procédés déployés par le modèle merveilleux-scientifique est celui de la « rétrovision » qui se présente sous la forme de médias imaginaires capables de rejouer des scènes du temps passé, projetées ou rendues visibles dans l’espace présent du protagoniste. Ce motif témoigne avec force du renouvellement de la tradition du miroir magique des contes de fées (capable de renvoyer une scène lointaine dans La Belle et la Bête ou de révéler l’âme de celui qui vient s’y mirer dans Blanche-Neige), au contact de l’optique physiologique et de l’astrophysique. Celui-ci ne se présente plus comme un adjuvant magique, mais alternativement comme une machine qui projette des scènes se déroulant en un autre lieu ; un projecteur qui rejoue des scènes du passé ; un œil humain qui conserve sur sa rétine une image criminelle. Il permet ainsi de mobiliser l’idée de « merveilleux instrumental18 », formulée par le théoricien Tzvetan Todorov, soit la manière dont les inventions scientifiques rencontrées dans les romans merveilleux-scientifiques s’apparentent à des objets non plus magiques, mais de conception scientifique.
Si quelques rares auteurs se sont essayés au motif du voyage dans le temps, popularisé par H. G. Wells, celui de la visibilité du temps passé, ou « chronoscopie », semble plus récurrent, en partie parce que les auteurs ont vraisemblablement lu des articles de vulgarisation portant sur la vitesse finie de la lumière, comme le laisse supposer une note dans les archives de Maurice Renard19. L’imaginaire merveilleux-scientifique s’empare de l’idée selon laquelle il est possible de capter dans l’espace des images du passé, à l’aide d’une machine optique. C’est un semblable imaginaire, nourri par les recherches autour de la vitesse de la lumière, que Camille Flammarion20 convoque dans son récit Lumen21. Flammarion utilise à son compte les lois de transmission de la lumière, qui supposent qu’il peut recevoir des images du temps passé. Lumen, situé sur la planète Capella, à très exactement soixante-douze années-lumière de la Terre, assiste à sa propre naissance, il y a soixante-douze années de cela. L’imaginaire merveilleux-scientifique, remarquable par son hybridité générique, comprend le fort potentiel qu’une telle extrapolation peut présenter dans le déroulement de ses intrigues.
Dans Le Maître de la lumière22 (1933), texte écrit en fin de carrière qui témoigne d’une justement hybridité générique puisque Maurice Renard fait du merveilleux-scientifique « mixte », où l’intrigue policière domine, le média temporel est utilisé pour résoudre une sombre histoire criminelle qui oppose deux familles ennemies, les Christiani et les Ortofieri. Il imagine que le « verre optique » d’une fenêtre, composé de « luminite », permet au héros de voir des images du passé — qualifiées de « merveilleuse réalité » — afin de résoudre le meurtre du quadrisaïeul du héros Charles Christiani, attribué à tort à l’ancêtre de la femme qu’il aime, Rita Ortofieri. La luminite enregistre tous les mouvements qui se déroulent devant sa fenêtre-monde. Elle est comparée à un « rétroviseur » ou à une « télévision », puisqu’elle jette un regard en arrière, sur ce qui s’est passé sous son reflet il y a un siècle. Pour composer son récit, Maurice Renard s’inspire autant de la chronoscopie flammarionesque (« Ainsi, quand nous regardons les étoiles, c’est leur passé que nous voyons », p. 1020) que des cernes sur les arbres vénérables, qui permettent de déterminer leur âge (« […] cette tranche apparaissait composée d’une infinité de raies très minces dont les unes étaient noires, d’autres lumineuses et d’autres plus ou moins claires ou obscures », p. 1021).
Tout comme le fait la chronoscopie, Maurice Renard prend appui sur l’idée du ralentissement de la lumière pour expliquer le phénomène : « Ces espèces de vitres retardent la lumière dans des proportions extrêmement remarquables, puisqu’il suffit d’une épaisseur relativement faible pour la retarder de cent ans. » (p. 1027). Pour recomposer la scène, il suffit de détacher délicatement les épaisseurs qui composent la plaque, afin de feuilleter les événements comme on le ferait avec un folioscope ou une pellicule cinématographique.
Maurice Renard, de même, imagine dans la nouvelle « Le brouillard du 26 octobre23 » (1912) que deux promeneurs découvrent que les ancêtres des hommes sont ailés, non pas à l’occasion d’excavations archéologiques, mais lors d’une promenade qui leur fait approcher une brèche dans le temps, un endroit particulier sur une colline qui permet de déambuler à l’ère préhistorique, dans une épaisse nappe de brouillard. Dans le cas présent, le miroir magique prend la forme d’une faille temporelle : les promeneurs sont capables d’interagir avec les êtres inattendus et même d’en abattre un spécimen.
Ainsi, les images du passé affleurent sous la forme de manifestations floues, aléatoires et mouvantes, en s’affichant directement au sein d’un brouillard, d’un nuage ou d’une matière calcaire. Dans Le Maître de la lumière, la luminite ressemble à du bois sombre ou à une plaque d’ardoise. Dans « Le brouillard du 26 octobre », c’est la bruine qui permet aux promeneurs de percevoir les ancêtres ailés de l’espèce humaine. Ce sont encore des ondes qui sont privilégiées par Léon Daudet dans Les Bacchantes24. Dans ce court roman, un savant invente un appareil capable de contrôler ce qu’il appelle les « ondes du temps ». Selon lui, les ondes « de la durée », longues et courtes, reviennent à date fixe et il est donc possible de les capter avec l’appareil en question, autant sous la forme d’images colorées que de traces sonores. Marcel Roland, de son côté, imagine qu’il est possible de révéler une scène, enclose dans la matière. Il ne s’agit plus de capter les ondes environnantes, qui conservent une trace du passé, mais de révéler les scènes inscrites dans la pierre. Dans sa nouvelle, « Sur le mur25 », le physicien René Chadal parvient à projeter sur un mur, à l’aide d’une machine de son invention qui utilise comme révélateur un corps chimique inconnu, une image du passé, qui est venue s’y inscrire. Le scientifique soutient en effet que le moindre de nos faits et gestes forme « une copie reproduite sur les objets voisins : pierres, étoffes, murs ». La projection révèle au malheureux savant les circonstances de la disparition de sa propre fille, noyée dans le lac voisin car elle était tombée folle amoureuse d’un ami du professeur resté sourd à ses avances.
Ces médias que nous qualifions de « chronoscopiques » sont capables de capter, puis de rejouer des images du passé, qui sont supposées flotter dans l’air sous la forme d’ondes ou être figées dans la matière, comme un film rupestre. C’est par l’utilisation d’un média composite, souvent peu explicité, héritier de la lanterne magique, que les auteurs merveilleux-scientifiques parviennent à rendre crédibles le mariage inventif entre vitesse de déplacement de la lumière et persistance des images.
Des optogrammes : rencontre entre science et métapsychique
Maurice Renard a déclaré dans une lettre à Jacques Copeau, alors critique à La Nouvelle Revue Française, « Je me défends d’anticiper, je prétendrais plutôt déborder, si j’avais la moindre prétention26. ». L’une de ses tactiques de débordement consiste à intégrer des thématiques qui n’auraient pas leur place dans la science, car elles relèvent de champs spéculatifs ou occultes. La constitution du motif littéraire des « optogrammes27 » est, à ce titre, un thème de choix pour illustrer la manière dont le corpus merveilleux-scientifique associe dans ses récits les théories scientifiques les plus récentes à d’autres phénomènes, non encore admis par la science, à l’image de son appellation qui greffe le merveilleux au scientifique par l’ajout d’un trait d’union28. Derrière, le thème des optogrammes29, en effet, se cache la conjonction de plusieurs phénomènes scientifiques et parascientifiques, ainsi qu’un héritage folklorique indéniable. L’optogramme s’inspire à la fois des connaissances technologiques du temps (procédés photographiques30), de l’optique physiologique (persistance rétinienne31, scotome, fonctionnement de la rhodopsine32), des fausses sciences (« photographie électrique33 » et prétendue inscription de la dernière image sur la rétine) et du folklore (inscriptions de la silhouette de la victime d’un foudroiement34). Ces multiples ramifications conduisent à une « réduction technologique », qui suppose, de manière syllogistique, que puisque l’œil fonctionne comme un laboratoire photographique et que certaines croyances soutiennent, que lors de meurtres, l’assassin se dessine sur l’environnement de la victime, alors il est crédible que l’image de l’assassin puisse venir s’inscrire sur la rétine de celle-ci35.
Tous ces événements qui ont permis la formulation, la consolidation et la dissémination de l’imaginaire optogrammologique (assimilation de l’œil à un « appareil photographique », compréhension du processus de persistance rétinienne, intérêt pour la « photographie électrique », intérêt pour l’iridologie, développement d’appareils optiques permettant d’effectuer un fond de l’œil ou d’aller étudier l’iris au plus près, tels que l’ophtalmoscope, conçu par Hermann von Helmholtz en 1850, et l’iridoscope, mis au point par Robert-Houdin en 1866) concordent à la formulation selon laquelle l’œil se présente comme un laboratoire photographique et qu’il peut, dans des circonstances précises (écarquillement, vif éclairage, puis pénombre) avoir été frappé et marqué par la dernière image qui s’est imprimée sur la rétine.
Plusieurs étapes marquantes construisent petit à petit la crédibilité du modèle optogrammologique. Dès 1863, le docteur William H. Warner réalise une série d’expériences avec des animaux d’abattoir, tentant d’apercevoir sur l’œil de l’animal abattu l’ultime vision qui s’est présentée à ses yeux. Le 8 février 1869, le docteur Auguste Vernois, président de la Société de médecine légale de Paris, évalue le rapport du docteur Bourion, qui prétend avoir photographié les rétines d’une femme et de son bébé, tous deux assassinés. Il affirme avoir fixé la dernière image aperçue par l’un et par l’autre : le coude du meurtrier et le chien de la famille. Le docteur Vernois reproduit près de dix-sept expériences sur un chien et un chat : il enlève les globes oculaires, sectionne la sclérotique, écarte l’humeur vitrée et photographie la rétine des animaux sacrifiés. Il contredit la validité de l’expérience et soupçonne même Bourion d’avoir contrefait l’image qui figure en couverture de la Revue photographique des hôpitaux : l’image aurait dû se présenter inversée ! Vernois fait partie d’une longue liste de sceptiques scientifiques qui soupçonnent la découverte des optogrammes de n’être, à ce stade, qu’une supercherie, voire même une fraude scientifique. Il faut attendre la fin des années 1870 et les travaux sur la photochimie de la rétine pour que la croyance pseudo-scientifique trouve une explication crédible, fidèle à l’idée de Maurice Renard et ses contemporains selon laquelle le surnaturel, l’étrange, ne seraient que de la science non encore comprise.
En 1876, Franz Christian Boll, professeur d’anatomie comparée et de physiologie à Rome, découvre la destruction de ce qu’il appelle le « rouge rétinien » (renommé ensuite « pourpre rétinien » ou « rhodopsine ») par l’action de la lumière. Il observe, dans les bâtonnets de la rétine d’une grenouille, la substance partiellement blanchie par la lumière. En présentant la rétine d’une grenouille à la lumière, il constate qu’elle passe du pourpre au jaune puis au blanc, quand la décoloration est totale. Plongée dans l’obscurité, elle se recompose.
C’est Wilhelm Kühne et son collaborateur Carl Anton Ewald, de l’université d’Heidelberg, qui étudient, quelques mois après, la réaction chimique de la rhodopsine et comment les substances chimiques se décomposent sous l’action de la lumière, une réaction semblable, selon eux, à un laboratoire photographique, à mesure qu’un ouvrier imaginaire renouvelle la couche sensible pour imprimer l’image suivante. En isolant la rhodopsine, ils comprennent que le pourpre rétinien peut être conservé s’il est gardé dans l’obscurité, près de 24h après la mort et que la mort physiologique n’entraîne pas la destruction de la rhodopsine. Le premier savant est surtout resté célèbre pour avoir cherché à étudier l’image qui est ainsi formée sur la rétine. Le protocole d’expérimentation est le suivant. Il faut d’abord placer les animaux dans l’obscurité totale pendant cinq minutes pour que la rhodopsine se régénère. Ensuite, exposer les yeux de l’animal à une image, pendant trois minutes, placée à 1m50 pour qu’elle se forme de manière nette sur la rétine de l’animal. Après énucléation, la sclère est placée, avec la rétine, dans une solution d’alun, chargée de fixer le pourpre rétinien, et laissée là pendant 24h – la période de fixation – dans l’obscurité ou éclairée grâce à une flamme de sodium. La plus célèbre partie de cette expérience rapporte que Kuhne a trouvé sur la rétine l’image des barreaux de la cage du lapin.
L’un des problèmes principaux posés par l’optogramme est son impossibilité à être imprimé. Le savant est donc réduit à faire des dessins, représentant ce qui est reflété dans l’œil du lapin énucléé. L’optogramme se présente, à ce titre, comme une image dite acheiropoïète, non faite de main d’homme, imprimée comme par miracle sur un support tel que le Saint Suaire ou le voile de Véronique et qui doit, en tout état de cause, être tenu pour vraie. Dans les récits merveilleux-scientifiques, l’optogramme est à chaque fois utilisé par les enquêteurs comme un élément de résolution, d’identification du criminel et non comme une simple preuve. Le plus souvent à leur dépens, les policiers interprètent cependant à tort l’image à charge, visible sur la rétine, peut-être parce qu’ils sont convaincus de l’authenticité de cette photographie oculaire par l’inscription chimique non interventionnelle et les nombreuses expérimentations qui sont faites à la même époque autour de la « photographie métrique » (Alphonse Bertillon et la reconstruction de la scène de crime, dite « photographie métrique » en 1903, Rodolphe A. Reiss et la « photographie judiciaire », qui permet de détecter des preuves imperceptibles à l’œil nu en utilisant l’appareil photographique comme un enregistreur multi-scalaire, en 190636). L’optogramme leur apparaît alors comme une manifestation objective37, bien qu’elle nécessite chaque fois, comme nous allons le souligner, l’intervention d’un médium optique, souvent déceptif. L’association de l’optogramme avec une image acheiropoïète ou avec une technique d’enregistrement forensique provoque la disparition du médium.
L’imaginaire de l’optogramme, qualifié de « véritables photographies rétiniennes d’objets extérieurs38 », a déjà été abondamment documenté par les historiens de la photographie ou en littérature de l’imaginaire39. Le premier texte d’obédience merveilleuse-scientifique consacré à la théorie des optogrammes paraît avant même la découverte du pourpre rétinien. C’est Auguste de Villiers de l’Isle-Adam, que Maurice Renard tenait en haute estime, qui popularise l’idée selon laquelle l’œil retient la dernière image aperçue avant la mort. Son récit Claire Lenoir40 retient notre attention à deux titres. D’abord, il traite le thème des optogrammes de manière fantastique, sinon fantasmagorique : ce n’est pas véritablement la dernière image qui est venue s’imprimer sur la rétine de la défunte, mais une vision terrifiante, née de ses angoisses et cauchemars puisqu’il s’agit d’une vision monstrueuse de son époux, tenant la tête de son amant, décapitée. Aussi, le texte est retravaillé par Villiers après la publication des travaux de Kühne et de Boll. La découverte du pourpre rétinien permet d’accréditer le phénomène physiologique dans la seconde version du texte et l’auteur prend soin de réécrire ce dernier au regard de ces nouvelles découvertes.
Jules Claretie propose en 1897 le texte L’Accusateur41, une nouvelle fois lié à la résolution d’un mystérieux assassinat. L’inspecteur Bernardet entreprend de tirer au magnésium des épreuves photographiques de l’œil de la victime, aidé d’un photographe du service d’anthropométrie. Observant de plus près, à la loupe, la face qui se dessine dans la rétine, il identifie l’ami de la victime. Le texte souligne la nature déceptive de l’image, la tromperie possible jouée par l’optogramme : ce visage aimé n’avait pas été vu en dernier parce qu’il avait tué la victime… mais parce que cette dernière tenait fermement un portrait dans sa main, avant de mourir !
Plusieurs manières de lire les optogrammes sont possibles et mettent toutes en scène des instruments optiques. Tribulat Bonhomet regarde avec un ophtalmoscope par ce qu’il appelle un trou de serrure, rentrant par effraction dans le regard de la défunte. Il n’a pas à mettre au point une formule nouvelle pour préparer l’œil du défunt ou réaliser les prises de vue adéquates. Il ne regarde non plus jamais directement la rétine, mais mobilise un outil optique faisant office de redoublement, de re-présentation (et donc de potentielle déformation) de l’image enclose. Bernardet, quant à lui, a recours à un outil d’enregistrement tel que l’appareil photographique. L’optogramme devient alors une preuve et l’usage de l’appareil photographique laisse penser que l’ « optographie » est destinée à devenir un outil de forensique au même titre que la « photographie métrique », la « photographie judiciaire » et « l’anthropométrie criminelle ». La loupe, comme outil de grossissement, sert aussi de mise en abyme de la démarche de l’enquêteur. Dans le cas de Villiers, résolument plus fantastique, l’optogramme sert de réceptacle aux idées noires et autres cauchemars qui habitent la cervelle du cobaye. Cette obsession autour de la machine optique est permanente dans les récits portant sur les optogrammes. Les médecins et enquêteurs détournent leurs outils quotidiens pour mirer l’image qui s’est imprimée sur la rétine42.
Ainsi, plutôt que d’associer l’imaginaire merveilleux-scientifique à la littérature de science-fiction telle qu’on la connaît aujourd’hui, notre article s’est efforcé de souligner combien cette école littéraire s’est construite au croisement entre les découvertes solides les plus récentes (découverte du pourpre rétinien et fonctionnement de la rhodopsine, vitesse de déplacement de la lumière, lesquels s’inscrivent dans une fascination généralisée pour les sciences de l’invisible) et les investigations métapsychiques de son temps (optogrammologie et chronoscopie). Le merveilleux-scientifique, jusque dans son appellation qui greffe ensemble le conte et l’écrit scientifique, la magie et la raison, mais se recommande aussi de l’emploi restreint qu’en fait Joseph-Pierre Durand de Gros (l’ouverture de la science à la parascience, à l’image de Jean-Martin Charcot qui intègre l’hypnose à sa pratique médicale de la Salpêtrière), témoigne à lui seul de la place de choix que le genre tient dans l’étude de la réception et de la transformation des savoirs scientifiques et techniques au passage du siècle. Plus encore, l’espace romanesque devient le lieu privilégié pour trouver des explications scientifiques, basées sur des procédés d’analogie, de translation avec la science réelle, et permet aux auteurs de signifier que dans leurs pages, un « idéoscope », un « condensateur des énergies animiques » ou une « machine à fabriquer des rêves », n’est jamais que de la science non encore comprise. L’auteur s’efforce de proposer une explication crédible, bien que parfois rapidement évacuée, puisque la découverte scientifique est prétexte à la mise en branle du récit, et non pas à un cours didactique, comme chez Jules Verne ou Paul d’Ivoi.
Fort de ce triple constat (caractère spécifique du concept de merveilleux-scientifique face à celui, plus large, de science-fiction ; hybridation générique entre la magie et la science ; intérêt contemporain pour des pratiques parascientifiques dont certains savants veulent prouver la véracité), l’article a tenu à souligner que le corpus merveilleux-scientifique, consolidé par Maurice Renard au début du XXe siècle, se présente plutôt comme un miroir déformé du temps présent, brandi à la face du monde connu du lecteur, pour lui en dévoiler une facette, un angle inédit. Cet article, enfin, souligne la nécessité d’approcher la somme merveilleuse-scientifique, que certains dédaignent pour son aspect populaire, non pas comme une lecture divertissante, mais plutôt comme un témoignage historique légitime du rapport de la société aux sciences et croyances du passage du XIXe au XXe siècle.