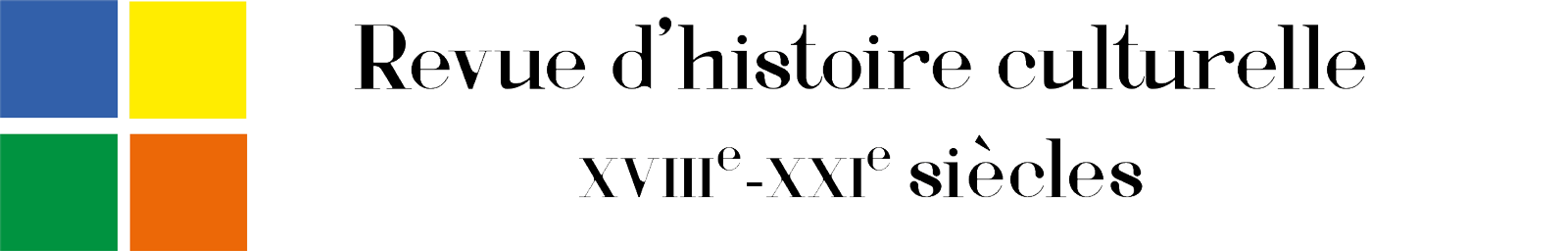Entassées à la diable sur des étagères en contreplaqué ou posées à terre, des piles, impressionnantes pour l’écolier que je suis, d’Historia, d’Historama et de couvertures bleu ciel du Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest : c’est là, dans la pièce du fond de la ferme de mon grand-père que j’ai appris à lire l’Histoire, pendant de longues après-midi. Un certain type d’histoire, mélangeant le récit de la bataille des Ardennes ou de Mers el-Kébir et l’érudition locale, d’articles sur la monnaie gauloise et les poteries mérovingiennes. On n’y parlait pas de Georges Duby ni de Fernand Braudel, de longue durée ni des « Caractères originaux de l’histoire rurale ».
Pourtant, dominant ce magma, il y avait bien mon grand-père, paysan aux mains blanches et franc-buveur. Quand il ne discutait pas avec le facteur, le boulanger ou l’épicier qui l’alimentaient en nouvelles du canton, lui qui ne sortait de sa tanière que pour aller à la chasse, il annotait au crayon les actes de vente et les manuscrits du XVIIIe siècle retrouvés dans les armoires, tout en récapitulant les diverses localisations possibles de la bataille de Vouillé (507). Je n’ai le souvenir d’aucune discussion particulière avec cet autodidacte érudit mais d’un climat, d’une ambiance faite de « piques à loup », de pistolets à silex et de vaisselle XIXe. L’histoire était là, dans les archives de cette maison enrichie par le commerce du charbon de bois de bourdaine, vendu aux armées du Roi, puis de l’Empereur, pour fabriquer la poudre noire. Une enfance dominée par les exploits de Cartouche et de Mandrin, la voix des orateurs de la Convention, les exploits de la Grande Armée et la geste de la Résistance résumée par la voix de Malraux devant le Panthéon.
Puis un grand trou, celui de l’adolescence, avant de céder au souffle épique d’une histoire racontée par un professeur de khâgne, élève, disait-on, de Charles Dullin. Une crinière, un costume et de grands bras moulinant l’air de la Révolution. L’histoire, érudite pourtant, se racontait sans note en bas de page, dans le suspens millimétré d’un cours se terminant sur une énigme et une adresse : « À la semaine prochaine ! ». Le retour à l’évidence des premières lectures d’enfance, Napoléon, Robespierre et Jeanne d’Arc version Péguy.
Deux figures aux cheveux blancs surplombent donc ce choix des dix-huit ans : ce sera l’histoire pour les saisons qui suivent. Une discipline bien loin des glorieuses batailles des livres d’enfance : les Annales sont passées par là. On compte, on liste, on fiche, on traque les plus petits individus là où, auparavant, je ne voyais que le soleil d’Austerlitz ou l’austère grandeur des discours des révolutionnaires de 89.
Plus rien n’est sûr : c’est le temps des hypothèses. Sur le chantier de restauration du château de Coudray-Salbart, forteresse médiévale investie le week-end par notre bande d’étudiants de la fac d’histoire de Poitiers, nous nous demandons avec notre chef de chantier, Jean-Jacques Lucas, pourquoi nous n’en savons pas plus sur cette impressionnante place-forte. Qu’en est-il de son histoire ? Qui l’a fait construire ? Pourquoi ces tours en amande ? Comment étaient-elles coiffées, quand elles sont aujourd’hui envahies de végétation à leur sommet ? Que conclure des marques de tailleurs gravées dans la pierre du XIIIe siècle ?
Ce travail du minuscule et du fragment, ce questionnement permanent, je le menais en parallèle dans les archives pour la maîtrise d’histoire médiévale, sur le recrutement des évêques de Saintes du XIe au XIIIe siècle. Grâce à mes professeurs, Georges Pon, Élisabeth Carpentier et surtout Robert Favreau, j’ai découvert le plaisir de la trace, de la signature au bas d’un acte de donation, seule preuve tangible du passage sur terre d’un prieur ou d’un chanoine. Nous sommes alors avant le règne de l’ordinateur individuel : le fichier manuel est notre meilleur ami. Des noms surgissent des archives : ils prennent aussitôt place sur les fiches à petits carreaux, pièces d’un puzzle toujours incomplet. À partir de ces bribes, il s’agit alors de redonner vie et généalogie à ces inconnus devenus pour soi aussi célèbres que Richard Cœur de Lion. Je deviens familier des Pons de Pons, de la famille d’Aigrefeuille et des Lusignan. La lecture parallèle de polars et du Nom de la Rose, dont la lecture nous a été conseillée par Georges Pon, nourrit une imagination de détective cherchant à ressusciter les morts. Je n’ai pas encore lu Michelet, mais je me sens bien dans la patience des salles d’archives, la lecture de la Patrologie latine de l’abbé Migne, de la Chronique de Saint-Maixent ou des cartulaires saintongeais.
Mais cette recherche, solitaire et obsessionnelle, n’a qu’un temps : il faut penser à l’enseignant qu’on voudrait devenir, préparer les concours, s’intéresser au Bas Empire, regagner la cour des Papes d’Avignon. Foutus papes qu’on échouera à faire revivre pour le lecteur lointain et anonyme de sa copie d’agrégation. Abandonnée, l’idée de thèse sur ces Lusignan qui, comtes de la Marche, ont réussi un temps à construire un « mini-royaume » entre France et Aquitaine anglaise et dont l’autre branche, partie pour les Croisades, fournira des rois de Chypre et de Jérusalem. Le sujet de recherche n’était pas choisi au hasard : il m’aurait permis d’unir ma passion pour le Moyen Âge poitevin et mon amour récent pour la Grèce, découverte à dix-neuf ans dans un voyage de khâgne. La Grèce à Pâques, quand les arbres de Judée fleurissent le site d’Olympie ou de Mystra et que les grands-mères en noir s’installent au bord des routes pour vous offrir des gâteaux à l’occasion de la grande fête orthodoxe. C’est la découverte de la Méditerranée, sous l’égide à la fois de Fernand Braudel et des poèmes de Yannis Ritsos, en noir et bleu, tragique et solaire.
Je ne serai donc pas historien. Après les concours d’enseignement, il est temps de préparer ceux des écoles de journalisme. En deux ans d’École à Lille, je romps avec l’histoire et semble oublier le passé. Seule l’actualité compte. Comptes rendus de courses cyclistes dans le Pas-de-Calais et d’élections locales dans le Dunkerquois prennent la place des chartes de donation aux abbayes. Le Moyen Âge s’éloigne.
La découverte de France Culture
Mais l’arrivée, par hasard, à France Culture change tout. Il faut à nouveau prendre de la distance avec l’actualité, refroidir la machine et ne pas s’en laisser conter par l’enchainement des dépêches. De nouveau les lettres, les écrivains, les historiens… Mais comment résoudre cette contradiction : avoir choisi un métier d’action, dont l’imaginaire est nourri de rapidité et de réflexes, tout en le pratiquant dans un lieu qui privilégie la distance et la réflexion ? L’arrivée de Jean Lebrun, journaliste-historien, à Culture Matin facilite l’adaptation : l’histoire n’est jamais inutile dès qu’il s’agit de comprendre l’actualité.
Je demeure néanmoins à l’écart du milieu des historiens. Pour être efficace, le savoir historique doit s’entretenir par des lectures régulières et des confrontations savantes. Ces dix années loin des séminaires et des colloques ont ensuite pesé dans la mise à jour des connaissances. De cette période surnage tout de même la commémoration du bicentenaire de la Révolution, les débats sur le « génocide » vendéen et la préparation du défilé des Champs-Élysées, ainsi que trois événements historiques : la Chute du Mur, la Guerre du Golfe et le conflit en ex-Yougoslavie. Chacun d’entre eux nécessite un retour constant au passé. Les journaux, que je croque chaque matin pour la revue de presse de France Culture, me rappellent l’épopée de Lawrence d’Arabie, la révolution d’Octobre et la bataille du Champ des Merles. Dans chaque actualité, le passé pointe son nez. L’histoire, chassée par la porte, revient par la fenêtre. Les journaux m’ont redonné le goût du passé que je cultive chaque mois, notamment, dans l’émission de Patrice Gélinet auquel j’ai proposé une « revue de presse historique ».
Je retourne alors à la Bibliothèque Nationale ou à la BPI pour y éplucher, sur microfilms, les Combat et les Franc-Tireur de la Libération ou les Figaro et L’Humanité de la guerre d’Algérie.
Quand, en 1996, le producteur de « L’Histoire en Direct » décide de quitter Culture pour Inter, je propose de le remplacer et de reprendre sa formule – un documentaire d’une heure sur un événement un lundi soir, puis, le lundi suivant, un débat en public.
J’y découvre, aux côtés des réalisateurs Mehdi El Hadj et Christine Robert, le bonheur de recueillir les souvenirs des témoins et de les confronter aux archives pour le documentaire. Mais aussi la difficulté de réconcilier témoignage et travaux des historiens : un ancien ambassadeur de France à Bonn croit avoir entendu une phrase que François Mitterrand n’a jamais prononcée au Bundestag ; un soldat de 14, devenu général, se souvient parfaitement du 11 novembre 1918 dans le camp de prisonniers de Poméranie où il était enfermé, mais s’en souvient si bien, qu’après une interruption, il nous répète, au mot près, les phrases qu’il vient de prononcer.
Cette expérience de recueil de témoignages pour « L’Histoire en Direct » est essentielle pour envisager la suite.
Apprenti-historien quelques années plus tôt, je n’avais jamais eu de cours d’historiographie. Je n’avais donc jamais vraiment réfléchi à la distance entre témoin et historien. Or, la fin des années 1990 était marquée par ce débat, à propos de la Seconde Guerre mondiale comme de la guerre d’Algérie. La table-ronde dite « de Libération », pendant laquelle historiens et camarades de résistance des époux Aubrac les interrogent de façon serrée sur l’arrestation de Jean Moulin, date de 19971. L’affaire Aussaresses, du nom du général qui admet avoir torturé en Algérie, débute dans le Monde fin 20002.
Naissance de « La Fabrique »
En janvier 1999, Laure Adler est nommée directrice de France Culture et me signifie rapidement son intention de supprimer « L’Histoire en Direct », tout en me confiant avec ma petite équipe une émission hebdomadaire d’histoire à inventer. Elle sera placée le lundi après-midi, à une heure où il n’y a quasiment pas d’auditeurs, selon ses propres mots.
La nouvelle direction m’engage à inventer des nouvelles formes. Je lui propose un titre, « La Fabrique de l’Histoire », et une formule assez complexe de lieux virtuels accueillant des rapports à l’histoire à chaque fois différents. Comme dans une fabrique du XIXe siècle, on y trouve des salles multiples, aux fonctions distinctes. Le « grand hall », c’est l’espace d’accueil dans lequel est introduite l’émission du jour ; dans la « salle des discours » sont proposés des grands discours enregistrés diffusés dans leur intégralité, sur lesquels se superposent par moment les souvenirs de celles et ceux qui y ont assisté. Le « salon noir » de Vincent Charpentier traite de l’archéologie, la « salle des mémoires » s’intéresse aux souvenirs de famille, tandis que le laboratoire accueille des chercheurs.
Alerté sur notre manque d’auditeurs, je choisis de prendre contact avec un réseau de professeurs d’histoire (H-français) afin de faire connaître cette émission auprès des principaux intéressés et de leurs élèves ou étudiants. L’accueil est chaleureux et me permet de valider certaines hypothèses improvisées sur les liens et conflits entre mémoire et histoire. Je découvre l’historiographie et tente d’en transmettre certaines règles avec des séries de débats titrés « Où en est l’histoire hongroise ? », « Où en est l’histoire italienne ? », « Où en est l’histoire en Espagne ? »…
Avec notre équipe (Séverine Liatard, Aurélie Luneau, Christine Robert, Véronique Lamendour…) nous testons formes et contenus avec beaucoup de liberté. L’expérience précédente de « L’Histoire en Direct » nous a donné envie de sortir de l’histoire contemporaine en renouant avec des périodes antérieures. Jacques le Goff et Michelle Perrot, tous deux producteur et productrice des « Lundis de l’Histoire » nous encouragent, tout comme Jean-Noël Jeanneney qui vient de créer « Concordance des Temps ».
Pour autant, chacun a sa personnalité : « Les Lundis » donnent l’occasion à deux universitaires de dialoguer sur une publication récente ; « Concordance » s’attache à comparer un phénomène contemporain avec son semblable dans le passé ; « La Fabrique » tente d’approcher les questions posées par l’écriture de l’histoire en partant de l’actualité.
France Culture est sûrement, à l’époque, la seule radio au monde à proposer chaque semaine trois émissions d’histoire.
« La Fabrique » au quotidien
Cinq ans d’émission hebdomadaire de « La Fabrique » nous ont aidés à tester des formes et à changer de thèmes. Entre 1999 et 2004, année du passage à l’émission quotidienne, les tensions entre mémoire et histoire ont donné lieu à de nombreuses productions scientifiques. Une fois les procès liés à la Seconde Guerre mondiale terminés, cette actualité n’a pas disparu, mais a été moins vive. Certes, les débats sur la guerre d’Algérie étaient toujours là, tout comme ceux liés au communisme et aux suites de la chute du mur de Berlin, mais une autre thématique, liée à celle-ci, s’est développée : les usages politiques et sociaux du passé.
La parution, en 2001, du livre de François Hartog et Jacques Revel sur les Usages politiques du passé3 puis le colloque organisé en septembre 2003 par des chercheurs de Paris I, Paris VIII et de l’Université de Provence, ont mis l’accent sur le passé comme réservoir d’évènements et de personnages mobilisables par les acteurs sociaux, culturels et politiques.
« La Fabrique » tirait d’ailleurs son titre d’un ouvrage, La Fabrique des héros4, dirigé en 1999 par les anthropologues Pierre Centlivres, Daniel Fabre et Françoise Zonabend. Ils y insistaient sur la re-création de héros nationaux au centre et à l’est de l’Europe à la suite de la chute de l’Union soviétique.
Pour une émission comme la nôtre, dont la mission était de faire le lien entre passé et présent, il semblait normal de se saisir ce thème et de le décliner radiophoniquement. Lors de notre passage en quotidienne, en septembre 2004, Perrine Kervran prit en charge, pour une saison, un feuilleton sur la multiplicité des commémorations ayant lieu en France chaque semaine. Il s’agissait pour nous, en ouvrant chaque jour « La Fabrique » par ces reportages, de marquer l’évolution thématique de notre programme.
Trois ans plus tard, à l’occasion de la préparation de la présidentielle, nous proposions une série d’entretiens avec les candidats sur leur imaginaire historique. Jean-Marie le Pen évoquait ainsi ses cours de primaire et « la Grande-Bretagne, maîtresse des mers » ; Marie-Georges Buffet la marche des femmes sur Versailles ; José Bové, qui a grandi aux États-Unis, la Boston Tea Party et la marche de Martin Luther King sur Washington ; François Bayrou, Cincinnatus.
En 2012, pour la présidentielle suivante, Jean-Luc Mélenchon raconta maints épisodes de la Révolution française, tandis que François Hollande évoquait le poids de la Première Guerre mondiale sur sa famille.
Par ce biais, et par d’autres, « La Fabrique » élargissait ses curiosités. C’est ainsi que fut créée en 2007 la table-ronde fiction mensuelle qui réunissait trois historiens : Pascal Ory, Arlette Farge et Fabrice d’Almeida. Au programme : un film, un roman, une pièce de théâtre et une BD, analysés par les outils de l’histoire.
Aux reportages, documentaires, chroniques et débats s’ajoutait ainsi la dimension fictionnée du passé.
L’actualité de la recherche, des colloques aux publications, était suivie régulièrement permettant ainsi de raccourcir le cycle entre les laboratoires et le public de France Culture, tandis qu’une attention toute particulière était portée à la jeune recherche.
Il nous semblait important, dans un contexte de baisse régulière des recrutements universitaires, de donner la parole à de jeunes chercheuses et chercheurs finalisant leur doctorat. Séverine Liatard avait d’ailleurs, dans la première version de « La Fabrique » hebdomadaire, suivi deux étudiantes en master d’histoire sur une année.
Elle remit en œuvre ce suivi sur le long cours en produisant un feuilleton d’une année et demie sur les métiers des archives, à l’occasion du déménagement des Archives Nationales.
Cette forme feuilletonnée sur 5 à 7 minutes hebdomadaires servit également de support à une autre productrice de « La Fabrique », Anaïs Kien, pour suivre le démarrage du centenaire de la Grande Guerre.
L’approche de la commémoration permit également à l’équipe de « La Fabrique », soutenue par la Mission, de produire des émissions à Sarajevo, au Sénégal, en Turquie et en Nouvelle-Calédonie, pour rendre compte de la dimension mondialisée de ce conflit.
Un des principes de l’émission était bien de se rendre le plus souvent à l’étranger pour évoquer les usages du passé dans chaque pays : un parcours sur les lieux de mémoire des présidents états-uniens lors de l’élection d’Obama ; la mémoire des indépendances africaines en 2010, grâce à une coproduction avec les radios francophones publiques ; le souvenir du génocide des Tutsis du Rwanda en 2009 puis en 2014. L’histoire tunisienne vue depuis Tunis pour les cinq ans des révolutions arabes de 2011 ou bien encore les trente ans de la chute du mur depuis Prague, grâce au soutien de l’Institut français.
En partenariat avec le mensuel L’Histoire, nous produisions d’ailleurs chaque mois une émission sobrement titrée « Fabrique mondiale ». Il s’agissait pour nous d’y recevoir, avec Valérie Hannin, directrice de la rédaction de ce mensuel de référence, un historien étranger de passage à Paris afin de rendre compte de son travail.
Nouvelles approches
En vingt ans d’existence, « La Fabrique » a assisté à la naissance et au développement d’approches nouvelles en histoire et en sciences humaines : histoire du genre, histoire du sport, histoire mondiale ou connectée, histoire des émotions, histoire environnementale ont ainsi pris leur essor en France entre la fin des années 1990 et le début des années 2020. La découverte de ces nouvelles lectures du passé a contribué à transformer les émissions de « La Fabrique ».
Tout en continuant à nous intéresser à l’histoire culturelle, à l’histoire ouvrière et à l’histoire politique, nous avons développé nombre de thématiques hebdomadaires autour du féminin et du masculin, des sexualités et de la condition sociale des femmes. Les productrices Séverine Liatard et Perrine Kervran y furent très fréquemment attentives, tout comme Anaïs Kien qui tira deux documentaires des travaux communs de Danièle Voldman et Fabrice Virgili.
La deuxième thématique émergente fut celle de l’histoire du sport, liée d’une certaine façon à la précédente ainsi qu’au développement de l’histoire du corps. Aurélie Luneau, productrice de « La Fabrique » dès l’origine, la porta avec conviction en suivant la première année du séminaire innovant de Sciences Po sur le thème et en produisant un documentaire pionnier sur la suppression du rugby à treize sous Vichy.
La lecture de L’Histoire du monde au XVe siècle5, dirigée par Patrick Boucheron, nous conduisit à nous intéresser à cette nouvelle grille de recherches. Les travaux de Sanjay Subrahmanyam, puis de Romain Bertrand, mais aussi de Jocelyne Dakhlya6 sur la « Lingua franca » montraient l’intérêt d’une histoire décloisonnée du national, attentive aux passeurs et entremetteurs des mises en contact entre plusieurs mondes.
Alertée par Jacques le Goff des travaux pionniers de Piroska Nagy sur les larmes au Moyen Âge7, « La Fabrique » suivit régulièrement les avancées de l’histoire des émotions avec, entre autres, les travaux de Damien Bocquet8 mais aussi ceux de Sarah Rey9 sur l’Antiquité. C’est également dans cette catégorie que nous nous sommes intéressés à l’histoire des parfums en Égypte antique ou dans l’Europe du XVIIIe siècle.
Dernier champ innovant, celui de l’anthropocène et de l’environnement. Le grand plaisir de la médiation historique est d’accepter d’être bousculé et surpris par des approches nouvelles. Nous croyons savoir, car nos professeurs et nos maîtres nous ont proposé, vingt ou trente ans auparavant, une lecture d’un fait, d’un évènement qui nous a séduits. Nous cheminons avec elle, elle nous accompagne mais il faut savoir nous en détacher et, une fois la surprise passée, accepter une nouvelle lecture. Quand le terme « anthropocène » a émergé au début des années 2010, il ne représentait rien dans notre imaginaire historique. Il a d’abord fallu le comprendre avant de l’adopter, comme cela avait été le cas, dix ans plus tôt pour « gender » ou pour « l’histoire connectée ».
Ce fut un bouleversement majeur que de lire en 2013 les premiers livres de la collection « Anthropocène » du Seuil, Carbon democracy de Timothy Mitchell10 ou Qu’est-ce que l’histoire environnementale ? de Gregory Quenet11. Accepter cette nouveauté nécessitait de reprendre à neuf certaines disciplines anciennes comme l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire de l’énergie, l’histoire de l’esclavage ou de l’économie.
Pourquoi donc s’intéresser à ces champs nouveaux ? « La Fabrique » est diffusée sur une antenne de service public et se doit, comme les autres programmes de France Culture, d’enrichir la vision que se font nos auditrices et auditeurs de la complexité du monde. Des savants produisent des connaissances validées par leurs pairs : il est normal d’en être les porte-voix en les transmettant au grand public. Des jeunes universitaires avancent des hypothèses qui bouleversent les acquis : nous devons les faire connaître. Des professeurs du secondaire manquent de formation permanente : nous pouvons leur permettre de mettre à jour les connaissances.
Plaisir d’écoute
Mais mettre en avant, avec sérieux, ces missions pourrait faire oublier l’essentiel : le plaisir d’écouter et de dire.
Dans une phrase sans doute apocryphe, Orson Welles affirmait que « l’avantage de la radio sur le cinéma, c’était un écran plus grand ». Faire de l’histoire à la radio, c’est choisir des archives sonores, les mêler à des sons d’ambiance et à des entretiens.
Ce tissage est le fruit d’un long travail entre le producteur et le réalisateur, garant de la qualité artistique du documentaire. Il commence, une fois le thème choisi, au moment de l’enregistrement. Pour faire du documentaire d’histoire, il faut aimer rencontrer les témoins dans leur intérieur : tandis que votre hôte va vous chercher le verre d’eau à la cuisine, vous regardez les bibelots sur les étagères, les livres de la bibliothèque – quand il y en a une – les gravures et tableaux au mur qui, sans constituer le portrait chinois de celui ou de celle que vous allez interroger, vous aiguillent dans l’épaisseur d’une vie.
Tel objet ramené de RDA ne dit-il rien de l’engagement communiste de votre témoin ? Cette collection complète de la revue Planète indique-t-elle un amour ancien pour les mystères de la science ou une passion pour l’art des années 1960 ?
Puis vient l’interview pendant lequel votre interlocuteur sème des petits cailloux blancs qu’il vous faut relever pour montrer votre connaissance du sujet qui vous amène et le sérieux de votre travail préparatoire. C’est à cette condition que vous pourrez – peut-être – obtenir une lecture nouvelle d’un évènement du passé. Pourquoi nombre de musiciens qui épousèrent la musique nouvelle que fut le rock n’roll venaient-ils du Maroc et de la Tunisie tout juste décolonisées ? Pourquoi le rédacteur en chef de Radio Luxembourg en 1968 a-t-il envoyé ses journalistes sportifs sur les barricades ? Comment le gouvernement Debré a-t-il réorienté les crédits publics de la construction HLM au pavillonnaire ? Comment l’État a-t-il réussi à acheter à bas prix le littoral languedocien impaludé pour construire la Grande Motte et Port Camargue ?
Au fil des entretiens, des petits faits renaissent. Ils sont portés par d’anciens directeurs de cabinet, heureux d’être interrogés plutôt que leur ministre, par des directeurs de coopératives agricoles, des bassistes de groupes yéyé, des révolutionnaires du tiers monde, des victimes de guerre ou de génocide.
Toutes et tous sont heureux de témoigner pour eux mais surtout pour leurs camarades, compagnons, amis qui ne sont plus là pour le faire. Ils vous offrent une parole dont ils savent qu’elle sera montée et agencée avec d’autres. Et vous font confiance pour ne pas les trahir. C’est au retour à la maison de Radio France, lors du montage, que, péniblement, nous devons faire le deuil de la plus grande partie des paroles collectées.
« On ne met pas un litre et demi dans un litre » m’avait dit mon premier réalisateur. Et il avait ajouté : « Il n’y a que toi qui sait ce qu’il n’y pas dans ton documentaire ». Une façon simple d’affirmer que le documentaire terminé devait, à lui seul, fournir le nécessaire à l’auditeur pour comprendre le sujet. Le reste, seule l’équipe de production s’en souviendrait.
Plusieurs fois, nous avons proposé à des jeunes historiennes ou historiens de prendre en charge un ou plusieurs documentaires. Certains ont accepté et se sont aperçus de la différence entre un travail universitaire et sa traduction médiatique : pas de note en bas de page, pas de bibliographie, pas de variante possible car le documentaire présente un récit linéaire et impose de faire des choix y compris entre plusieurs versions différentes des évènements relatés par plusieurs témoins. Pourtant de très beaux documentaires sont nés de ce mariage, comme celui d’Emmanuelle Loyer sur le sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet ou celui de Mathieu Flonneau sur « Paris et le défi automobile ».
Réseaux sociaux
En vingt ans, la fabrique de la radio et son écoute ont été bouleversées par le numérique. Nous sommes passés de l’enregistrement analogique sur bande à l’enregistrement et au mixage digital qui a allégé bien des procédures. Cette révolution technique n’a pas eu de véritable incidence sur la manière dont les invités des documentaires et des émissions en direct ont témoigné.
Mais l’autre bouleversement numérique, le développement du net et du podcast, a été essentiel dans la manière dont France Culture a élargi son audience.
Comme d’autres programmes de savoir et de connaissance (« Les Chemins de la connaissance »), « La Fabrique » a d’abord tiré parti de l’écoute instantanée sur le net (streaming). Progressivement, nous avons reçu des remarques et critiques de la part d’auditeurs lointains qui nous ont permis de décentrer notre regard. Un attaché à l’ambassade de Pologne nous téléphona ainsi pour nous faire part des critiques du gouvernement sur le titre d’une de nos séries consacrée aux camps d’extermination polonais. C’était effectivement une erreur : il fallait dire « les camps d’extermination nazis sur le territoire de l’ancienne Pologne. »
Cela nous a permis de comprendre que l’histoire est loin d’être une matière inerte et que son maniement est délicat, surtout quand on est écouté dans un pays à l’histoire compliquée (mais quel pays n’en a pas ?).
Pendant vingt ans, notre émission a fabriqué des matériaux pour l’histoire de notre temps. Elle a rassemblé des entretiens avec des témoins ou des historiens, des débats d’historiographie, enregistré des témoins méconnus d’évolutions sociales. Nous avons constaté le surgissement du passé dans le présent ou bien rendu compte des querelles d’écoles historiques (Première Guerre mondiale, guerre d’Algérie, Résistance…) ou d’interprétation.
Ce matériau est désormais entré dans les archives de l’INA et attend, à son tour, d’être écouté pour ce qu’il est : un témoignage du passé des années 2000 à 2020 à la radio.