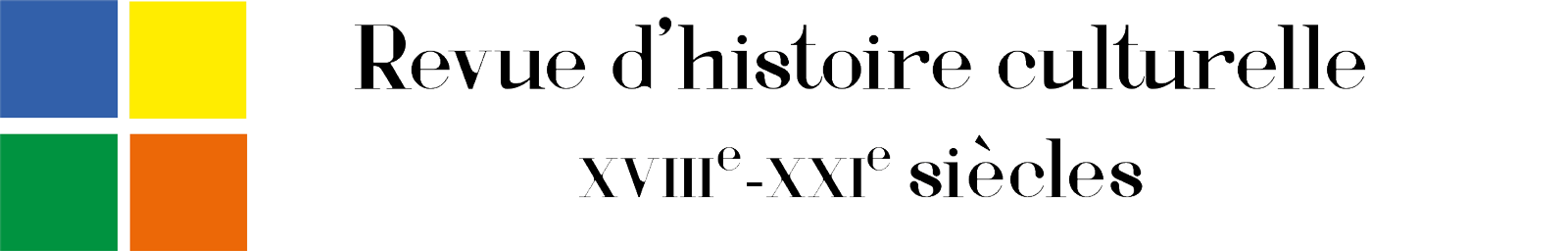Écrire sur les représentations saphiques au théâtre du XIXe siècle et du début du XXe siècle, c’est écrire sur l’ordre moral qui règne dans la société de cette époque car, si le saphisme a droit de cité dans la littérature fin-de-siècle1, il ne fait que des incursions très timides sur scène, même après l’abolition de la censure en 1906. En effet, contrairement à un livre qui ne touche qu’un individu à la fois, une pièce jouée devant un public important qui peut manifester bruyamment, a toujours fait peur aux classes dirigeantes. Les pièces censurées sont d’ailleurs publiées sans rencontrer de problème alors que les représentations inquiètent bien davantage : « Le mot prononcé et entendu par des spectateurs est jugé bien plus dangereux que le mot écrit et lu par des lecteurs »2.
L’objectif ici est de mettre au jour ces pièces méconnues, d’en comprendre les conditions de représentation et d’analyser les ressorts qui animent leurs auteurs, dans l’esprit d’une anthologie commentée. Aussi ce texte présentera-t-il quelques exemples de pièces, pris durant la période allant des années 1880 (1888, date de la première tentative de mettre à la scène un personnage lesbien) à la fin des années 1920 (1926, la représentation de La Prisonnière d’Édouard Bourdet qui bénéficie d’un accueil plus apaisé et rencontre le succès), qui décrivent la lente acceptation des personnages de lesbiennes sur scène, tout en montrant la filiation avec le théâtre érotique des XVIIIe et XIXe siècles et la littérature, car certaines pièces ne sont que des adaptations de romans ayant connu le succès.
Ce cheminement à travers des pièces écrites et/ou jouées met, la plupart du temps, en évidence les fantasmes d’hommes à la fois auteurs et spectateurs, dessinant l’archétype de la lesbienne, le tout fortement lesté de moralisme.
Le théâtre des fantasmes masculins
L’hypocrisie règne en maîtresse lorsque l’on aborde le sujet des amours entre femmes. Ce thème, en effet, a été largement traité par le théâtre érotique aux XVIIIe et XIXe siècles mais, réservé à un public choisi dans des lieux privés, il demeure peu visible. Les spectateurs sont en grande majorité des hommes et, si quelques femmes de l’aristocratie se mêlent au public masculin, elles se mettent un loup sur le visage et se cachent dans des loges « grillées » pour ne pas être reconnues… Ce théâtre propre à échauffer les sens est très apprécié à condition qu’il reste secret, clandestin. Publiquement, ces mœurs saphiques sont condamnées par la médecine et la morale ; intimement, elles provoquent une immense excitation. Ces pièces, écrites par des hommes, permettent d’assouvir leurs fantasmes.
Ainsi, le théâtre érotique se joue – quand il peut se jouer – dans les petites maisons galantes de l’aristocratie, dans les résidences de comédiens très fortunés3 ou dans des demeures jouxtant des maisons closes. Mais les relations saphiques ne sont, dans un grand nombre de pièces, qu’anecdotiques : dans Les Plaisirs du cloître (anonyme, 1773) ou dans La Bougie de Noël4 (Claude-François-Xavier Mercier de Compiègne, 1793), elles ne font que préparer l’innocente jeune femme (dans Les Plaisirs du cloître, une pensionnaire du couvent, et dans La Bougie de Noël une jeune mariée) à un rapport hétérosexuel scandaleux : scandaleux car ce sont les religieux et religieuses qui fournissent le plus gros contingent de personnages fornicateurs… Les rôles sont tenus soit par des hommes – très peu de femmes acceptent de jouer dans ces pièces –, soit par des marionnettes.
Des écrivains5 reconnus s’exercent à ce genre érotique pour ne pas dire pornographique, qui accorde une place aux amours saphiques : À la feuille de rose, maison Turque6 (1877) est certainement la pièce la plus connue de ce répertoire. Elle est sortie de l’imagination du jeune Maupassant (sous le pseudonyme de Joseph Prunier). L’intrigue est simple : un couple en voyage de noces, les Beauflanquet, débarque dans ce qu’il croit être un hôtel luxueux tenu par des Turcs alors qu’il s’agit d’un bordel… La naïveté de ces jeunes mariés donne lieu à tous les quiproquos. Et Mme Beauflanquet va goûter au plaisir saphique. Les quelques spectateurs réunis dans l’atelier d’un peintre ami sont prestigieux : Flaubert, Zola, Edmond de Goncourt entre autres. Ce dernier n’apprécie d’ailleurs pas cette représentation et, dans son Journal à la date du 31 mai 1877, en fait cette recension :
Ce soir, dans un atelier de la rue de Fleurus, le jeune Maupassant fait représenter une pièce obscène de sa composition, intitulée Feuille de Rose et jouée pour lui et ses amis.
C’est lugubre, ces jeunes hommes travestis en femmes, avec la peinture sur leurs maillots d’un large sexe entrebâillé ; et je sens quelle répulsion nous vient involontairement pour ces comédiens s’attouchant et faisant entre eux le simulacre de la gymnastique d’amour. L’ouverture de la pièce, c’est un jeune séminariste qui lave des capotes. Il y a au milieu une danse d’almées sous l’érection d’un phallus monumental et la pièce se termine par une branlade presque nature.
Je me demandais de quelle absence de pudeur naturelle il fallait être doué pour mimer cela devant un public, tout en m’efforçant de dissimuler mon dégoût, qui aurait pu paraître singulier de la part de l’auteur de la Fille Élisa7. Le monstrueux, c’est que le père de l’auteur, le père de Maupassant assistait à la représentation.
Cinq ou six femmes, entre autres la blonde Valtesse8, se trouvaient là, mais riant du bout des lèvres par contenance, mais gênées par la trop grande ordure de la chose. Lagier9 elle-même ne restait pas jusqu’à la fin de la représentation.
Le lendemain, Flaubert, parlant de la représentation avec enthousiasme, trouvait, pour la caractériser, la phrase : « Oui, c’est très frais ! » Frais pour cette salauderie, c’est vraiment une trouvaille10.
Deux gougnottes, frontispice de Félicien Rops, dans Joseph Prud’homme, Deux gougnottes, 1864
Exception majeure, une seule pièce11 est entièrement consacrée aux rapports lesbiens : Les Deux Gougnottes, dialogues infâmes. Si la première édition est publiée en 1864 sous pseudonyme, les suivantes indiquent le nom de l’auteur, Henry Monnier, le créateur du personnage de Joseph Prud’homme. Caricaturiste, dramaturge, Henry Monnier est un observateur des mœurs de son temps, et en écrivant cet acte dédié au saphisme, il continue, d’une certaine façon, à croquer la société de son époque, d’où le sous-titre de la pièce : « Scènes réelles de la vie de nos mondaines ». Les deux « gougnottes », Madame de Laveuneur et Madame de Frémicourt, se retrouvent dans le château d’une amie : leurs maris sont partis à la chasse, les laissant seules. Elles ne se connaissent que très peu et elles échangent des confidences. Le lecteur12 comprend très vite que leurs maris ne les satisfont ni sexuellement ni affectivement et qu’elles vont enfin trouver le plaisir l’une avec l’autre.
En traitant ces femmes de « gougnottes », et en indiquant dans le titre que ce sont des « dialogues infâmes », Henry Monnier se situe du côté des moralisateurs comme le font tous les auteurs qui traitent de ce sujet. Mais, contrairement à de nombreux autres textes de cette époque qui décrivent les bas-fonds et se vautrent dans la laideur et la vulgarité, Les Deux Gougnottes se déroule dans un milieu aristocratique, à rebours du discours des « médecins et des hygiénistes de l’époque [qui] croient que les pratiques érotiques entre femmes existent uniquement dans les maisons publiques13 ». Et surtout, les deux femmes ne sont pas « punies » pour avoir pris du plaisir. En ce sens, la pièce est tout à fait singulière car comme le souligne Nicole G. Albert, « les héroïnes saphistes finissent presque toutes par succomber à leur passion. Il y a celles qui périssent dans les flammes, celles qui se suicident, celles qui sombrent dans la démence, et celles qui expirent sous les coups de leur amante. Il y a encore celles qui meurent de consomption14…»
Paule Giraud, archétype de la lesbienne
C’est avec le roman Mademoiselle Giraud, ma femme15 d’Adolphe Belotque l’étude de la lesbienne issue d’un milieu privilégié fait son entrée officielle en littérature : ce n’est, bien sûr, pas la première fois qu’un portrait de lesbienne apparaît16, mais Paule Giraud est le sujet exclusif du roman. Elle est disséquée par l’auteur comme un cas clinique, comme une malade dont la pathologie révèle tous les préjugés et les conventions de l’époque. L’auteur démontre que non seulement les rapports saphiques détruisent la lesbienne, mais aussi ceux qui ont le malheur de l’approcher. Nulle description obscène comme dans le théâtre érotique : « M. Belot […] n’a troublé aucune innocence, en racontant la liaison monstrueuse de deux anciennes amies du couvent17 ». Le seul moment où le désir sexuel se manifeste concrètement est celui où le mari s’apprête à violer sa femme… et ce n’est pas un scandale à l’époque !
Car le roman Mademoiselle Giraud, ma femme est écrit du point de vue de l’homme : de l’auteur et du mari : il s’agit d’une longue confession de la part d’Adrien de C. à son camarade de l’école Sainte-Barbe qui a peine à le reconnaître : « Quelle pâleur répandue sur ce visage autrefois coloré, comme il s’était amaigri ! Des rides précoces se dessinaient au coin de se bouche, les cheveux étaient gris maintenant et un grand cercle bleuâtre s’étendait sous les yeux18 ». Si l’état physique du mari, repoussé par une épouse qui ne veut aucun rapport sexuel avec lui, est décrit dès le début du roman, on suit en revanche au fil des pages la lente dégradation de la lesbienne jusqu’au châtiment final : elle mourra emportée par une mystérieuse maladie, tandis que sa compagne, elle, sera assassinée par son mari – crime parfait puisqu’il fait semblant de se porter à son secours alors qu’elle se noie. Le lecteur de l’époque doit ressentir du soulagement : la morale est sauve car il ne peut y avoir aucune issue heureuse à l’amour entre femmes, à l’inverse de ce que montrait la pièce érotique Les Deux Gougnottes.
Couvrez ce « vice » que je ne saurais voir …
Émile Zola avait écrit dès 1870 un article sur Mademoiselle Giraud, ma femme19. Il y condamnait les rapports saphiques. S’il est ensuite revenu sur sa prise de position, il ne tient pas à s’exprimer publiquement sur l’homosexualité comme il l’avoue plus tard dans la préface à Tares et poisons. Il y explique avoir reçu un texte anonyme intitulé Roman d’un inverti mais reconnaît ne pas avoir osé « utiliser ce manuscrit20 » : « J’étais alors aux heures les plus rudes de ma bataille littéraire, la critique me traitait journellement en criminel, capable de tous les vices et de toutes les débauches…21 ». Zola n’en fait pas moins preuve de compassion, même si, et en cela il suit le discours médical dominant22 – il s’agit d’une préface à un livre médical –, il « pathologise » l’homosexualité et considère qu’« aucun sujet n’est plus sérieux, ni plus triste, qu’il y a là une plaie beaucoup plus fréquente et profonde qu’on n’affecte de le croire, et que le mieux, pour guérir les plaies, est encore de les étudier, de les montrer et de les soigner 23 ».
Si la littérature fin-de-siècle s’est largement emparée du sujet, le théâtre – toujours soumis à la censure24 – est encore extrêmement prudent. Une seule pièce en traite, La Fin de Lucie Pellegrin de Paul Alexis, dont Émile Zola suit attentivement la représentation pour savoir si, au Théâtre-Libre, « il devenait possible d’oser ce qui dans la littérature ne valait plus comme au temps des Fleurs du Mal de poursuites devant les tribunaux25. » André Antoine a risqué cette tentative car les critiques littéraires ont une certaine mansuétude pour les « ébats lesbiens car deux femmes s’y livrant ne sont pas laides, l’opération analogue pratiquée par deux hommes est tellement grotesque et sale qu’on ne saurait la contempler26 ».
Ce ne fut pas le cas des critiques de théâtre car la mise en scène par André Antoine de La Fin de Lucie Pellegrin au Théâtre-libre en 1888 « souleva l’indignation27 », ce qui stoppa net toute velléité de reprendre ce type de sujet. Pourtant, Antoine avait programmé la pièce « en fin de soirée pour permettre aux spectateurs pudibonds de quitter la salle28».
La pièce de Paul Alexis (tirée d’une nouvelle du même auteur) met en scène deux personnages de lesbiennes : Chochotte et Lucie Pellegrin. Cette dernière rompt la relation lorsqu’elle découvre que Chochotte la trompe. Seule l’avant-dernière scène met en scène les anciennes amantes : Lucie mourante se laisse bercer par les promesses de retour de Chochotte : « Ah ! ma bonne Chochotte ! Me voilà tout à fait guérie 29! ». La volonté d’Alexis n’est certainement pas de faire l’apologie de l’homosexualité : il a rendu le personnage de Chochotte odieux car il n’a pas l’intention « de mettre réellement le gougnottage au théâtre30» : il « semble [à Alexis] que ce n’est ni le lieu, ni le moment, leur vice est une chose au passé, la maladie a purifié31 Lucie32. » Les précautions prises par Paul Alexis (il a ajouté quelques phrases pour « adoucir » la dernière scène) ne suffisent pas à calmer la critique, qui se déchaîne. Francisque Sarcey menace Antoine :
Je ne suis pas plus prude qu’un autre mais je déclare très nettement à M. Antoine, que s’il devait nous donner encore une pièce de ce genre, nous sommes un certain nombre qui préférerions ne plus mettre les pieds dans son théâtre. Il sait très bien que l’art n’a rien à voir avec ces ordures. Je plains les actrices qui se sont crues obligées d’accepter des rôles où la femme est traînée dans la fange. C’est le vice ignoble, sans un rayon de gaité ou de poésie qui en illumine la laideur.
O naturalisme ! Que d’horreurs on écrit en ton nom33 !
Dans La Fin de Lucie Pellegrin, il s’agit pourtant d’une peinture des bas-fonds, ce qui permet à l’auteur de suggérer au public l’amalgame entre homosexualité et « fange » comme l’avait fait Balzac avec le personnage de Vautrin. Paul Alexis, en plaçant son histoire dans le Bas Montmartre, tente de rassurer son public : l’homosexualité ne peut être que « la caractéristique crapuleuse d’une sous-humanité asociale, exclue de la communauté, refoulée au fond de ses bagnes où, condamnée par les lois divines et humaines, elle confirme sa mise hors circuit par des pratiques ignominieuses34 ». Mais sur la scène qui doit, pour de nombreux critiques, être préservée de tout sujet « vulgaire », ce type de personnages, même réprouvés, n’a pas encore droit de cité, et les scandales sont au rendez-vous chaque fois qu’un auteur dramatique tente d’aborder ce sujet.
Gabriel Mourey, qui avait donné sa pièce Lawn tennis35 à Antoine, en fait les frais : bien qu’acceptée au Théâtre-libre et distribuée (Antoine devait jouer le rôle du mari, Georges), la pièce n’est finalement pas montée. André Antoine s’en explique dans une lettre à Gabriel Mourey en date du 26 mai 189136 :
Mon cher Mourey,
Ainsi que vous avez pu en juger vous-même aujourd’hui, pendant la lecture de votre acte, Lawn-tennis, aux interprètes que nous avions choisis, il se produit un incident curieux et dont je ne connais pas d’exemple. C’est-à-dire que votre pièce, possible à la représentation entre intimes, n’est pas jouable devant un public.
Vous avez vu vos comédiens eux-mêmes tout interloqués de la hardiesse et de la violence de votre conception. Je ne pense pas, après cette épreuve, qu’une salle de douze cents personnes puisse accepter avec sang-froid une situation aussi singulièrement anormale et passionnée. Rappelez-vous la première de La Fin de Lucie Pellegrin.
J’avais éprouvé, je ne vous l’ai pas caché, du reste, à la lecture de votre manuscrit, une très forte sensation d’art et je m’étais laissé séduire par la grâce, l’élégance et la littérature de Lawn-tennis. J’ai reçu votre pièce et elle sera représentée sur le Théâtre-Libre si vous l’exigez.
L’exigerez-vous ?
Si oui, nous courrons simplement le danger de faire fermer le Théâtre-Libre sur un gros scandale qui sera bien vite exploité par qui vous savez, et que vous ne recherchez en somme pas plus que nous. […]
Je vous fais juge et vous resterez le maître de la situation. Si vous le voulez tentons l’aventure, mais réfléchissez bien aux risques que pourrait courir une maison dont tous vos amis ont besoin et envers lesquels je suis comptable. […]
Bien vôtre. A. ANTOINE.
La pièce est plus audacieuse que la précédente car elle se situe comme le roman de Belot dans un milieu aristocratique : le lawn-tennis (partie arrière d’un court de tennis) ainsi que les noms à particule M. de Chanteilles, Mme de Luz indiquent la classe sociale. Camille et Élaine, les deux héroïnes, ont été élevées ensemble, ne se sont jamais quittées jusqu’au mariage d’Élaine avec Georges : c’est la première fois qu’elles se revoient depuis la cérémonie. Les deux femmes lors de cette belle après-midi d’été ont des comportements étranges. Élaine rabroue constamment son mari : « Tu passes ton temps à te mettre des idées en tête. Je ne souffre pas, je n’ai rien… rien… Je suis très bien… comme d’habitude… ». Quant à Camille, elle rejette durement un prétendant en lui criant qu’elle ne lui dira jamais ces trois mots « je vous aime ». Georges profite de la présence de Camille qui est « la meilleure amie » de sa femme pour tenter de comprendre qui est « la présence invisible » qui s’invite dans son couple : il ne pense, bien sûr, qu’à un homme qu’elle aurait précédemment aimé et Camille se retient de lui avouer qu’Élaine « fut à elle avant d’être à lui ». C’est enfin la rencontre tant attendue entre les deux protagonistes : « Une force irrésistible pousse Élaine vers Camille » et permet à cette dernière de libérer les paroles d’amour qui l’étouffaient. Rien n’est caché au lecteur de la liaison passionnée qu’ont entretenue les deux femmes. Mais Élaine – même si l’on comprend qu’elle aime toujours Camille – veut tourner la page : elle s’est mariée pour retrouver une « normalité » et oublier cette liaison « contre nature » – « tu m’as sali l’âme », « je ne m’appartiens plus : je suis mariée » –, tandis que Camille, elle, veut retrouver son amante. Le coup de grâce lui est porté lorsqu’Élaine lui criera : « Tu me fais horreur !... Va-t’en ! Ne me touche plus… Je suis enceinte ! ». Alors Camille, hors d’elle, l’étrangle.
Dans cet acte dramatique, Gabriel Mourey a franchi les limites de la « bienséance » théâtrale de l’époque : les deux lesbiennes appartiennent au meilleur monde et pas aux bas- fonds, elles évoquent sans ambiguïté une liaison amoureuse et sexuelle, et la pièce se termine par un meurtre. Même si Mourey « charge » celle qui revendique cet amour lesbien en la transformant en meurtrière, il n’en a pas moins donné une humanité douloureuse à Élaine et Camille et montré la profondeur de leur attachement : Antoine n’avait pas tort, la critique se serait déchaînée et aurait à coup sûr entraîné la censure.
De Claudine à Paris à Rêve d’Égypte
Willy et Colette ont fait paraître en 1901 le roman Claudine à Paris, deuxième opus de la série des Claudine. Le livre connaît le même succès que le précédent, Claudine à l’école. Dans ce roman, les amours entre Melle Sergent et Aimée, puis entre Luce et Claudine, sont racontées de façon naturelle, à l’opposé du ton moralisateur et culpabilisant employé par Arthur Belot. Il n’est pas inutile de rappeler que les Claudine sont écrits par Colette (plus que par Willy) à partir de ses propres souvenirs et de sa vie.
Dans Claudine à Paris, la jeune fille raconte à son neveu homosexuel son aventure avec Luce, et celui-ci se pâme à l’écoute du récit :
Mon « neveu » est dans un bel état. […] Il ne me regarde plus, il bat des cils, il a les pommettes tachées de carmin et son joli nez vient de pâlir. […] Il relève les cils, il tend la tête davantage, et implore passionnément : « Après, Claudine, après ? ». Ce n’est pas moi qui l’émeus, pardi, c’est mon histoire et les détails qu’il espère 37.
Le roman sera adapté à la scène par Lugné-Poe et Charles Vayre et monté aux Bouffes Parisiens en 1902 avec Polaire dans le rôle principal. La personnalité de Claudine est totalement édulcorée : tout ce qui a trait aux amours saphiques a été supprimé. Ne reste plus qu’une jeune fille très « convenable » que renierait la Claudine à l’école :
Toute ma liberté me pèse, mon indépendance m’excède. Ce que je cherche depuis des mois… depuis plus longtemps, c’était sans m’en douter un maître… Les femmes libres ne sont pas des femmes38 ! ...
Il n’est pas très étonnant que la pièce n’ait pas été publiée du vivant de Colette39. Car Colette se sépare de son mari Willy en 1906 et se réfugie rue Georges-Ville chez la Marquise de Morny40, elle-même divorcée du marquis de Belbeuf :
Il y avait rue Georges-Ville de brillantes et joyeuses réceptions, des dîners en costumes où, dès les hors-d’œuvre, on se battait à coups de roses, de table en table. Après le dessert, on s’enlaçait selon les sympathies et les préférences de sexe. Si ce n’était pas exactement l’orgie, c’était la bacchanale […]41.
Missy – surnom donnée à la marquise – ne cache pas ses préférences sexuelles et aura une longue aventure avec Colette ; cette dernière en fera le personnage de la Chevalière dans Le Pur et l’Impur. Mais ce qu’elle décrit dans ses œuvres littéraires n’aura pas d’équivalent au théâtre.
Le 3 janvier 1907, éclate le scandale du Moulin Rouge : ce soir-là a lieu la première représentation de Rêve d’Égypte, pantomime de Vuillermoz, qui a été le « nègre » de Willy. L’histoire est sans grand intérêt : un égyptologue trouve la formule magique pour ressusciter les morts et tombe amoureux de la momie qui va sortir de son sarcophage : après avoir déroulé ses bandelettes et dansé langoureusement, elle se jette dans ses bras et l’embrasse longuement. L’égyptologue est joué par la Marquise de Morny, et la momie par Colette qui porte encore, sur l’affiche, le patronyme Willy. Bien avant la fin du spectacle, le public se déchaîne :
Dès le moment où sous le complet marron on a reconnu l’ex-Mme de Belbeuf, les sifflets partent de tous les coins, les cris retentissent, les hurlements se font entendre sans discontinuer. Pendant le quart d’heure que durera cette pantomime, le tumulte n’arrêtera pas une minute et les interprètes tenant tête à l’orage continueront leur jeu avec un entêtement digne d’une meilleure cause. Le tapage redouble lorsque Colette Willy, s’animant dans son sarcophage, vient mimer une scène d’amour avec sa partenaire Mme de Belbeuf. On crie : « À la porte ! » sur l’air des Lampions. On profère des injures que nous ne pouvons écrire ; de deux premières avant-scènes des dames jettent sur la scène des projectiles variés, voire des coussins ; toute la salle, debout, conspue les deux interprètes en un dernier élan de désapprobation42.
Le compte rendu du journaliste est précédé d’une condamnation solennelle du directeur du Figaro, Gaston Calmette : « Suppose-t-on que la moralité de Paris soit tombée si bas qu’il puisse indéfiniment supporter des spectacles comme ceux que l’on impose depuis trop longtemps à sa tolérance ? ». Le spectacle est interdit dès le 4 janvier par le préfet Lépine, ce qui provoque « le soulagement pour la conscience des honnêtes gens43». Mais si les représentations sont interrompues, il n’y a pas de poursuites judiciaires.
Ce n’est pas le cas pour le spectacle Griserie d’éther, donné l’année suivante au Little Palace :
Par contre, le tribunal réserva ses rigueurs pour le spectacle du Little-Palace où, dans une pantomime intitulée Griserie d’éther, se montraient des femmes nues44, dans des attitudes obscènes. Il condamna Melle Lepelley et Melle Jeanne Bouzon, à quinze jours de prison avec l’application de la loi Bérenger45 – c’était bien le cas ! – et le directeur du théâtre, M. de Châtillon, à trois mois de prison, sans sursis. Ce jugement trace la limite entre l’art et l’obscénité. Il mettra un frein aux exhibitions scandaleuses qui menaçaient d’envahir les théâtres. Le Tribunal a frappé et il a fait bonne justice46.
Malgré l’arrêt de la censure, les condamnations pour outrage aux bonnes mœurs mettent un terme à la représentation des amours saphiques.
Un « vice » à la mode
Après la Première Guerre mondiale, les pièces évoquant des amours saphiques sont plus fréquentes et ne suscitent plus le scandale, surtout si les femmes qui succombent à ce « vice » connaissent une fin tragique ou finissent par se ranger comme dans l’adaptation de La Garçonne, ce roman de Victor Margueritte qui fit scandale en 192247. La pièce montée durant la saison 1925-1926 est si fade qu’Étienne Rey ironise dans Comœdia : « Elle aurait presque pu être jouée par les pensionnaires de la Légion d’Honneur48 ! ».
En 1926, Édouard Bourdet écrit La Prisonnière : une jeune fille, pour ne pas suivre son père à Rome, lui fait croire qu’elle aime un jeune homme, Jacques, ami de la famille. Cela n’est qu’un subterfuge pour rester à Paris car Irène aime une femme. Elle va néanmoins épouser Jacques, mais au bout d’un an ils se séparent :
Il y a un an que je vis à côté d’une statue et il a suffi que cette femme reparaisse pour que la statue s’anime, qu’elle devienne un être vivant, capable de souffrir et de tressaillir ! Eh bien je renonce, comprends-tu Irène ? Je renonce49.
La Prisonnière ne montre jamais le couple formé par Irène et Mme d’Aiguines qui n’apparaît sur scène que sous la forme d’un bouquet de violettes50 qu’elle envoie à son amante. La pièce est bien une condamnation du lesbianisme, mais celle-ci passe par les paroles, et aucun geste « déplacé » ne choque la bienséance. C’est en même temps une critique du féminisme : Irène est décrite par Pierre Brisson comme une « créature stérile et incomplète », « orgueilleuse », « intelligente » avec « une volonté d’indépendance 51» : ces qualificatifs sont destinés à fustiger ces femmes cérébrales qui ne sont pas dans la « norme » c’est-à-dire timides, réservées, obéissantes et destinées à la maternité.
Édouard Bourdet, dès le lendemain de la première, est accusé de plagiat par une Viennoise, Mme Lazarsfeld : elle parle des similitudes entre le roman Mademoiselle Giraud, ma femme d’Adolphe Belot et la pièce d’Édouard Bourdet La Prisonnière. Le sujet est en effet le même, une femme qui ne peut satisfaire son mari ni affectivement, ni sexuellement, car elle aime une autre femme, et la souffrance du mari et son vieillissement précoce. Mais la conclusion est bien moins tragique : le couple se sépare. La pièce, comme le roman, est écrite par un homme qui adopte dans son discours la position du mari : « Ainsi d’une pièce qui avait vraiment toutes les raisons du monde pour être une pièce de femmes, il a fait une pièce d’hommes52 ». Et c’est de cette façon que la pièce échappe au scandale et est si bien accueillie malgré le sujet « scabreux » : le public suit le point de vue de l’auteur et du mari victime en condamnant la lesbienne, cette « créature anormale53» :
Le sujet qui paraissait tout à fait impossible à porter à la scène sans scandale, n’en suscite aucun. Si nous éprouvons une surprise étonnée c’est bien plutôt de voir étudier avec une convenance si parfaite le plus scabreux des problèmes sexuels54.
Plus d’un demi-siècle après le succès du roman d’Arthur Belot, le même sujet pouvait enfin être porté à la scène sans provoquer de scandale. Pour autant, il ne s’agissait pas d’une victoire. Les amours saphiques seront considérées durant de longues années encore comme déviantes, anormales au théâtre dans des pièces – et c’est heureux –tombées dans l’oubli55; ne leur ont survécu que les violettes, poétique symbole de l’amour lesbien56.