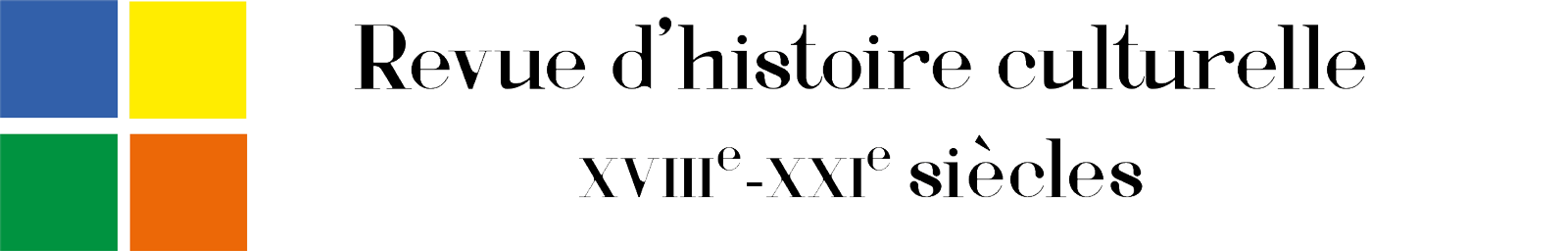Au XIXe siècle, la France, contrairement à l’Allemagne et à la Grande-Bretagne, ne possède pas de lois spécifiques contre les actes homosexuels1. En 1791, l’Assemblée nationale constituante abolit le crime de sodomie, rompant ainsi avec l’Ancien Régime. La sodomie était associée à un acte hérétique, or le législateur souhaitait rompre avec toute approche religieuse du droit. Il existe bien de nouvelles lois dans le Code pénal de 1810 pour le contrôle des mœurs : l’interdiction des relations sexuelles en public2 ou les relations sexuelles concernant des mineurs3. Cependant aucune distinction n’est faite entre les actes hétérosexuels et homosexuels. Ces dispositions semblent laisser entrevoir une certaine tolérance envers l’homosexualité.
Mais la police et la justice utilisent les lois citées4 pour contrôler les actes homosexuels, d’autant plus que la médecine au XIXe siècle établit des liens étroits entre homosexualité et criminalité, présentant l’homosexuel comme un danger, et l’associant à d’autres fléaux sociaux : chantage, prostitution, vagabondage, etc. La presse se fait aussi ponctuellement le reflet de cette image utilisant de nombreux termes dépréciatifs ou moralement connotés.
De plus, en France, les homosexuels, n’ayant pas à lutter contre un système spécifiquement répressif comme en Allemagne, ne se regroupent pas autour de mouvement communautaire. Le modèle français peut dès lors apparaître comme individualiste5. Il se définit cependant autour d’une subculture naissante, avec ses lieux et ses codes, dans les grands centres urbains comme l’a démontré William Peniston pour Paris6. De plus, la publicité de cette subculture émerge au gré d’affaires retentissantes, comme celle de l’arrestation du comte de Germiny en 1876 dans un urinoir parisien en compagnie d’un ouvrier. Ainsi, de manière épisodique et au gré de « scandales », on parle d’homosexualité dans la presse au XIXème siècle.
Après avoir accusé un retard certain, les recherches historiques sur l’homosexualité connaissent en France, depuis une trentaine d’années, un vif engouement. Pour un bilan historiographique complet, nous renvoyons aux articles de Régis Revenin7 et de Florence Tamagne8. Malgré tout, comme le souligne Régis Revenin, de nombreux pionniers ont auparavant ouvert la voie9.
Les travaux historiques concernant l’homosexualité masculine en France, pour la période allant du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle sont assez peu nombreux10. L’homosexualité est cependant prise en compte dans des sommes plus générales. Ainsi dans l’Histoire de la virilité11, certains chapitres sont consacrés à l’homosexualité masculine. C’est également le cas dans l’ouvrage collectif Hommes et masculinités, de 1789 à nos jours : contributions à l’histoire du genre et de la sexualité en France12.
Il manque cependant pour la France des études comme celle menée par George Chauncey13 sur la ville de New-York. Deux villes émergent toutefois dans une approche historique de l’homosexualité masculine en France, à partir d’études locales, pour la période évoquée : tout d’abord, la ville de Paris avec les travaux de Régis Revenin et de William Peniston14, puis la ville de Lille étudiée par Sébastien Landrieux15, permettant dans ce second cas de mettre en valeur une ville de province.
Notre article vise ici à contribuer à cette histoire des homosexualités en France dans la première décennie de la IIIe République, dans une ville de province, Bordeaux, en évoquant une affaire de mœurs nommée par la presse « les scandales de Bordeaux » et jugée entre le 9 et le 11 décembre 1878. Les sources convoquées se composent du rapport de police du commissaire Lafon16, des minutes correctionnelles du procès17 et d’extraits de journaux, notamment de l’édition du 11 décembre 1878 du quotidien La Victoire de la Démocratie18. Le dossier de procédure correctionnel est, quant à lui, absent.
Situé au Sud-Ouest de la France, Bordeaux compte dans les années 1870 environ 200.000 habitants. Elle connaît, comme beaucoup de villes à cette époque, une augmentation de sa population due à une immigration importante de Français venus d’autres régions. La période 1860-1880 est celle d’une croissance économique, principalement basée sur l’activité portuaire, centrale depuis plusieurs siècles, et le commerce transatlantique. C’est donc avant tout grâce à son héritage que Bordeaux représente une force économique. L’activité marchande autour du vin constitue encore, par exemple, un atout primordial pour l’enrichissement de la cité. Si elle a pu apparaître en retrait face à l’industrialisation du pays, certains secteurs ont été porteurs, comme celui des compagnies ferroviaires. La ville connaît, à l’image d’autres grands centres urbains depuis le Second Empire, des projets d’extension et d’assainissement qui jouent un rôle important dans le cadre d’une histoire des homosexualités masculines, en particulier dans l’appropriation de nouveaux espaces urbains comme les urinoirs.
L’affaire des « scandales de Bordeaux » expose au grand jour, au tribunal et dans les pages des journaux, les pratiques homosexuelles dans l’espace public bordelais. Une telle publicité de l’homosexualité est assez rare et, par là-même, notable. Tout comme le nombre de prévenus – vingt-quatre –, ce qui se révèle particulièrement élevé et permet d’abord de s’interroger, à travers un jugement exemplaire et ostentatoire, sur la mise en place d’actions coercitives envers les homosexuels bordelais. Ensuite, de percevoir « le dicible et l’indicible »19 de l’homosexualité en 1878 dans la presse régionale et nationale. Enfin, de décrire les pratiques d’un groupe d’hommes qui, dans l’espace public se rencontrent, agissent et interagissent malgré les interdits.
Les « scandales de Bordeaux » : du rapport de police au procès public
L’enquête bordelaise tire ses origines d’une affaire de mœurs qui défraya la chronique l’été précédent. Un notable gersois alerte la police ; son fils de quinze ans a été entraîné dans une maison par des hommes ayant la réputation d’être homosexuels :
On apprit alors des choses invraisemblables. Il s’était fondé une sorte de société pour l’exploitation en grand des vices athéniens. La maison principale était à Auch ; mais chaque jour, les affaires prenant de l’extension, on avait créé des succursales dans des villes comme Toulouse, Bordeaux, Agen, Bayonne. La société avait des voyageurs et un caissier, car on ne pouvait faire partie de l’association qu’après avoir pris l’engagement de verser des cotisations.20
Dès lors que la presse met l’accent, à partir de la ville d’Auch, sur les grands centres urbains du Sud-Ouest, agitant la peur d’une contagion21 à coup de métaphores22 et d’exagérations23, les pouvoirs publics n’ont d’autre choix que de lancer une enquête, tant pour mettre un terme à la rumeur que pour rappeler à l’ordre et aux bonnes mœurs. C’est pourquoi le 11 novembre 1878, le directeur de la sûreté, au nom du ministre de l’Intérieur, écrit au préfet de Gironde :
Monsieur le Préfet, d’après des informations qui me parviennent, un scandale rappelant ceux d’Auch et de Béziers aurait été découvert hier à Bordeaux. Quarante arrestations auraient été opérées. Je vous prie de vouloir bien me transmettre, d’urgence, des renseignements au sujet de cette affaire.24
Cette inquiétude est suscitée probablement par le journal radical La Lanterne25, du même jour, évoquant des arrestations massives. La presse nationale revient très vite sur cette exagération, ramenant le nombre des arrestations à une vingtaine26. Mais l’inquiétude est manifeste et le préfet somme le commissaire Lafon, commissaire du troisième arrondissement de Bordeaux, un arrondissement central, de rédiger un rapport27 en vue de satisfaire la demande venue du ministère de l’Intérieur. Le document rédigé par le commissaire est daté du 13 novembre 1878, deux jours après la requête, et est envoyé au directeur de la sûreté le 16 novembre 1878. Le rapport tend clairement à minimiser les faits : le scandale n’est pas du goût de la préfecture de la Gironde28.
En 1878, à Bordeaux, avant l’épisode des « scandales de Bordeaux », vingt-quatre homosexuels masculins ont déjà reçu des peines au nom de l’article 330 du Code pénal. Il existe donc une surveillance policière effective, centrée sur un lieu, la place des Quinconces. Certains agents provoquent même l’outrage public à la pudeur comme en témoigne l’arrestation de Louis Aboulène, mercier, condamné à six mois de prison et seize francs d’amende29. Il existe donc une politique coercitive envers les homosexuels. Mais au dernier trimestre de l’année 1878, l’envergure des arrestations est bien plus importante. En effet, avec l’épisode des « scandales de Bordeaux », on double pour l’année le nombre d’arrestations d’homosexuels masculins pour outrage public à la pudeur.
La narration des évènements contenus dans le rapport du commissaire Lafon est confuse et les liens de causes à effets peu clairs. Il faut donner une réponse rapide. Autrement dit on recherche ici plus l’efficacité que la cohérence. Toutefois, on note que le dialogue entre les autorités et les prévenus suit un objectif précis, celui d’établir les outrages publics à la pudeur. Le commissaire Lafon commence sa narration au 5 octobre 1878, débutant par l’arrestation de deux jeunes hommes, Louis Verdier et Antoine Pujos, âgés respectivement, d’après le rapport, de dix-sept ans et de quatorze ans et demi. Verdier est endormi sur un banc, sur l’esplanade des Quinconces, en début d’après-midi lorsque Pujos lui enlève son chapeau. Ils sont arrêtés. Lors de l’interrogatoire, le commissaire inscrit les paroles de Pujos, interrogé sur Verdier :
Je sais que Verdier se livre avec des hommes, notamment sur l’esplanade des Quinconces, à des actes honteux, il a la réputation de se faire enc… et on ne le désigne que sous le nom d’Eugénie, il a toujours de l’argent dans sa poche, vit bien et ne travaille pas.30
Le commissaire reconstitue des réseaux : Verdier évoque un « monsieur sur les Quinconces » qui lui avait donné rendez-vous dans une chambre, puis un dénommé « Paletot gris » qui lui donna également rendez-vous dans une autre chambre, rue Traversière, puis, enfin le nom de Charles Baillet, arrêté dans son logement, rue de la Fusterie. Ce dernier lui donne le nom de famille d’un homme, Couffitte31, surnommé « le commissaire ». Il est à son tour appréhendé et il avoue se livrer à des actes homosexuels sur l’esplanade des Quinconces avec des hommes dont il cite les surnoms : Eugénie (Louis Verdier), Léopold, Cosiki, Camille, Poumada, Bras cassé, la Boiteuse, Paletot gris, Jean de l’hôtel de France, Mathieu un marchand de tabliers, etc. Ces hommes sont emprisonnés, et six autres encore recherchés au moment de la clôture du rapport.
La démarche des autorités traduit la volonté de construire l’acte d’accusation en dialoguant avec les prévenus : il faut faire avouer le caractère public des relations pour que l’article 330 du Code pénal soit effectif. De même, la présence de mineurs est signifiée à plusieurs reprises afin aussi que l’instruction puisse faire valoir l’article 334. Enfin, et sans réelles précisions, les charges de « chantage » et de « vagabondage » apparaissent. Dans ce compte-rendu, il est difficile aussi de distinguer l’homosexualité masculine de la prostitution masculine, car pour les forces de police, en 1878, les deux sont indissociables, d’autant que Lafon utilise une certaine réserve, lors de la description des actes, qui ne permet pas de clarifier la situation. Il parle « d’actes honteux » ou « d’actes de pédérastie », il nomme les prévenus « pédérastes » et il utilise même des expressions plus neutres comme « relations avec des hommes ».
Au total, vingt-cinq individus sont arrêtés. Seul Charles Baillet n’apparaît pas dans la liste des prévenus, le 9 décembre 1878. Dans le rapport, il semble être un homme aisé mais aussi le seul – d’après les écrits de Lafon – à donner une raison, aux yeux de l’inspecteur, recevable :
Pressé de questions il avoua qu’en effet il avait des relations avec des hommes, qu’il avait contracté cette malheureuse passion en Afrique ce qui faisait le désespoir de sa famille et que malgré son bon vouloir, il ne pouvait sans [sic] déshabituer.32
L’honnêteté de l’homme, le repentir, l’aide de sa famille, l’argument d’une « maladie coloniale », et son statut social ont pu jouer en faveur de sa libération avant le jugement. C’est donc vingt-quatre hommes, et non vingt-cinq, qui comparaissent tous détenus le 9 décembre 1878, parmi lesquels dix-sept mineurs de moins de 21 ans.
Lorsque la séance débute au tribunal de Bordeaux, place Magenta, le huis clos est levé. La presse annonçait pourtant, depuis plusieurs jours, que les débats allaient se tenir loin des regards de la foule : « Le jour de l’audience n’est point encore fixé, mais on sait déjà que le huis clos le plus rigoureux sera exigé »33. De même, on note à quelques jours de l’audience : « L’affaire dite des scandales de Bordeaux viendra lundi prochain, 9 décembre, à l’audience correctionnelle. Le huis clos sera réclamé par le ministère public »34. Si le huis clos est plutôt de mise pour les affaires d’outrage public à la pudeur, plusieurs affaires en 1878 ont bénéficié d’une levée à Bordeaux35. La raison en est, surtout pour cet évènement-là, une volonté de donner l’exemple, quitte à risquer l’exposition de propos jugés obscènes, dans l’espoir de ne pas multiplier ce type d’exposition judiciaire à l’avenir. C’est donc devant une salle remplie de curieux que se tient le procès :
Bien avant midi, les abords du palais sont envahis par la foule toute aussi curieuse de voir les physionomies des prévenus que d’assister aux débats des obscénités inqualifiables dont ils se sont rendus coupables. Par mesure de précaution, le nombre des fonctionnaires a été augmenté ; ainsi que nous l’avons annoncé, les débats sont publics ; la salle est comble, on est entassé les uns sur les autres […].36
Cet attrait montre bien l’exceptionnalité de l’affaire et la médiatisation forte qui attirent une foule venue assister, pour certains, à une certaine forme de spectacle, et l’on voit ici apparaître une forme de voyeurisme.
Les charges retenues sont exposées le 9 décembre 1878. Les minutes correctionnelles précisent :
Tous les susnommés détenus, présents, prévenus d’avoir à Bordeaux depuis moins de trois ans commis des outrages publics à la pudeur ; DELAGE Mathieu en outre d’excitation de mineurs à la débauche ; MATHIEU Léonard et LASSAIGNE en outre de chantage, HERCOURT en outre de mendicité ; BEAUBIAT et CHANUT en outre de vagabondage. Renvoyés en police correctionnelle par ordonnance de M. Le Juge d’Instruction.37
Les vingt-quatre prévenus sont présents, il y a donc d’abord un choix d’exposer les individus arrêtés depuis deux mois environ, et détenus en prison. On retrouve cette volonté pédagogique de montrer ce que l’on risque, à savoir l’exposition et le jugement public, si un individu commet des actes homosexuels. La publicité du scandale est donc assumée.
Le procès se déroule sur trois jours : le 9 décembre les poursuites sont énoncées, le 10 décembre les débats ont cours, le 11 décembre le jugement est prononcé. Les termes utilisés lors de débats publics expriment le fait qu’il s’agit, en réalité, du procès de l’homosexualité masculine. On parle de « vices contre-nature » et de « honteuses passions ». Le jugement moral précède donc le jugement judiciaire. Les mots n’ont donc pas ici vocation à être neutres mais bien à qualifier un acte socialement, et par extension juridiquement répréhensible. Pour Louis Merlande, professeur de philosophie, on parle « d’une profonde misérabilité ». On avance également, à son sujet, des preuves médicales – sans énoncer clairement le contenu de ces preuves – mais qui laissent entendre que les prévenus ont pu subir des visites médicales, ayant pour but de rechercher les signes de leur homosexualité, selon les thèses en vigueur du médecin légiste Ambroise Tardieu38. De même, il est écrit que Jean-Baptiste Jonquet et Armand Charron « portent les traces du vice contre-nature ». Même si les descriptions sont peu présentes dans les minutes correctionnelles, on note que ce qui est condamné ici, avant même l’outrage public à la pudeur, est surtout l’immoralité, dont la preuve est le stigmate physique. Ces aspects physiologiques sont précisés plus longuement dans la presse, ce que j’analyserai ultérieurement, mais n’apparaissent que sous forme allusive dans les minutes correctionnelles.
Le 11 décembre 1878, les peines tombent. Cinq prévenus sont relaxés, car l’outrage public à la pudeur n’a pu être clairement établi et la charge requise a été abandonnée après enquête. Les plus jeunes, Jean Ardouin (14 ans) et Jean Chanut (13 ans), sont respectivement remis aux parents et envoyé en maison de correction. Les peines sont assorties d’amendes. Blaise Bordage (16 ans) et Arnaud Elichegaray (17 ans) sont condamnés à 4 mois de prison et 16 francs d’amendes. Les juges déclarent alors que les moins de 16 ans « ont agi sans discernement »39 ; de ce fait, ils reçoivent des peines moins importantes. Dix autres prévenus reçoivent des peines de 6 mois de prison et 16 francs d’amende. Elles sont de trois mois supérieurs à la peine plancher prévue par l’article 330 du Code pénal. Cinq Bordelais sont condamnés à de très lourdes peines allant de 15 mois de prison et 16 francs d’amende à 2 ans de prison et 50 francs d’amende, ce qui constitue la peine la plus élevée prévue par l’article 330. Plusieurs facteurs expliquent ce choix de la justice. Jean Léonard Mathieu a forcé « par des menaces et des violences » Gaston Lassaigne. Mathieu Delage (42 ans) subit une lourde peine car il est déclaré coupable d’excitation à la débauche de mineurs (article 334) sur les personnes de Henri Dufau (18 ans), Raymond Allot (20 ans) et Louis Foulquier (19 ans). Ici, c’est la majorité à 21 ans qui est retenue pour définir l’excitation à la débauche de mineurs. On peut s’étonner que seul Mathieu Delage ait reçu cette charge, alors que d’autres relations entre majeurs et mineurs sont relevées. Comme le souligne l’historienne du droit Hélène Duffuler-Vialle, « la norme est créée au moment de son application, donc après son interprétation, qui passe par le prisme des injonctions sociales dominantes, dans le sens où le juge en est le vecteur inconscient »40, autrement dit, le flou de l’article 334 donne au juge une certaine latitude dans l’utilisation de cet article. Il est donc possible ici que la transgression soit apparue comme trop importante pour le juge Krug-Bass qui a utilisé son pouvoir interprétatif pour appliquer l’article 334. En effet, le domestique Matthieu Delage faisait régulièrement pénétrer dans la maison de son maître l’ancien maire Pelleport-Burète. Ils étaient quatre lors de ces réunions et, comme le précisent les minutes correctionnelles, Mathieu Delage les accueillait tous « pour leur donner la facilité [se] livrer ensemble à leur honteuse passion, à l’abri de la surveillance de la police ; que ces jeunes gens [se] sont livrés, soit avec lui, soit entre eux à des actes obscènes ». Enfin, Alfred Confit, dénommé « Coufitte » dans le rapport de police, et Édouard Prudhommeau écopent respectivement de 18 mois et de 2 ans de prison, ainsi que de 50 francs d’amende. Si pour le premier, il a été prouvé qu’il était très connu par bon nombre de prévenus et témoins, ce qui a pu constituer un facteur aggravant, les raisons de la lourde peine de Prudhommeau ne sont pas clairement explicables, si on se base exclusivement sur les minutes correctionnelles.
L’outrage public à la pudeur se définit sur la consommation avérée, en présence de témoins (qui peuvent être les autres partenaires), de l’acte homosexuel en public. Le mot « publiquement » est d’ailleurs répété et souligné dans le compte-rendu du jugement. Mais il est notable que l’interprétation de l’article 330 est fluctuante. Marcela Iacub démontre que l’usage de cet article dépasse le simple cadre de l’espace public et que la justice s’invite dans les espaces privés41. C’est le cas pour « les scandales de Bordeaux ». En effet, beaucoup d’hommes ayant des relations avec d’autres hommes, pour éviter de lourdes peines, choisissent des lieux privés, à l’abri des regards et, pensent-ils, à l’abri de tout risque d’arrestation. Il est précisé, par exemple, que Mathieu Delage et ses amants cherchaient à se livrer « à leur honteuse passion, à l’abri de la surveillance de la police ». Ce qui pourrait apparaître comme un élément à décharge, semble, au contraire, renforcer l’idée d’une perversité coupable. Toutefois, l’argument de la relation dans la sphère privée sert de défense à l’avocat de Louis Merlande, Maître Bretenets : « Quelque repoussante que soit sa passion, il l’a assouvie dans sa chambre, et par conséquent, il ne saurait être atteint par les dispositions de l’article 330 du Code Pénal »42.
En dehors des tribunaux, c’est dans les colonnes des journaux que l’on s’informe sur les « scandales de Bordeaux », en amont et en aval des journées d’audience, un évènement qui met en lumière l’homosexualité, un thème habituellement peu présent dans la presse, surtout pour une affaire régionale.
La médiatisation des scandales de Bordeaux
La couverture médiatique des « scandales » homosexuels n’est pas chose rare quand l’affaire est d’ampleur. En 1876, l’affaire parisienne du comte de Germiny avait, quant à elle, été largement couverte par les journaux, en particulier nationaux. Elle avait abouti à la destitution de cet homme politique en vue, pris en flagrant délit d’outrage public à la pudeur avec un ouvrier dans un urinoir parisien43. La position du personnage en avait fait une cible pour ses détracteurs, en particulier pour la presse d’opposition à la politique de McMahon, dont Germiny était un soutien44. Le terme de « germinisme45 », pour parler d’homosexualité, fait directement référence au comte de Germiny et apparaît dès les origines de l’affaire bordelaise pour désigner les homosexuels du scandale de Bordeaux. L’histoire est encore dans les esprits lors des évènements girondins, et le mot connu des lecteurs.
Ce n’est donc pas un fait exceptionnel qu’un « scandale » homosexuel s’expose dans les colonnes des périodiques. Pour une affaire provinciale, c’est cependant plus rare46, mais le cas bordelais tend à démontrer que c’est possible. De plus, elle comporte, dans une moindre mesure que l’affaire Germiny, un enjeu politique. Deux positions émergent dans la presse quotidienne bordelaise : celle de titres républicains modérés, incarnés par La Gironde et La Petite Gironde, et celle d’une presse républicaine radicale, campée par le quotidien La Victoire de la Démocratie. Les premiers tendent à sous-estimer l’évènement, le second à agiter le scandale.
Le 21 novembre 1878, La Gironde publie :
L’enquête relative à l’affaire dite « les scandales de Bordeaux » est sur le point d’être terminée. M. de Lioncourt, qui a mené l’instruction, ne tardera pas à la clore. Les accusés, dont le nombre, comme on le sait, dépasse la vingtaine, seront déférés au tribunal correctionnel. Le débat, nous assure-t-on, est prochain, néanmoins, le jour de l’audience n’est pas fixé encore. Nous n’avons pas besoin d’annoncer que l’affaire sera débattue à huis-clos.47
Les termes sont neutres, voire allusifs. Rien ne laisse supposer que l’on parle d’homosexualité. Seul le mot « scandales » porte une focale sur l’évènement. L’information est courte, peu développée. L’auteur assume de ne pas vouloir en dire plus : il se justifie presque en annonçant le huis clos, comme si ce fait imposait pour lui aussi le silence. Le quotidien La Gironde, journal politique de tendance républicaine, n’expose pas par la suite le déroulement de l’affaire. La Petite Gironde, journal à fort tirage créé en 1872, apparaît un peu plus prolixe, bien que lui aussi réservé. C’est un quotidien traitant d’affaires diverses, mais attaché aux chroniques locales, et dont l’audience ne cesse de croître. Le 11 décembre 1878, il annonce le verdict et associe à chaque nom les condamnations. De plus, les 13, 16 et 19 décembre 1878, on peut lire dans les colonnes de ce quotidien une rubrique « homonymies » qui invite les lecteurs à ne pas confondre certains condamnés avec d’autres individus : par là-même le journal se veut le garant de la respectabilité pour son lectorat.
M. Chanut, libraire rue Vital-Carles, 36, et M. Chanut, cordonnier, rue des Facultés, 37, nous prient d’annoncer qu’ils n’ont rien de commun que le nom avec le dénommé Chanut, condamné dans l’affaire dite « des scandales de Bordeaux. » On nous prie également d’annoncer que M. Lacoste (Jules), employé à Bourg-sur-Gironde, n’a rien de commun avec un des prévenus qui ont figuré dans l’affaire des scandales de Bordeaux.48
Si ces deux journaux ne versent pas dans le scandale, c’est que leur ligne éditoriale correspond et soutient la politique municipale incarnée par le député-maire Emile Fourcand, représentant tout à la fois l’ordre – par sa gestion de l’épisode de la Commune à Bordeaux – et l’esprit républicain affirmé, par son opposition au gouvernement de l’Ordre moral en 1876, qui l’avait évincé de la mairie de Bordeaux pendant deux ans. Ces journaux ne cherchent pas à déstabiliser la mairie, de plus ils ont une certaine audience, de forts appuis financiers et de bonnes ventes. Rien qui ne puisse donc justifier d’aller chercher un nouveau lectorat en versant dans le sensationnel.
Malgré tout, le quotidien La Petite Gironde évoque un épisode marquant le procès :
Thomas, dit « Marguerite », s’est écrié : « Ils ne sont pas tous ici ceux des Quinconces ! ». M. Faye ayant invité le condamné à désigner les individus, Thomas s’y est d’abord refusé. Quelques instants après, cependant, il consentait à accompagner l’agent Caubain dans la partie réservée au public. Mais cette visite a été infructueuse. Thomas, dit Marguerite, a néanmoins affirmé qu’il en avait reconnu et salué une demi-douzaine.49
Le journal La Petite Gironde reste toujours très allusif et ne cède pas au goût du scandale bien qu’habitué à narrer les faits divers locaux.
Le même jour, le journal bordelais de tendance politique radicale, La Victoire de la démocratie, se livre quant à lui à une narration très détaillée. Dans son édition du 11 décembre 1878, il annonce en « Une » que cette édition contient le compte-rendu des débats. Le récit couvre presque l’intégralité d’une page50, ce qui rompt avec les entrefilets des journaux cités précédemment. Bien que se prémunissant du scandale par quelques formules, le récit est ample, précis et moralisateur. On retrouve des pans entiers du rapport de police51 ou des minutes correctionnelles52, mais aussi des dialogues et des extraits de courriers intimes. À partir de cet article, d’autres journaux du même bord politique, comme le quotidien national La Lanterne, reprennent les faits et diffusent l’information avec force. Les thèmes propres à la ligne radicale apparaissent en creux dans l’affaire. Par exemple, l’anticléricalisme, au travers d’un prévenu, est visé : « Édouard P., dit ‘‘Chemin de fer’’, 51 ans, se disant employé de journaux, figure sur l’Annuaire comme agent du Comité de l’Union catholique »53. Ensuite, la charge contre les ennemis politiques est plus virulente. Le condamné Mathieu Delage est le valet de l’ancien maire de Bordeaux, et sénateur en 1878, Charles de Pelleport-Burète. C’est chez son maître qu’il recevait ses amants. En outre, c’est sur lui que pèsent les plus lourdes charges. Préciser que l’ancien maire, opposant d’Émile Fourcand et représentant de l’Ordre moral à Bordeaux, a pour valet un homosexuel, accusé d’excitation à la débauche de mineurs, est une charge en creux contre les opposants politiques, plus vive que celles portées alors par la presse républicaine modérée. Par ailleurs, en offrant aux lecteurs un large compte-rendu, le quotidien radical cherche à s’imposer dans le panorama de la presse régionale face à des quotidiens à plus large audience comme La Petite Gironde.
Peu de choses se disent clairement sur l’homosexualité, et la presse, dans sa grande majorité, élude cette question. Quand un journal comme La Victoire de la Démocratie, dans son édition du 11 décembre 1878, décrit aussi précisément un compte-rendu d’audience, c’est un cas exceptionnel d’exposition de l’homosexualité dans la sphère publique. Il faut cependant distinguer dans cet article, tout aussi exceptionnel soit-il, ce qui peut être dit, de ce qui doit être tu. L’article utilise, comme seule référence explicite à l’homosexualité l’expression « dignes descendants de Sodome »54. Par la suite, seul le contexte permet de comprendre qu’il s’agit de relations homosexuelles car il n’y a pas dans cet article de mots comme « invertis » ou « antiphysiques » que l’on peut, par ailleurs, trouver lorsqu’il s’agit de désigner à l’époque des homosexuels dans la littérature scientifique. On ne décrit jamais l’acte en lui-même, seul le mot « obscénité » renvoie indirectement à la relation physique. Le terme « scandale » évoque aussi pour l’époque une dimension sexuelle, mais là encore il ne vise pas explicitement l’homosexualité. L’article s’aventure toutefois à évoquer « le lieu de rendez-vous de l’action » et parle même de « caresses ». C’est probablement ici la référence la plus importante à l’acte sexuel.
Pour décrire l’homosexualité, le champ lexical de la criminalité est préféré, comme en témoigne l’expression « ignoble bande ». On retrouve régulièrement cette référence à la bande organisée criminelle. C’était déjà le cas pour les scandales d’Auch55. La prégnance de stéréotypes sont visibles à travers la presse qui présente les individus comme une « bande organisée ». On retrouve à cette époque des expressions persistantes telles que « franc-maçonnerie du vice » pour désigner les homosexuels56. Le récit de l’arrivée au tribunal accroît cette impression de menace et de dangerosité que constitueraient les homosexuels masculins, traités ici comme de dangereux criminels. On note aussi que cela attise la curiosité.
Il est une heure et demie, les prévenus quittent la maison d’arrêt enchaînés deux à deux et conduits par la gendarmerie escortée elle-même par quelques militaires du poste de la prison ; ils arrivent entre une triple haie de curieux jusqu’à l’audience.57
On cherche à susciter la peur et le dégout chez le lecteur. La dimension morale est d’ailleurs très présente : on parle de « leur infâme industrie », des « obscénités inqualifiables », de « honteuse passion ». Il apparaît donc que le « dicible » de l’homosexualité repose avant tout sur une condamnation sociale – avec le risque d’être exposé aux yeux de tous - présupposée à la condamnation juridique. Les termes employés créent une mise à distance avec les sujets condamnés car l’homosexuel représente un réel danger pour la société. Le journaliste donne cependant à son lectorat un gage de sécurité, l’homosexuel peut être identifiable :
Quel affligeant spectacle que celui de ces vingt-quatre individus, jeunes et vieux, au teint livide et cadavérique, et portant pour la plupart, sur leur visage, le stigmate du vice, de la débauche, et sur leur corps, d’après le rapport médical, le sceau de la dépravation la plus honteuse.58
On lit plus loin que Joseph Coufitte a une figure « blême et amaigrie » et qu’Antonin Martin possède un « rapport médical [qui] ne lui est pas favorable et constate sa honteuse passion ». Quant à Louis Merlande, « il porte sur ses traits blêmes, amaigris, et cadavériques » le stigmate du vice. On retrouve les mêmes remarques pour Henri Dufau dont « le rapport médical est très défavorable ». Chez Mathieu Delage, « le rapport médical constate un double office [sic] de la part du prévenu ». Il y a deux aspects : d’abord un aspect subjectif, celui de la honte mêlée à la dépravation se lisant sur le visage, ensuite un aspect qui se veut scientifique, et par là-même objectif, celui de l’examen médical. La Victoire de la Démocratie semble ici reprendre les thèses médicales communément admises en cette fin du XIXe siècle. Ces théories sont élaborées en 1857 par le médecin-légiste Ambroise Tardieu qui fixe les symptômes physiologiques de l’homosexualité afin d’aider la police des mœurs dans ses arrestations59. L’article permet aussi de comprendre que chaque individu a subi une visite médicale supposée prouver son homosexualité.
Pour finir, l’article de La Victoire de la Démocratie présente les vingt-quatre prévenus en deux catégories : « La première est celle des patriarches de l’ordre, la seconde est celle des prostitués vulgaires de la confrérie » dont certains possèdent « le type et les allures féminines ». On retrouve ici la typologie établie par Ambroise Tardieu, attestée aussi par Félix Carlier60 : un homosexuel « actif » qui représente la virilité, qui est souvent plus âgé, qui peut avoir une vie de famille et qui est en général le « client », et un homosexuel « passif » qui a les attributs de la féminité, qui est souvent plus jeune, célibataire et qui se prostitue. Cette grille de lecture, que semble reprendre le journaliste, tend à associer prostitution et homosexualité, et donc à renforcer l’idée de l’homosexualité définie comme un trouble à l’ordre social.
L’homosexualité s’écrit donc dans la presse soit comme un crime, soit comme une pathologie, et certainement comme les deux à la fois puisque la mobilisation par la justice des théories d’Ambroise Tardieu tend à associer pédérastie et criminalité, et à justifier les surveillances policières et les condamnations pénales. Pour la ville de Bordeaux, la pression se fait forte en cette fin d’année 1878 : selon les minutes correctionnelles, la moitié des homosexuels jugés pour outrage public à la pudeur en 1878 est constituée par les vingt-quatre prévenus des scandales de Bordeaux61.
L’émergence d’une subculture homosexuelle à Bordeaux ?
Le mois de décembre 1878 est donc marqué par une forte mobilisation à l’encontre des homosexuels : arrestations, jugements, articles de presse moralisateurs qui jettent en pâture le nom des prévenus. Mais les sources utilisées traduisent aussi, parfois malgré elles, les moyens d’action d’un groupe, au contour parfois encore mal défini – le terme de communauté semble alors impropre –, qui se rencontre, se reconnaît et se défend.
Les rencontres entre homosexuels se font au gré de déambulations urbaines, dans des lieux extérieurs. L’épicentre semble être la place des Quinconces vers laquelle tous convergent. Le rapport du commissaire Lafon rapporte les paroles d’Antoine Pujos : « Je sais que Verdier se livre avec des hommes, notamment à l’esplanade des Quinconces, à des actes honteux ». Plus loin il est précisé qu’Alfred Coufitte « avoua s’être livré à des actes de pédérastie sur la voie publique et un peu partout notamment aux Quinconces »62. Au tribunal, on établit que les prévenus « se sont livrés, à différentes reprises, entre eux, à des actes obscènes contre nature ou à des actes impudiques, dans les lieux publics de Bordeaux et notamment sur la place des Quinconces »63. Enfin, l’article du quotidien La Victoire de la démocratie, évoque également la place des Quinconces comme « le point de ralliement » et précise : « On allait s’asseoir sur un banc de la place des Quinconces où l’on se confondait en caresses et en compliments »64. Plus loin, le journaliste écrit qu’Henri Dufau « allait fréquemment sur les Quinconces ». Enfin, l’épisode final narré dans La Petite Gironde du même jour, et absent du récit de La Victoire de la Démocratie, atteste l’importance des Quinconces. On le trouve également dans la narration faite par le quotidien national de tendance radicale La Lanterne :
Après le prononcé du jugement, se produit l’incident Thomas, dit Marguerite, qui s’écrit, en jetant un regard tout au fond de la salle : « Nous ne sommes pas ici tous ceux des Quinconces ». Le substitut invite Thomas à désigner ses complices. Celui-ci refuse d’abord puis se décide. Un agent parcourt la partie réservée au public mais sa perquisition est infructueuse. Thomas néanmoins affirme avoir vu et salué plus d’une demi-douzaine de connaissances intimes. A ce moment tout le monde et moi qui assistions à l’audience avons vu un certain nombre d’individus effrayés s’esquiver rapidement et sortir de la salle.65
Les Quinconces apparaissent donc comme un lieu central pour les rencontres homosexuelles au point même que l’expression « ceux des Quinconces », dans la bouche du condamné Jean Thomas, désigne les homosexuels bordelais. Les arrestations pour outrage public à la pudeur, avec actes homosexuels avérés, pour l’année 1878, attestent l’importance de cette place et de ses contre-allées, les allées de Chartres et d’Orléans, puisque la quasi-totalité des arrestations se fait dans ce lieu66. Assez récent dans le paysage bordelais, il résulte de la destruction du château Trompette à peine commencée à la fin du XVIIIe siècle, et hâtée dans le premier quart du XIXe siècle. Il résulte surtout d’un projet urbanistique cohérent, salubre et moderne : connecter les quartiers centraux aux faubourgs en créant une vaste esplanade, détruire un château dont l’objectif défensif était devenu obsolète et n’offrant qu’un foyer d’infection, selon le comte de Tournon67, préfet de Gironde sous la monarchie de Juillet. Ces travaux ont pu être perçus comme la volonté de supprimer un symbole de la monarchie de l’Ancien Régime. L’esplanade se présente sous la forme d’une terrasse très vaste qui domine la Garonne. L’entrée, côté fleuve, est signifiée par deux colonnes rostrales, surmontées des statues du commerce et de l’industrie. Côté ville, une place en hémicycle qui s’ouvre sur cinq voies. En 1878, la place en hémicycle comporte en son centre un simple bassin qui accueille à la toute fin du XIXe siècle la fontaine de Bartholdi, ainsi que le monument aux Girondins. La terrasse est encadrée de deux longues allées. La disposition initiale des arbres, en quinconces, donna le nom définitif à la place qui s’appela un temps place Louis-Philippe. C’est un terrain d’action assez vaste sur lequel déambulent les homosexuels bordelais puisque la place mesure douze hectares. Toutefois, les promenades se concentrent dans les allées de l’esplanade. Précisons toutefois que le lieu, malgré la présence d’arbres, est assez ouvert aux regards, d’autant plus que la végétation peu dense ne peut offrir un refuge, loin des regards des forces publiques. Toutefois, sa position entre quartiers centraux et faubourgs en ce dernier quart de XIXe siècle constitue un endroit un peu excentré, tout en étant fort accessible. Les douze hectares n’étant investis ni par les commerces ni par les habitations, l’espace possède des atouts non négligeables, entre discrétion et centralité.
Malgré tout, l’esplanade semble assez connue par les autorités, et donc dangereuse pour les homosexuels, et si les rencontres se font aux Quinconces, on se déplace ailleurs pour consommer l’acte sexuel, « à des endroits plus reculés et aussi à des maisons particulières »68. Les autres lieux publics évoqués dans le compte-rendu des minutes correctionnelles sont variés : « Dans la rue Judaïque, près le chemin de la Vache, sur les fossés, dans un pré du côté de la gare du Médoc, dans la rue du Palais-Gallien, dans un urinoir près de l’abattoir, aux allées de Rivière, rue Croix de Seguey, derrière l’Hippodrome et à Caudéran »69. Ces lieux constituent un ensemble hétérogène, plus ou moins éloigné du centre-ville, parfois même plutôt à l’écart comme l’hippodrome du Bouscat, où Arnaud Elichegaray, Jules Lacoste et Antoine Martin ont été appréhendés ensemble70. Enfin, les espaces privés constituent un abri pour éviter l’outrage public à la pudeur, même si dans le cas des « scandales » de Bordeaux, cela n’a pas toujours permis d’éviter le tribunal. Ainsi Louis Verdier avait rencontré un individu aux Quinconces qui lui donna rendez-vous place Dauphine (actuelle place Gambetta). Le même Louis Verdier avait suivi Louis Merlande dans une chambre, rue Traversière.71 Henri Dufau, quant à lui, passa la nuit dans une chambre à l’hôtel Lambert avec un autre homme. Enfin, Mathieu Delage accueillait ses amants rue du Champ-de-Mars, chez son maître, le sénateur Charles de Pelleport-Burète. Si ces stratégies ont pu permettre d’éviter de tomber sous le coup de l’outrage public à la pudeur un temps, elles n’ont pas empêché de jeter le discrédit sur leurs auteurs lors des « scandales de Bordeaux ».
Agir en tant qu’homosexuel, c’est aussi pouvoir se reconnaître dans l’espace public et communiquer entre soi :
La bande avait ses signes à elle et lorsqu’un membre voulait en accoster un autre ou se faire raccrocher, un mouchoir autour du cou, ou un bout de mouchoir sortant de la poche indiquait suffisamment les aptitudes du sujet : on s’abordait pour allumer un cigare ou une cigarette, on allait s’asseoir sur un banc […]72
Un rituel dont la présence est surprenante dans les pages d’un journal qui, tout en écrivant « à charge » contre les homosexuels, en décrit tous les usages de rencontre.
L’existence d’une forme de communauté est également attestée par l’usage de surnoms : si on peut estimer que cela leur permet de se nommer sans révéler leur propre identité, cela accrédite surtout l’existence d’un réseau de personnes se connaissant, se croisant régulièrement, interagissant. Pour les détracteurs, cela contribue à renforcer l’idée d’une bande organisée. Il est vraisemblable que cela révèle plutôt l’existence d’une proto-communauté avec ses codes, ses us et ses coutumes. Ainsi, les individus se surnomment73 à partir d’un détail physique (« la Boiteuse », « Bras cassé » ou « Cheveux longs ») ou d’un vêtement (« Paletot gris »). Certains surnoms traduisent une certaine connaissance de la profession de l’autre : Alfred Couffitte est surnommé « le commissaire » car il fut sergent de ville, Arnaud Charron se fait appeler « Pommadin », synonyme de garçon coiffeur74. Enfin, certains se reconnaissent dans des surnoms féminins : Louis Verdier est « Eugénie » et Jean Thomas « Marguerite ». Cette féminisation n’est pas rare et contribue au développement d’une subculture homosexuelle aux frontières de genre poreuses. Une lecture moins clivante d’un monde homosexuel, que celle proposée par Ambroise Tardieu75 et Félix Carlier76, est possible77, et la relation prostitué-client n’empêche pas l’existence d’une communauté où les relations se construisent et perdurent : comment Jean Thomas reconnaitrait-il d’autres homosexuels dans le public de la salle d’audience s’il n’avait pas croisé ces hommes, plusieurs fois, précédemment78 ?
L’existence de liens durables qui dépassent le simple acte sexuel fugace est aussi attestée par la relation entre Louis Verdier et Louis Merlande qui propose au premier de lui louer une chambre et de lui donner 100 francs par mois pour ses besoins. Si cela traduit une relation avec bénéfice, il n’en reste pas moins qu’une relation durable est ici envisagée. De même, on trouve mention dans La Victoire de la Démocratie d’extraits de lettres entre un dénommé Castel, pharmacien à Marmande, et Henri Dufau :
Dans une visite domiciliaire faite chez le prévenu, on trouva deux lettres amoureuses que ce pharmacien impudique adressait à son tendre ami DUFAU et dans lesquelles il lui dépeignait toute sa flamme, toute sa tendresse, tout son amour, toute sa passion. En voici quelques fragments : « Votre silence me tue ! Je suis à me demander si je rêve ! De grâce, répondez-moi ne me faîtes plus souffrir. Je désire que ma lettre trouve à Bordeaux le même ami que j’y ai laissé. Cet ami chéri, cet ami bien aimé, il repose sur mon cœur ; son nom y est gravé en lettres de feu ! !…Viens. Viens. Viens ! !…Celui qui t’aime… ». La lettre était accompagnée d’une fleur artificielle. D’une autre lettre, nous extrayons ce passage : « Je vous attends demain soir sans faute, si mariage il doit y avoir, ce sera le jour des fiançailles ; tout le monde est prévenu de votre arrivée, j’ai dit que j’attendais un élève. Tout à vous de corps et d’âme ! … ». Ne pouvant plus longtemps modérer son impatience, le pharmacien ne se contenta plus d’écrire, il adressa télégrammes sur télégrammes.79
La retranscription de ces quelques extraits de lettres d’amour est utilisée pour accabler les protagonistes, mais elle nous permet aussi de voir l’amour homosexuel émerger dans l’espace public. Autrement dit, alors que l’homosexualité comme relation sentimentale entre deux hommes est généralement cachée, on peut la voir ici étalée au grand jour. Si le journaliste invite le lecteur à haïr ce qui est alors appelé une « passion honteuse », on peut y lire aussi l’exposition de sentiments nobles et recherchés par ces hommes en dehors de tout acte sexuel fugace. Or, si Castel déclare son amour à Henri Dufau et envisage de le revoir, de l’accueillir chez lui, et qu’il a même annoncé son arrivée à son entourage – même au travers d’un mensonge – c’est bien qu’il se définit comme un homme aimant un autre homme.
En décembre 1878, l’homosexualité occupe la sphère publique bordelaise. Les « scandales de Bordeaux » intéressent autant au niveau national qu’au niveau local. Il ne faudrait pas qu’un scandale, comme celui du comte de Germiny, atteigne le nouveau régime républicain, à peine débarrassé des tenants de l’Ordre moral et du retour à la monarchie. On perçoit alors pour la capitale girondine la possibilité de surveillances accrues et d’arrestations importantes au titre de l’article 330 du Code pénal pour outrage public à la pudeur. Les rouages qui se mettent en place semblent alors entraîner ces hommes dans une spirale judiciaire relayée par la presse : en effet, si les jugements d’homosexuels pour outrage public à la pudeur existent avant décembre 1878, l’ampleur des prévenus et la médiatisation sont ici inédites et représentent, pour Bordeaux, une première et un cas unique pour cette ville, dans l’état actuel de la connaissance des sources. Parmi les prévenus, des hommes d’origine souvent modeste : domestique, conducteur de bestiaux, garçon d’hôtel, cantonnier, etc. Leur vie est alors exposée ; ils sont nommément cités dans les pages des journaux ; ils sont exhibés au tribunal. Les Bordelais se livrent, pour un procès où le huis-clos est levé, à un autre type de spectacle, celui du voyeurisme.
Derrière les « scandales », émerge cependant une subculture homosexuelle. On voit des hommes qui ont leurs lieux de rencontres, qui investissent l’espace public, qui élaborent des stratégies pour éviter de tomber sous le coup de la loi. On y voit des hommes qui se séduisent, se nomment, se connaissent et se reconnaissent, comme autant de signes d’une sociabilité. On y voit aussi des hommes qui tentent de vivre et d’assumer leur attirance physique et leur amour pour les personnes de même sexe. Peut-être alors que le pharmacien Castel, si impatient dans sa lettre, a fini par retrouver Henri Dufau. Ou peut-être alors que ce dernier n’a jamais répondu, échaudé par ses six mois de prison, ou bien amoureux d’un autre. Mais le 11 décembre 1878, La Victoire de la Démocratie a livré, malgré la charge virulente portée à l’encontre du couple, les traces qui manquent aujourd’hui à l’historien pour écrire une histoire des homosexualités, celles d’une lettre d’amour.