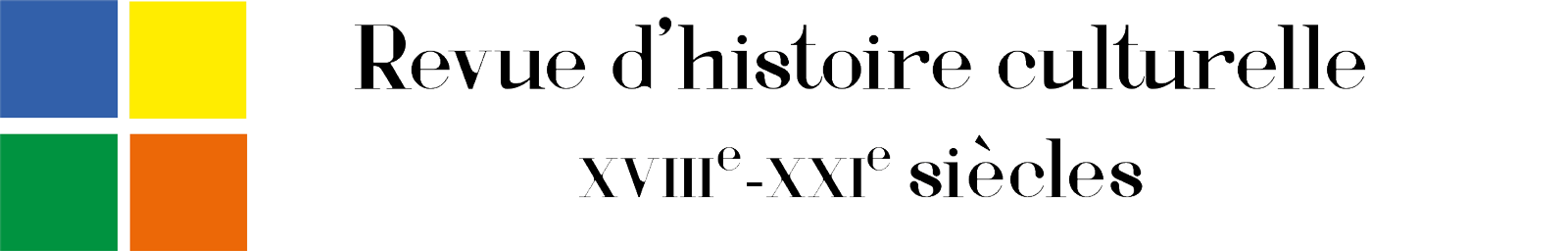Organisés à Paris le 20 août 1922, les premiers Jeux olympiques féminins rassemblent 77 sportives venues de Grande-Bretagne, des États-Unis, de Suisse et de Tchécoslovaquie pour s’affronter dans treize épreuves d’athlétisme. Ils seront moteurs pour l’institutionnalisation des sports féminins dans de nombreux pays. De fait, trois éditions suivront en 1926 à Göteborg, en 1930 à Prague et en 1934 à Londres. Les compétitions parisiennes, modestes en apparence, attirent plusieurs milliers de spectateurs-trices : des curieux de découvrir une élite sportive féminine, des patriotes venus soutenir leur drapeau, des femmes pour applaudir des femmes, des hommes soupçonnés de concupiscence et de très nombreux journalistes pour rendre compte de cette nouvelle tocade du « sexe faible ». Au sein de ce public varié, les dirigeants des milieux politiques et sportifs sont remarquablement absents, à l’exception du député Henry Paté, alors président d’honneur de la Fédération féminine qui organise les Jeux.
Historiquement situés entre la publication du roman La Garçonne, en juillet, et le vote du Sénat contre le suffrage féminin en novembre, ces Jeux cristallisent bien les contradictions de leur époque : la volonté des femmes de prolonger les libertés gagnées pendant la Guerre dans une société patriarcale qui souhaite un retour à la tradition. Pour les Jeux olympiques créés en 1894, l’opposition du fondateur Pierre de Coubertin (1863-1937) à la participation des femmes est bien connue. S’il a longuement écrit tout au long de sa vie sur l’intérêt et la place du sport dans l’éducation, ces questions pédagogiques et sociales ne s’adressent, selon lui, qu’aux jeunes hommes, non pas qu’il interdise totalement la pratique sportive aux femmes – les femmes de sa famille pratiquent couramment –, mais il la restreint à la sphère privée, loin du public pour des raisons morales, et la recommande sans excès1. Quelques femmes se glissent toutefois dans les Jeux dès 1900, au bon gré des organisateurs. Pour tenter d’y mettre un terme, Coubertin porte la question au premier point de l’ordre du jour du Congrès olympique de 1914, chargé de fixer le programme sportif des prochaines olympiades, et qui adopte finalement le statu quo, c’est-à-dire quelques femmes en tennis et en natation2.
À cette date, il est vrai que le mouvement sportif féminin n’est pas encore organisé. Mais, le conflit mondial et l’absence des pères de famille ouvrent la porte des sports aux jeunes filles. Femina sport, premier club exclusivement féminin, créé en 1912, change ses activités à partir en 1915 avec sa nouvelle présidente, Alice Milliat (1884-1957). Aux cours de gymnastique à visée hygiénique et esthétique s’ajoutent désormais les pratiques sportives, comme dans les deux autres nouveaux clubs parisiens, Academia et En-avant, créés en 1915. À la suite d’un premier championnat de France d’athlétisme organisé en 1917, une Fédération des sociétés féminines sportives de France (FSFSF) est créée par des hommes en 1917. Nommée secrétaire, Alice Milliat en prend la présidence en 1919 et y transpose ses idéaux d’égalité des sexes en féminisant son administration et en proposant aux adhérentes tous les sports, en loisir comme en compétition3. À partir de 1918, la dirigeante s’appuie sur les docteurs et doctoresses de son entourage pour montrer que les sports fabriquent les mères de demain, contribuant ainsi à régénérer la « race ». C’est un succès pendant quelques années, la FSFSF est même reconnue d’utilité publique par le ministère de la Guerre dès 1919. Pourtant, les hostilités restent nombreuses dans les milieux sportifs masculins. La majorité des fédérations sportives, qui sont nées après-guerre en quittant l’Union des sociétés françaises des sports athlétiques (USFSA), refuse d’intégrer des sportives. En mars 1920, l’Union, pourtant agonisante, crée une « commission centrale des sports féminins » qui deviendra, en novembre, la Fédération française féminine de sports athlétiques (FFFSA) à l’initiative de Gustave de Lafreté. Ce journaliste de L’Écho de Paris préside Academia, qui concurrence le Femina sport d’Alice Milliat4. Cette FFFSA est d’ailleurs immédiatement adoubée par le Conseil national des sports (CNS), l’organisme qui représente les différents groupements sportifs auprès du gouvernement, et par la nouvelle Fédération française d’athlétisme (FFA)5. Pendant les mois qui suivent, ces différentes institutions dirigées par des hommes n’auront de cesse de faire échouer la FSFSF jugée trop progressiste pour les femmes que l’on souhaite préserver de certains sports et de l’excès de la compétition. On reproche aussi à Alice Milliat d’être trop proche de la Fédération française de sports professionnels6. L’organisation des Jeux olympiques féminins par Alice Milliat et la FSFSF s’inscrit donc dans un contexte institutionnel conflictuel et hostile au modèle sportif proposé pour les femmes de cette fédération.
Bien connu des historiens du sport français et étrangers depuis l’article précurseur des Américaines Mary Leigh et Thérèse Bonin en 19777 jusqu’à la thèse de Florys Castan-Vicente soutenue en 20208, cet événement inédit n’a pourtant jamais fait l’objet d’une étude spécifique. Comprendre sa genèse au début des années 1920 nécessite d’identifier les réseaux internationaux mobilisés par Alice Milliat, pourtant une simple sténodactylographe polyglotte, et de faire l’inventaire des réactions d’hostilité des milieux masculins du sport et des médias. C’est ce que nous proposons de faire ici, au croisement de l’histoire du sport et des circulations culturelles, de celle du genre et des féminismes mais aussi des internationalismes et des transnationalismes.
Le corpus utilisé rassemble sources primaires et sources imprimées : les archives de la FSFI9 et de la FFA10, les bulletins mensuels de la FSFSF11. Pour la presse française, vingt-et-un quotidiens français12 ont été dépouillés la veille, le jour et le lendemain de l’événement. Le Journal, qui patronne les Jeux, a été consulté chaque jour à partir du premier article, paru le 3 août. La presse sportive, quotidienne comme L’Auto ou hebdomadaire comme Le Miroir des sports et L’Écho des sports, a été consultée un mois avant et un mois après les compétitions. Enfin, l’hebdomadaire féministe La Française a été regardé une semaine avant et une semaine après les Jeux. Pour la presse étrangère, nous avons exploré les sites suivants à partir des noms d’athlètes : The British Newspaper Archive pour le Royaume-Uni, Scriptorium pour la presse vaudoise en Suisse, BelgicaPress pour la Belgique, Library of Congress et le New York Times pour les États-Unis.
En fondant en novembre 1921 une Fédération sportive internationale féminine (FSFI), Alice Milliat invente un internationalisme sportif féminin inspiré à la fois par l’exaltation des patriotismes fin-de-siècle des Jeux olympiques de Coubertin et par les pacifismes des internationales féministes d’après-guerre. Il reste que son projet est étroitement lié au paysage institutionnel français et à la survie de la FSFSF qu’elle défend face aux organisations concurrentes sous tutelles masculines. Il s’agira donc aussi de présenter les compétitions du 20 août et le profil socio-culturel des jeunes filles qui y participent. Enfin, l’analyse de la réception de ces Jeux olympiques féminins met au jour un antiféminisme violent dans la presse et dans les milieux sportifs de manière générale, d’autant que journalistes et dirigeants du sport sont souvent les mêmes personnes.
La réplique d’Alice Milliat au meeting de Monte-Carlo (mars 1921)
En août 1926, à la veille des deuxièmes Jeux féminins, Alice Milliat rappelle devant les congressistes de la FSFI qu’elle s’est heurtée à un « refus formel » du baron de Coubertin à sa demande d’introduction aux Jeux olympiques d’un programme athlétique féminin complet [pour les Jeux de 1920 à Anvers], « et c’est de là que naquirent les Jeux féminins dont les premiers eurent lieu à Paris en 192213 ». Toutefois, la littérature spécialisée affirme depuis une quinzaine d’années que Milliat aurait organisé un meeting international à Monte-Carlo en mars 1921 et que le succès de ce dernier aurait motivé la création de la FSFI, puis les JO féminins de 1922. C’est ce qu’avance Thierry Terret dans un article de 2007 lorsqu’il écrit que « Alice Milliat prend alors l’initiative, avec le soutien indispensable de L’Écho des sports et du Comité olympique monégasque d’organiser un “premier meeting international d’athlétisme, d’éducation physique féminine et de sports féminins”14 ». Or, l’auteur s’appuie explicitement sur un travail antérieur d’André Drevon, dont il extrapole les conclusions15. Republiée dans un article en anglais en 201016, cette idée a depuis fait école17. Pourtant, si Milliat est bien citée dans le comité d’honneur de la manifestation, comme le note Drevon, elle l’est en tant que présidente de la FSFSF, aux côtés d’une cinquantaine d’autres dirigeants. Par ailleurs, ce n’est pas le comité olympique monégasque qui est à l’origine de l’évènement, mais l’International sporting club de Monaco présidé par Camille Blanc. Enfin, la cheville ouvrière de l’organisation, Marcel Delarbre, qui est bien journaliste à L’Écho des sports, est surtout aussi le vice-président de la FFA, adversaire de la FSFSF, ce qui constitue une clé de compréhension essentielle pour saisir l’évènement. La connaissance du paysage institutionnel de l’après-guerre et une reconstitution fine des activités de la FSFSF après mars 1921 permettent de démontrer comment et combien la FSFI et les Jeux féminins de 1922 sont nés en réaction aux rencontres monégasques.
La FSFSF organise le championnat national d’athlétisme féminin depuis 1917, alors que la FFA n’existe pas encore. En initiant des compétitions internationales inédites en mars 1921, la FFA occupe un nouveau terrain, en quelque sorte. Surnommées par la presse « Olympiades de la grâce »18, les rencontres de Monaco accueillent aux côtés des Françaises, des Britanniques, des Suisses, des Italiennes et des Norvégiennes qui s’affrontent dans quelques épreuves d’athlétisme et de basket-ball, certes, mais surtout dans diverses démonstrations de gymnastique et de danse exaltant les qualités supposées de la « féminité ». Le journaliste sportif Pierre Pelletier s’en félicite :
Le meeting a conquis la foule, parce que les organisateurs avaient su éviter que les exercices athlétiques ne « masculinisent » les sportives ; parce qu’ils surent démontrer, par un spectacle vraiment athlétique, que l’éducation physique n’était pas ennemie de la grâce, bien au contraire ; parce qu’ils surent faire alterner avec les compétitions sévères du sport pur : course à pied, concours classiques, les démonstrations collectives des diverses méthodes d’éducation physique. La femme s’y montra vraiment femme, dans tout ce que ce mot renferme de charme, de grâce et de beauté19.
Ces compétitions sont en fait l’élément déclencheur pour Milliat et ses idéaux émancipateurs20. En effet, perdre la main sur le sport international entraînerait de facto le déclin de la FSFSF qui ne serait habilitée ni à homologuer les records, ni à sélectionner les participantes et surtout pas à choisir le programme sportif. Ainsi, dès le mois de mai, la FSFSF lance son propre organe de communication, un mensuel intitulé La Femme sportive – en écho peut-être à La Femme socialiste paraissant depuis 1912 à l’initiative de la féministe Louise Saumoneau. Après avoir présenté dans le deuxième numéro les records de France d’athlétisme reconnus par la Fédération, l’édition du 1er juin 1921 souligne les records américains et annonce la création d’une future Fédération internationale, liée à la FSFSF et dont le siège sera à Paris. Puis, à partir de l’été 1921, les premiers échanges internationaux d’athlétisme s’enchaînent à l’initiative de Milliat : le 31 juillet, Femina sport de Paris invite Femina sport de Genève à l’occasion de sa fête annuelle21 ; le 28 août, les Françaises se déplacent à Bruxelles où l’on prévoit de se rencontrer tous les ans, en Belgique les années impaires, en France les années paires22. En septembre, puis en octobre, deux déplacements de « propagande » sont organisés en Espagne où les sports féminins sont encore peu développés23. Enfin, les 30 et 31 octobre, la FSFSF accueille les sportives anglaises pour une rencontre d’athlétisme et un match de football24.
Le congrès fondateur de la FSFI (octobre 1921)
C’est à cette date, en présence de deux représentants du sport féminin britannique, d’un délégué pour la Tchécoslovaquie, d’un journaliste italien de la Gazetta dello sport de Milan et de deux pouvoirs donnés par les États-Unis et l’Espagne que Milliat et ses soutiens français organisent le Congrès de fondation de la FSFI. Un état des lieux de l’institutionnalisation du sport féminin dans le monde est présenté, montrant un alignement pragmatique plus qu’idéologique sur le Traité de Versailles et la Société des Nations :
Certains pays où le sport féminin est en voie de développement ont fait savoir qu’ils procèdent à leur organisation nationale et qu’ils approuvent le principe de la FSFI. C’est en particulier le cas de la Suisse, de la Yougoslavie, de la Chine.
Il y a un pouvoir féminin aux États-Unis, un en France, un en Tchécoslovaquie, un autre officieux en Grande-Bretagne, un en formation en Espagne. D’autres nations ne sont pas là : la Suède, l’Allemagne, l’Autriche. L’Allemagne et l’Autriche seront admises à la FSFI lors de leur admission à la Société des nations. […] La Suède et la Finlande désirent rester chez elles pour le moment, mais le jour où l’Allemagne fera partie de la FSFI les Scandinaves suivront.
[…] Voici, entre autres, les cinq pays importants où les sports féminins existent mais où une fédération nationale n’a pas encore été créée : l’Australie, le Sud-Afrique, la Suisse, la Belgique et l’Italie. Il faut que les fédérations affiliées à la FSFI fassent tous leurs efforts pour recueillir des précisions et des informations sur les fédérations qui peuvent se former et sur les pays où le sport féminin existe, afin que le secrétariat général de la FSFI puisse faire le nécessaire pour le développement de notre groupement25.
L’étendue mondiale des informations obtenues, jusqu’à la Chine, questionne sur les réseaux mobilisés par Milliat. Ainsi, par comparaison, le premier délégué chinois au sein du CIO, Zhengting Wang, élu en mars 1922, était présent à Paris comme délégué à la Conférence de Versailles26. Milliat ou ses soutiens masculins se seraient-ils appuyés sur les milieux diplomatiques également ? À moins que ce ne soit le réseau féministe international qui comprenait des déléguées asiatiques27, qu’aurait pu fréquenter la dirigeante française ou ses proches, comme la doctoresse Marie Houdré, féministe bien identifiée d’après la notice qui lui est consacrée dans Le Maitron. De toutes ces organisations féminines nationales, affiliées ou en formation, celle des États-Unis représente le plus gros enjeu et la plus grosse prise pour Alice Milliat. Elle l’explique d’ailleurs dans L’Auto quelques jours plus tard :
Il y eut d’abord un rapprochement entre la France et les États-Unis […]. Ce ne fut que lorsque l’accord entre l’Amérique et la fédération française fut scellé, que Mme Milliat s’adressa à l’Angleterre, à la Tchécoslovaquie et à l’Espagne afin de former un groupement plus important et plus compact28.
Le ralliement du Nouveau monde apporte d’abord le gage d’un véritable internationalisme, le sérieux d’une fédération qui s’étend au-delà de l’Europe. Pierre de Coubertin l’avait déjà compris en plaçant l’Américain William Sloane dans son premier CIO en 1894 et en accordant les 3e Jeux olympiques à Saint-Louis (Missouri). Et depuis les premiers Jeux d’Athènes, la suprématie américaine reste inégalée en athlétisme masculin. Les États-Unis sont aussi un modèle pour les luttes féministes réformistes puisque le Congrès vient de ratifier en juin 1920 le 19e amendement en accordant le suffrage féminin. Chez les sportives, le National Women’s Track Athletic Committee organise des rencontres scolaires et universitaires dès 1904, bien avant les pays européens. Les records mentionnés dans le bulletin de la FSFSF du mois de juin montrent d’ailleurs l’incontestable avance des sportives américaines sur les Françaises. Leur présence aux futurs Jeux olympiques féminins constitue une victoire pour la crédibilité de la FSFI et un progrès décisif par rapport au meeting de Monte-Carlo. Encore faut-il aussi s’assurer d’un nombre suffisant d’équipes nationales, faire accepter les déplacements des jeunes sportives et trouver des financements.
La préparation des premiers Jeux olympiques féminins
Si la nouvelle fédération affirme sa volonté de contrôler désormais toutes les rencontres féminines internationales, elle ne s’engage pas immédiatement à créer une compétition mondiale et régulière. D’ailleurs, sur les quatorze fédérations sportives internationales masculines existantes en 1921, seules celles de cyclisme sur piste et de tennis, deux sports historiques, peuvent se permettre des rencontres internationales. Pour les autres grandes fédérations précoces comme la FIFA (football), l’IAAF (athlétisme), la FISA (aviron) ou la FINA (natation), les Jeux olympiques font fonction de championnats du monde tous les quatre ans. Quant à la gymnastique, au patinage, à la lutte gréco-romaine et au tir sportif, plus secondaires, leurs championnats en restent à l’échelle européenne. On comprend alors que la FSFI reste d’abord prudente sur une organisation qui serait difficile et coûteuse. Toutefois, les rencontres avec les pays voisins continuent leur cours. Et le 1er janvier 1922, la FSFSF annonce dans son organe mensuel le projet d’une réunion internationale d’athlétisme pour le mois d’août29. Dès lors, on peut suivre chaque mois dans La Femme sportive la lente augmentation du nombre des nations inscrites. Le 1er juillet, sept pays sont annoncés – alors qu’ils ne seront que cinq. En vérité, les participations restent incertaines jusqu’au dernier moment. Le 20 juillet, L’Auto annonce l’arrivée en France de l’équipe du Panama, une photo est même publiée dans Le Journal30, mais finalement seules deux des filles participeront aux Jeux, et dans l’équipe américaine. Le 2 août, le quotidien sportif présente cette fois la participation de la Hollande, de la Belgique et de la Roumanie, que l’on ne verra définitivement pas à Paris le 20 août. C’est étonnant en ce qui concerne la Belgique, puisque celle-ci venait d’organiser ses deuxièmes championnats nationaux en présence d’une cinquantaine de filles issues d’une quinzaine de clubs, dont un « Femina sports », aussi, de Bruxelles. Ces dernières s’étaient également déplacées aux deuxièmes rencontres de Monte-Carlo en avril 192231. En fait, placées sous la direction masculine de la Ligue belge d’athlétisme, les sportives n’ont probablement pas eu l’autorisation de participer à ces Jeux dissidents de la FFA, l’équivalent français de la Ligue belge. On s’étonnera aussi de l’absence de l’Italie et de l’Espagne qui étaient toutes deux représentées à la création de la FSFI. Quelques Italiennes, pourtant, avaient concouru en athlétisme, basket-ball et gymnastique à Monte-Carlo en avril, quelques mois avant l’arrivée de Mussolini au pouvoir. Le régime fasciste leur permettra de créer leur fédération sportive en 192332, malgré une vision conservatrice des femmes dans ce pays, ce qui leur permettra de participer aux Jeux de Göteborg en 1926. En revanche, que ce soit avant ou après le pronunciamiento de Primo de Rivera en 1923, on ne verra jamais l’Espagne dans les Congrès de la FSFI ou dans les Jeux, malgré le droit de vote acquis aux femmes en 1931. Les équipes présentes à Paris en 1922 viennent donc des États-Unis et des trois pays européens que les athlètes de la FSFSF ont pu rencontrer au cours de l’année passée : les Anglaises, les Suisses et les Tchécoslovaques. Les contacts avec les Anglaises et les Suisses ont été pris directement entre les sportives présentes à Monte-Carlo en mars 1921 et avril 1922. Pour les Tchécoslovaques, absentes en mars 1921, mais présentes à la fondation de la FSFI en octobre, la connexion a pu se faire grâce à l’entourage masculin de Milliat et aux rencontres sportives organisées entre les deux pays depuis la création de l’État tchécoslovaque en 1918. Le rôle d’Émile Anthoine, ami d’Alice, semble ici essentiel. C’est un ancien champion professionnel de course et de marche sportive au sein d’une fédération en déclin mais encore active en 1921-1922, la Fédération de sports athlétiques professionnels (FSAP), dont le président assiste en tant que « conseiller » à la création de la FSFI le 30 octobre 1921.
Malgré ces incertitudes de participation, la FSFSF assure l’organisation de ces premières rencontres internationales exclusivement sportives. La promotion de l’évènement est assurée à partir du 3 août par Le Journal, un des quatre grands quotidiens de l’époque. Son directeur, Henri Letellier, un des principaux bailleurs de fonds de Deauville et futur maire, connaît bien l’importance du spectacle sportif pour l’industrie du tourisme et de la presse. En encourageant les Jeux féminins de Milliat, doit-on comprendre qu’il prend une revanche sur les compétitions internationales de Monte-Carlo, station balnéaire rivale de la sienne ?
Le fameux stade Pershing, situé au Bois de Vincennes, offert par le corps expéditionnaire américain au ministère français de la Guerre en juin 1919 pour accueillir les Jeux interalliés, est logiquement choisi comme théâtre des compétitions, avec sa capacité de 30 000 places. C’est ici déjà que Femina sport organisait quelques-unes de ses rencontres, aux côtés des professionnels de la FSAP, ou que les matchs de football féminin entre la France et l’Angleterre ont eu lieu. Le site est mis à disposition gracieusement par le nouveau propriétaire, la Ville de Paris, et la vente des billets (25 frs. en loge et 12 frs. en grande tribune) devrait assurer un revenu aux organisatrices. Si la presse ne s’accorde pas sur le nombre de spectateurs – entre 5 000 et 20 000, peut-être l’écart entre les places payantes et celles gratuites –, toutes les rédactions soulignent la « curiosité » qui les amène ce dimanche à Vincennes. C’est une vieille rengaine, à vrai dire, qui suit toutes les démonstrations publiques féminines depuis au moins le XVIIIe siècle et le vol des premières aérostières, comme si les exploits eux-mêmes comptaient moins que le sexe de celles qui les réalisent.
Les Françaises de Femina sport, les Genevoises et les Tchécoslovaques
Structurées par une fédération, un maillage national de clubs de plus en plus nombreux et un organe mensuel dynamique, les sportives françaises n’ont plus qu’à organiser leur sélection nationale qui a lieu le samedi 22 juillet à Pershing avec 71 athlètes venues de vingt-deux clubs, dont la moitié de province33. Deux semaines plus tard, une deuxième rencontre permet de sélectionner les vingt-deux titulaires et la dizaine de suppléantes de l’équipe finale, dont un tiers vient de Femina sport et deux tiers de sept clubs parisiens et de quatre de province (Lyon, Rouen et deux de Strasbourg)34. On notera l’absence des deux autres clubs féminins pionniers de la capitale – Academia et En-avant – moins favorables à la compétition pour les femmes. Les qualifiées sont toutes des « demoiselles » – à l’exception de Violette Gouraud-Morris, esprit libre, ouvertement homosexuelle malgré son mariage et divorcée en 1923 – et font déjà partie de la deuxième génération de championnes. En effet, aucune des pionnières du premier championnat de France d’athlétisme de 1917 n’est présente, aussi brillantes fussent-elles. C’est le cas de Suzanne Liébrard, par exemple, une des meilleures Françaises dont la carrière s’arrête en pleine gloire en 1919 à 25 ans, l’âge des Catherinettes, des sœurs Thérèse et Jeanne Brulé (25 et 23 ans en 1922), ou encore de Lucie Bréard (20 ans en 1922)35. Pour ces jeunes filles de milieu modeste qui goûtent un temps à la liberté de courir, la carrière sportive est probablement écourtée par l’obligation matrimoniale et/ou professionnelle. La nouvelle équipe, jeune et peu expérimentée, éprouve bien de la peine à concurrencer les redoutables athlètes d’Angleterre et des États-Unis, deux pays précurseurs où le système éducatif et universitaire organise le sport pour les femmes dans de meilleures conditions et depuis plus longtemps qu’en France. Elles dépassent toutefois, mais de justesse, leurs concurrentes venues de la Tchécoslovaquie et de la Suisse.
Dans la continuité de la Bohême qui était déjà reconnue dans le concert olympique des Nations, la nouvelle République tchécoslovaque de Masaryk confirme son indépendance par une diplomatie sportive dynamique dès sa création en 1918. Après-guerre, le quotidien L’Auto ne manque pas d’honorer ceux qui se sont alliés aux Français contre l’ennemi commun, animés par une « haine inébranlable de l’Allemand. […] Nous, Français, nous ne pouvons pas oublier que la Diète de Bohême fut le seul corps officiel du monde qui protesta publiquement contre le rapt de l’Alsace-Lorraine36 ». Dès lors, les colonnes font la publicité des nombreuses rencontres internationales organisées à Prague et des déplacements slaves dans les pays alliés, en football principalement, avec l’équipe du Sparta, considérée comme la meilleure du continent, mais aussi en athlétisme, cyclisme et natation. La capitale devient également un carrefour entre l’Est et l’Ouest avec l’inauguration de nouvelles lignes ferroviaires (Paris-Strasbourg-Prague-Varsovie) et de liaisons aéronautiques à partir du Bourget ou de Londres. Si les Tchécoslovaques mettent un coup de canif dans « le Traité de Versailles des footballeurs37 » en reprenant précocement des rencontres avec les équipes des Empires centraux dès novembre 1920, l’organisation des Jeux interalliés à Prague en juin 1921 – rebaptisés plus tard 1ers Jeux Masaryk – calme les esprits, du moins dans les pages du quotidien sportif. Des épreuves féminines y sont organisées et révèlent le talent des futures athlètes présentes à Paris38. Puis, en 1922, les meilleures sportives de Prague se déplacent à Monte-Carlo pour la deuxième édition des compétitions, et à Paris pour la fête annuelle de la FSFSF. On y présente pour la première fois le « hazena », version féminine du handball. Créé en 1906 par un professeur tchèque, ce sport de petit terrain était censé convenir aux capacités physiques supposées des femmes : « on a inventé un sport exclusivement féminin, qui réunit les qualités caractéristiques du sport masculin populaire – le football – et offre l’occasion d’exercer toutes les facultés féminines, celles du corps de même que celles de l’âme39 ». La création en 1920 d’une « Fédération tchécoslovaque de handball et de sports féminins » montre l’importance accordée à ce sport national qui prend la tutelle de l’ensemble des pratiques sportives féminines. Le hazena convainc Alice Milliat qui le fait entrer dans la nouvelle FSFI et programme une démonstration au cours des Jeux du 20 août.
L’équipe nationale tchécoslovaque qui défile dans le stade Pershing devant son ambassadeur en France est composée de dix jeunes filles dont deux homonymes sans lien de parenté, Marie Mejzlikova I et II, aussi improbable cela puisse paraître. La première, née en 1902, est la fille d’un maître-nageur, propriétaire d’une petite base nautique sur la Vltava. La seconde, née en 1903, est fille de cordonnier. Toutes deux sont venues au sport par la pratique du handball40.
Plus petite équipe de ces Jeux, la Suisse présente sept participantes qui viennent toutes de Genève, sauf Melle Groslimond, installée en France et membre de Femina sport mais autorisée par le club à participer pour son pays. La cité lémanique de 120 000 habitants compte deux clubs féminins depuis 1920, sur le modèle parisien : Femina sports, populaire et féministe, créé en avril par des Genevoises et des Lausannoises, proche de l’Union sportive du travail, et qui propose notamment, comme son homologue parisien, du football à ses licenciées41 ; et Academia sports, plus bourgeois et conservateur, fondé en juin par les élèves de l’école du quartier historique des Eaux-Vives, et offrant aux jeunes filles de « la culture physique rationnelle et de l’athlétisme léger42 ». En mai 1921, la presse genevoise mentionne un troisième club féminin, le Genève-sport, mais la faible couverture médiatique locale et plusieurs rencontres avec un club universitaire de Lyon indiquent plutôt que le sport féminin est encore peu développé sur les rives du lac, et plus largement dans ce pays où le droit de vote féminin sera l’un des plus tardifs en Europe. En mars 1921, les sportives d’Academia de Genève s’étaient déplacées à Monte-Carlo, tandis qu’en juillet, celles de Femina sports étaient venues à Paris. En août 1922, l’équipe suisse est finalement emmenée par la trésorière d’Academia, Mme Reymond-Barbey, qui a aussi pris soin de créer pour l’occasion une Fédération suisse féminine aussitôt affiliée à la FSFI. Avec sa compatriote Marguerite-Hélène Apothéloz-Barberat, d’Academia également, elles sont les deux seules femmes mariées de ces Jeux. Il est vrai que ce ne sont pas n’importe quelles sportives. Mme Reymond-Barbey est la fille d’un des principaux dirigeants sportifs de Genève, président de l’association de football et d’athlétisme, membre du Parti démocratique local, tandis que Mme Apothéloz-Barberat est la jeune épouse d’Henri Apothéloz, maître réputé de gymnastique dite « suédoise », primé aux Jeux de Monte-Carlo 1921. Plus tard, dans les années 1920-1930, toutes les deux tiendront leur propre commerce43. Leur co-équipière, Marguerite Pianzola, championne de javelot, militera dans des associations féministes modérées jusqu’aux années 196044. Quant à la presse suisse, elle reste plutôt laconique sur la petite équipe de pionnières en route vers Paris et ne livrera que brièvement les résultats de la compétition.
Les « Poly girls » de Londres et les championnes de la high society américaine
En Angleterre, l’athlétisme se pratique depuis le premier XIXe siècle et y a été institutionnalisé précocement par des étudiants d’Oxbridge dès 1866. Pour les femmes, la pratique est un peu plus tardive et son organisation reste à l’échelle des clubs civils, universitaires ou d’entreprises. Pour les coordonner, la Women’s amateur athletic association (WAAA) est créée en mai 1922 spécialement pour les Jeux de Paris45, indépendamment de la fédération masculine d’athlétisme qui, comme en France, ne veut pas des femmes46. Elle se compose de sportives issues des classes moyennes et populaires urbaines, comme pour la FSFSF47. Une équipe avait concouru à Monte-Carlo en mars 1921 et montré sa supériorité par cinq victoires en athlétisme. À leur retour, les jeunes filles avaient créé le premier club féminin de la capitale, le London Olympiades Athletic Club, en hommage à ces « Olympiades de la grâce » où elles venaient de briller48. Les treize Anglaises qui concourent à Paris en 1922 ont été sélectionnées le 12 août au Paddington recreation ground, stade historique de Londres, parmi 75 candidates venues de tout le pays. « Nous sommes toutes des business girls. Certaines filles de l'équipe sont des employées de bureau et d'autres des professeures de gymnastique49 », explique Sophie Elliott-Lynn, la capitaine d’équipe de 26 ans, vice-présidente de la WAAA et future grande aviatrice50. On notera que, chez les hommes, les entraîneurs ou professeurs de gymnastiques sont, eux, considérés comme des sportifs professionnels et donc interdits de Jeux olympiques. Les Américaines s’en plaignent d’ailleurs, mais en vain51. Les filles sélectionnées sont en fait presque toutes des « Poly girls », c’est-à-dire d’anciennes élèves de la Regent street polytechnic52 (actuelle Université de Westminster), principal lieu de promotion du sport à Londres53, à l’exception de Miss Hilda Hall, de l’Université de Birmingham, université pionnière pour la diffusion de l’athlétisme chez les étudiantes, de Miss Dorothy Leach des Highgate harriers et de Miss Gwendoline Porter du Mercantile marine athletic club. Pour rassurer les sceptiques, Elliott-Lynn affirme que
nous ne faisons rien de très sérieux en matière d’entraînement, seulement deux soirées de pratique par semaine. Nous ne sommes pas strictes en matière de régime alimentaire. Les filles mangent ce qu’elles aiment, mais la plupart d’entre elles renoncent à fumer et à manger des pâtisseries lorsqu’elles s’entraînent54.
Elles ne se sentent pas menacées par les Françaises, qu’elles ont encore battues en avril 1922 à Monte-Carlo, expliquent-elles à la presse la veille de leur départ, mais plutôt par les inconnues américaines qui ont la réputation de s’entraîner bien plus qu’elles55.
De fait, les Américaines possèdent déjà les records du monde dans une grande majorité d’épreuves athlétiques, d’après le tableau présenté dans La Femme sportive du 1er septembre 1921. Et même si aucune de ces recordwomen ne fait partie de l’équipe qui se déplace à Paris, les Américaines restent naturellement les grandes favorites des Jeux avec un vivier immense de potentielles championnes, une culture sportive au cœur de l’American way of life, un développement précoce de l’athlétisme universitaire et des techniques d’entraînement avancées. D’ailleurs, les jeunes filles qui débarquent de l’Aquitania à Cherbourg le 7 août sont entourées d’un entraîneur chevronné, d’un pionnier de la médecine sportive aux États-Unis et d’une soigneuse. Flora Batson, qui est la seule à parler français, est la capitaine d’une équipe de treize jeunes filles âgées de 16 à 23 ans, dont plus de la moitié est passée par la Oaksmere School for girls (New York), une école privée réputée et fondée par Winifred Edgerton Merrill, première États-unienne docteure en mathématiques. Figure de l’émancipation des femmes par l’éducation, Mme Merrill place aussi les sports au cœur de son école et finance de ses propres deniers le déplacement et l’hébergement de ses étudiantes à Paris. Elle vient d’ailleurs d’y ouvrir une succursale en 1921, Oaksmere abroad56. Est-ce par cet intermédiaire qu’Alice Milliat a pu entrer en contact avec les sportives américaines ? L’idée est séduisante. Par exemple, Maud Rosenbaum, la lanceuse de poids de l’équipe, dont le père est un riche fabricant de chaussures de Chicago, est passée par l’école-mère et peut-être par son antenne à Paris puisqu’elle vit déjà en France en août 1922 et y fera une partie de sa vie. Et c’est bien la Oaksmere school qui prend l’initiative de la sélection nationale, et non la commission féminine de l’American physical education association en charge de l’athlétisme féminin depuis 1917 et fermement opposée à la participation des Américaines57. Après une première série de qualifications dans le Far West, le Middle West et le South58, et une invitation lancée aux établissements de la côte est, les rencontres de sélection organisées dans l’école le 13 mai puis le 4 juillet sont considérées comme la première pierre de l’histoire internationale de l’athlétisme féminin aux États-Unis59. Loin de venir des classes populaires ou de la petite et moyenne bourgeoisie auxquelles appartiennent les sportives françaises et britanniques, les athlètes américaines sont plutôt issues de la haute-société, au regard des écoles prestigieuses qu’elles fréquentent : la Rosemary Hall (Connecticut), qui accueillera John F. Kennedy par exemple, ou encore, parmi les Seven Sisters, le Bryn Mawr College (Pennsylvanie) et le Smith College (Massachusetts)60. À condition d’être chaperonnées, le voyage initiatique vers la vieille Europe fait souvent partie de l’éducation des jeunes filles de ces élites progressistes. Cela a probablement rendu la participation à ces premiers Jeux féminins plus acceptable.
La cérémonie d’ouverture et les épreuves sportives
« “Je proclame ouverts les premiers Jeux olympiques féminins du monde”. Une haute émotion passa dans la foule et fit battre les cœurs61 », commente un compte rendu enthousiaste paru dans Sportives, le bulletin de la nouvelle Fédération féminine de France, fusion de la FSFSF et de la FFFSA, placée sous la présidence d’Alice Milliat. Calquées sur le modèle des Jeux olympiques masculins, les compétitions féminines en adoptent le cérémonial et les symboles : la très solennelle proclamation d’ouverture par la présidente de la FSFI « debout au bord de la tribune officielle62 » – à défaut du président de la République pour les Jeux olympiques –, le défilé des équipes sous leur bannière, les hymnes nationaux et la montée de drapeau pour chaque victoire. Seul manque le serment de l’amateurisme, réalisé pour la première fois aux Jeux d’Anvers en 1920. Ce n’est sûrement pas un hasard de la part des organisatrices de la FSFSF à qui les dirigeants masculins reprochent leur promiscuité avec le sport professionnel et compte tenu de la participation controversée de professeures de gymnastique dans l’équipe britannique.
La rencontre est placée sous le patronage de Henry Paté, député de la Seine (Action républicaine et sociale) et président d’honneur de la FSFSF. Le Petit Journal raille l’absence de tous les dirigeants du sport masculin, notamment Gaston Vidal, sous-secrétaire d’État à l’Enseignement technique et dirigeant sportif majeur, qui fait partie des opposants à la FSFSF de Milliat depuis 1919 et préfère inaugurer ce jour-là un monument aux morts dans un village des Vosges63. L’Auto regrette aussi « qu’aucune personnalité officielle n’était présente ou représentée ». On peut aussi se demander si le spectacle féminin a attiré davantage de femmes, d’autant que le journal féministe de Jane Misme : « [demande] à toutes les lectrices de La Française d’aller demain au stade Pershing et d’y amener le plus grand nombre de femmes64 ». Enfin, la couverture médiatique est assurée par la présence d’une large presse française, avec photographes et caméras, mais aussi des envoyés spéciaux des agences Reuter et Associated Press, laquelle souligne la présence d’une « grande foule de spectateurs américains65 ».
Malgré son avance athlétique soulignée précédemment, l’équipe américaine ne se classe qu’en deuxième position de la compétition, derrière les Anglaises. Il faut dire que, faute d’institutions nationales et de rencontres internationales, les règlements et cultures athlétiques ne sont pas encore unifiés chez les femmes, alors que les Jeux olympiques masculins ont adopté le système métrique, norme internationale depuis 1889, dès leur première édition en 1896. Les organisatrices de la FSFSF, quant à elles, choisissent un programme apparemment consensuel, entre systèmes métrique et impérial, mais en avantageant subtilement les Françaises. On compte donc trois épreuves de course en mètres et trois autres en yards. La course de haies se court en yards mais avec des haies aux normes françaises. C’est ainsi que Flora Batson, favorite au sprint, se blesse pendant les séances d’entraînement au Racing Club de France, quand « aux États-Unis, en effet, la partie supérieure des haies se rabat lorsque le pied vient buter contre66 », et que les Anglaises « sont certainement les meilleures [pour les haies], si elles veulent bien prendre l’habitude de ne pas sauter trop haut67 ». Le poids utilisé pour la compétition fait huit livres (3,628 kg) comme aux États-Unis… ce qui devrait avantager les Françaises habituées à lancer 4 kg. La course des 1000m est traditionnellement courue par les licenciées de la FSFSF, moins souvent par les Britanniques qui disputent plutôt le mile ou le half-mile, et pas du tout par les Américaines, qui auraient, de leur côté, souhaité des épreuves de triple saut et de perche, considérés comme trop dangereuses pour les femmes de ce côté-ci de l’Atlantique. Enfin, le coach américain, le Dr. Harry E. Stewart, fustige l’arbitrage d’Émile Anthoine, défavorable, selon lui, à son équipe dans la course de relais. Mécontent, il annule les démonstrations programmées de basket et de base-ball68. Pour autant, ces petites stratégies ne suffisent pas à faire passer l’équipe française ni devant les Américaines bien entraînées, ni devant les Anglaises qui avaient prouvé leur large avance aux deuxièmes rencontres de Monte-Carlo quelques mois auparavant. Quelques journalistes chauvins regrettent que « malheureusement, on [n’ait entendu] La Marseillaise qu’une seule fois69 » ou expliquent que « l’infériorité de nos sportswomen provient de ce que les États-Unis, l’Angleterre se sont mis bien avant nous aux sports féminins, et que dans ces contrées le travail y est plus sérieux et plus méthodique70 ». Il est amusant de constater que, de retour aux États-Unis, la conférence de presse du coach est teintée du même chauvinisme et d’une même mauvaise foi :
L'équipe a remporté 37 pour cent des prix, contre 23 pour les Françaises, 12 pour les Tchécoslovaques et 6 pour les Suisses. Selon lui, il s'agit d'une performance remarquable, compte tenu du fait que les Françaises sont des spécialistes dans les épreuves auxquelles elles participent. [...] "La majeure partie de notre équipe était composée d'écolières qui étaient opposées à des athlètes entraînées et chevronnées. En Europe, les femmes participent à des jeux athlétiques depuis des années, alors que l'idée est nouvelle en Amérique"71
Mais que les résultats aient été décevants pour les Américaines ou non, il est certain que cette expérience sportive outre-Atlantique a marqué les esprits de ces jeunes filles de bonne famille. Pour l’une d’entre elles, Kathryn Agar de Chicago, l’essentiel était aussi ailleurs :
Hier soir, nous nous sommes gavées de gâteaux et de bonbons et nous sommes restées dehors aussi tard que les chaperons le permettaient. Imaginez quinze jeunes Américaines pleines d'entrain se couchant à 9 heures tous les soirs pour s'entraîner en vue des Olympiades, et ne mangeant des sucreries qu'une fois par mois. Nous ne pensions pas que c'était possible, mais nous nous sentions merveilleusement bien72
Une presse française très largement opposée à la compétition féminine
Presque toute la presse quotidienne française couvre l’évènement, de l’Action française à L’Humanité. Seuls les quotidiens La Croix et Le Temps font l’impasse sur ces rencontres, trop contraires à la morale pour le premier, trop triviales, peut-être, pour le second. Malgré quelques comptes rendus neutres, voire positifs dans L’Humanité par exemple, de nombreux propos antiféministes sont lâchés à l’occasion de ces premiers « Jeux olympiques féminins », arguant de l’infériorité physique du « sexe faible » – jusqu’à nier les chronomètres enregistrés –, de la dangerosité de la compétition pour le corps des futures mères et de l’inconvenance morale à se montrer en tenue légère. Parmi l’ensemble de la presse généraliste consultée, nous avons retenu l’article du Figaro qui livre les lignes les plus réactionnaires :
Nous sommes en pleine évolution. Le foyer que nos pères constituaient jalousement tend à se transformer. L’indépendance de la femme s’affirme davantage et, de jour en jour, l’homme constate la transformation lente du boudoir en… bureau d’affaires, de la salle de bains en salle de gymnastique. Les haltères, le Sandow, les gants de boxe, les poids remplacent désormais, entre les mains de ces dames, l’ouvrage de broderie, la dentelle ou le livre. Il n’y a guère que les produits de beauté qui aient pu résister aux atteintes du féminisme !
La femme sportive, voilà la note du jour. Au début de cette insurrection contre les lois naturelles qui réglaient jadis les devoirs de la femme, nos sportives, vêtues du maillot traditionnel, se contentaient de suivre, dans les groupements où elles étaient admises, quelques manifestations sportives. Maintenant, tout est changé, rangées pour la plupart sous l’égide d’une société indépendante : la fédération athlétique du sport féminin, elles jettent leur cri de délivrance : « Plus d’homme chez nous ! »
[…] Au point de vue social, le sport féminin correspond exactement à l’organisation supposée d’un concours de tricot entre hommes. Pour l’homme, faire du sport, c’est régénérer la race, mais il appartient également à la femme de régénérer la maternité ; et les sports, pratiquer dans les conditions habituelles, c’est-à-dire violemment, sans mesure, sont de nature à affaiblir la santé plutôt qu’à développer les muscles.
Que chacun occupe donc la place naturelle qui lui échoit. Si l’homme n’avait pas l’occasion de manifester sa force, il faudrait inventer le sport. Au contraire, la femme, de par sa constitution, ne peut le pratiquer. Sa résistance est, toutes proportions gardées, aussi fragile que celle de l’enfant. Quoi qu’on dise, l’homme et la femme ont un cœur, des poumons différents. Le saut, par exemple, peut avoir, chez elle, des conséquences funestes.
Donc, éducation physique rationnelle, mais pas de sport violent. En Amérique, les femmes qui pratiquent le sport le font généralement dans des conditions raisonnables, mais avec le tempérament des Françaises, notamment, il n’y a pas de concessions possibles. C’est tout ou … rien.
Souhaitons, pour elles, la salutaire résignation.
Et puis, n’y a-t-il pas aussi une question d’esthétisme ? Dans les parties de football, par exemple, la chute d’une femme constitue-t-elle un spectacle gracieux ? Or, généralement la femme ne sait pas tomber, elle s’écroule…
Alors non, l’avenir du sport féminin n’est point à envisager. Mettons nos compagnes en garde contre l’esprit d’imitation qui les poussent à suivre l’exemple de quelques femmes exceptionnellement – nous devrions dire anormalement – douées, et que notre ambition soit de les conseiller utilement au moment où elles semblent devenir irraisonnables73.
Et de renchérir dans l’édition du lendemain :
Voilà la leçon du 400m, cette épreuve terrible pour le corps féminin, et qui le rend si peu aimable. Quelles sont ces furies toutes possédées par une sombre folie ? Leurs yeux sont hagards, leurs bouches sont crispées et je préfère ne pas parler de leurs poitrines. Dans un dernier effort elles passent la ligne d’arrivée, palpitantes, épuisées. On ne peut imaginer de spectacle plus navrant de délabrement physique74.
La presse sportive ne véhicule pas moins de préjugés, habituée pourtant à voir des femmes dans les stades depuis la Grande Guerre. Le Miroir des sports, sous la plume du champion d’athlétisme et journaliste Géo André, critique une « organisation [qui] laissa beaucoup à désirer », se plaint qu’il y avait « trop d’hommes pour une réunion de femmes. […] trop de gens parmi le public n’avaient d’yeux que pour jambes et cuisses nues et non point pour les gestes accomplis ». Concernant le record du monde sur 60m, obtenu par Marie Mejzlikova II en 7’’3/5 – soit six dixièmes de moins seulement que le médaillé d’or aux Jeux de 1904 -, « si le temps est exact, il faut l’admirer », doute le journaliste, avant de laisser son scepticisme général s’exprimer :
Il ne fait aucun doute que d’ici peu de temps, les femmes améliorent sensiblement le record car elles ont encore beaucoup à apprendre au point de vue du style. Mais devons-nous les pousser dans cette voie ? Pas encore. J’estime qu’il serait préjudiciable à la femme de brûler les étapes que nous-mêmes avons mis si longtemps à gravir. Il faut que l’élément féminin modère son ardeur. Et dieu sait si son enthousiasme est grand. En luttant d’une façon trop intensive, soit contre la montre, soit contre l’adversaire il risque de produire un travail trop intense pour un organisme insuffisamment préparé. Un des avantages et non des moindres que l’homme a présentement sur la femme est d’avoir commencé jeune et poursuivi son entraînement pendant de longues années. Le mouvement féminin est encore trop récent pour que les athlètes aient une préparation suffisante pour les efforts prolongés tels que les 300 et 1000 mètres. Peut-être viendra-t-il un temps à la suite de plusieurs générations où les femmes pourront se permettre les mêmes efforts que nous, mais ce moment n’est pas encore arrivé. L’athlétisme féminin devra se borner pour l’instant à de l’entraînement non poussé. Sauter, courir, lancer ne seront pas mauvais, mais à la seule condition d’envisager ces gestes, non point comme des moyens de compétitions, mais seulement de perfectionnement physique. Si la journée de Pershing avait servi à faire accepter cette proposition elle aurait eu un résultat très heureux75.
Si toute la presse n’est pas si conservatrice, un point de désaccord unanime ressort dans tous les comptes rendus, y compris celui du Journal ou même de L’Auto habituellement au-dessus de la mêlée des débats sur le sport féminin : l’excès physique indécent de la course des 1 000m, que l’on juge « très probablement au-dessus de leurs moyens76 », « qui peut présenter des dangers77 », car « il y a des fatigues que la femme ne doit pas s’imposer, et cela dans son intérêt et dans celui de la race78 ». Malgré ces critiques, la course de demi-fond est encore programmée aux Jeux de Göteborg en 1926, mais disparaît ensuite, après qu’une course de 800m autorisée pour les femmes aux Jeux olympiques à Amsterdam en 1928 a ému l’opinion publique mondiale.
Le sport féminin international, un enjeu dans l’Europe de l’entre-deux-guerres
Le 9 septembre 1922, la fête annuelle de la Fédération française féminine de gymnastique et de sports (FFFGS) réunit 2 000 gymnastes à Vichy issues de plus de 400 sociétés. Ce succès éclatant des gymnastiques hygiéniques et esthétiques sur le sport pourrait reléguer les Jeux olympiques féminins à un statut finalement bien anecdotique. Sauf que l’importance de cet événement se mesure plutôt à l’aune des réactions qu’il suscite chez les hommes – dirigeants sportifs, politiques, médecins ou même hommes de lettres –, mais aussi aux conséquences pour le sport féminin en France, dans les pays participants et dans le reste du monde. En France, même quand les Jeux ne sont pas mentionnés, ils sont dans l’ombre de nombreuses décisions concernant les femmes pendant de longs mois, ce qui n’est jamais relevé dans la littérature scientifique. Ainsi, quatre jours après les Jeux, le Conseil national du sport suggère que les fédérations nationales masculines prennent en main le sport féminin79. Cela reste toutefois lettre morte jusqu’en 1940 et l’injonction adressée par le gouvernement de Vichy. Du 9 au 11 septembre 1922, dans le sillage de la fête de la FFFGS, les médecins participants du « Congrès médical d’éducation physique enfantine et féminine » décident, sans consulter sportives ni dirigeantes, que seules les courses de sprint sont acceptables « tant au point de vue du développement physique et moral de la femme et de sa santé générale, qu’au point de vue de l’amélioration de la race80 ». On pourrait voir encore le traumatisme des Jeux dans les Instructions officielles du 20 juin 1923, dont la partie concernant l’éducation physique est rédigée sous la direction de Gaston Vidal : « Il appartient aux institutrices de choisir les jeux et les mouvements les mieux adaptés au sexe féminin, ceux qui donnent de l’agilité et de la grâce plutôt que ceux qui donnent de la force ». À l’étranger, les réactions misogynes ou antiféministes ne sont pas moins dures. Aux États-Unis comme en Belgique, là où les sportives étaient sous la tutelle des organisations masculines, les Jeux de 1922 les poussent à prendre leur indépendance pour continuer leur développement81. Dans les pays sans institution féminine nationale, les Jeux à venir encouragent leur création, comme l’ont fait la Grande-Bretagne et la Suisse en 1922. En 1934, pour la 4e édition, 18 nations participent et la FSFI compte trente pays affiliés. Ce nouveau réseau institutionnel international permet une homogénéisation des règlements et l’adoption du système métrique dès la seconde édition en 1926 par exemple. Enfin, au niveau international, le CIO n’ignore évidemment pas la provocation de Milliat qui ose présenter en avant-première au public parisien un cérémonial olympique deux ans avant l’organisation des Jeux de Coubertin. Agacés depuis longtemps par l’usage « abusif », disent-ils, du terme « olympique » par de nombreuses compétitions dans le monde, les membres du CIO étaient restés immobiles. Mais dès leur session annuelle de 1923, ils « font connaître qu’en France le titre “olympique” a été l’objet d’une déclaration légale faite par le Comité National Français en sorte que l’on ne peut plus s’en servir sans autorisation82 ». Ils formulent également le vœu que les Fédérations internationales masculines prennent le contrôle des sportives, en particulier l’IAAF, présidée par le Suédois Sigfried Edström, membre du CIO. Contre la fausse promesse d’une intégration complète des femmes aux épreuves d’athlétisme des JO, il obtient en 1926 que les compétitions de la FSFI s’intitulent désormais « Jeux mondiaux féminins »83.
Féminisme sportif et nationalisme
Au soir du 20 août 1922, le pari semble gagné pour Alice Milliat. Après le premier succès des rencontres monégasques, où la « grâce » féminine importait plus que l’exploit sportif, celui des Jeux olympiques féminins, débarrassés de toute démonstration de gymnastique ou de danse, marque un pas vers l’égalité des sexes, dans la vision égalitariste de Milliat. Ils gagnent aussi en légitimité avec la participation inédite des Américaines. L’année qui vient de s’écouler a aussi permis à la dirigeante française de l’emporter en absorbant la FFFSA au sein de la FSFSF. La réussite des Jeux, malgré les réactions misogynes et antiféministes qu’ils suscitent, la laisse donc pour un temps en position de force dans le paysage institutionnel sportif français et international.
La création de la FSFI en 1921 s’inscrit dans le contexte de reprise des relations internationales féministes, animées par des idées pacifistes qui prennent source notamment dans la culpabilité des femmes d’être encore en vie, comme le montre Christine Bard84. Cependant, il nous semble plus juste de la rapprocher d’une « Internationale des nationalismes » pour la volonté de ses dirigeant-es de reproduire le modèle main stream des organisations sportives masculines, plutôt que d’un internationalisme pacifique d’une Alliance internationale pour le suffrage des femmes, par exemple85. Le projet de Coubertin était de rapprocher les peuples par le sport, mais sans effacer les patriotismes86. Les Jeux olympiques féminins ne proposent rien d’autre en adoptant le défilé des athlètes par nation, plutôt que par disciplines sportives par exemple, ou en affiliant des organisations nationales plutôt que des clubs. Des modèles alternatifs de rencontres sportives seront inaugurés par les Internationales rouges, mais plus tard dans la décennie. Pour l’heure, la FSFI reste pragmatique devant sa fragilité, en suivant la position des Alliés au sein de la SDN malgré sa volonté « de resserrer encore davantage les liens de bonne amitié entre les nations87 » ou en faisant des concessions sur la définition de l’amateurisme, problématique centrale du sport dans l’entre-deux-guerres.
Si l’égalité des sexes par le sport que sous-tend le projet de Milliat se révèlera une utopie quinze ans plus tard, les premiers Jeux olympiques féminins de Paris en 1922 portent l’espoir de nombreuses jeunes femmes pour qui l’apparente frivolité du droit de courir, notamment dans le cadre de compétitions nationales et internationales, paraît peut-être plus accessible que celui de voter ou encore de peser dans les négociations politiques d’après-guerres.