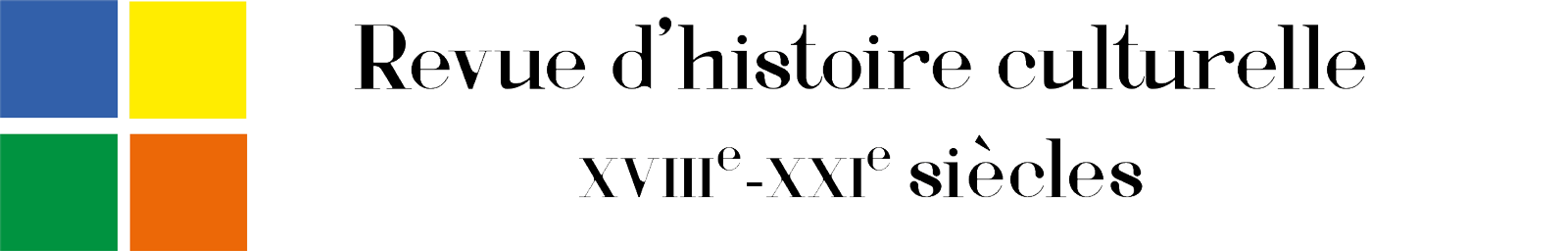L’océan Atlantique est devenu un laboratoire à l’usage d’une histoire culturelle dialoguant avec d’autres disciplines pour observer les phénomènes de circulation, comme l’attestent les travaux de Ludovic Tournès ou le programme entrepris avec le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche autour d’un dictionnaire d’histoire culturelle transatlantique, programme coordonné par Anaïs Fléchet. Ce livre confirme l’intérêt de ce « laboratoire privilégié » (Sandrine Teixido, p. 176). L’heure n’est plus à une vision « diffusionniste » de l’« américanisation », ni même à une vision moins asymétrique des échanges culturels qui ne concerneraient que le nord de l’espace océanique (entre les États-Unis et l’Europe). Cet ouvrage s’inscrit dans cette orientation et, à partir, d’un relevé précis et riche (qui ne peut bien sûr atteindre l’exhaustivité) d’échanges musicaux singuliers, apporte de nombreux éléments relançant la recherche vers de nouveaux horizons. Philippe Poirrier et Lucas Le Texier ont, dans un livre dont l’objet est clairement défini dans une introduction stimulante, rassemblé 18 études originales, issues de champs disciplinaires différents dialoguant avec l’histoire culturelle.
Le titre de l’ouvrage est peut-être trop modeste. Les études rassemblées ne traitent pas exclusivement d’objets musicaux mais s’inscrivent dans une histoire culturelle globale du second XXe siècle. Apparaissent ainsi, dans une approche dynamique des circulations, des objets textuels, par exemple les écrits de Lester Bangs évoqués par Gérôme Guibert ; les cultures visuelles ne sont pas absentes. Le cinéma, la télévision ne sont pas uniquement des médias mais des éléments d’une culture au même titre que la musique qu’ils diffusent. La contribution de Fanny Beuré met en évidence une inspiration française picturale qui a atteint Hollywood et transformé les comédies musicales. Dans l’article qu’il consacre aux « musiques vidéalisées », Julien Péquignot affirme que s’il y eut exportation, c’est beaucoup plus d’un modèle de télévision que d’une musique ou d’une culture particulière » (p. 241). La pratique des langues est évoquée en n’éludant pas les travaux de sociolinguistiques (Michael Spanu). François Ribac met en évidence l’influence, technique et esthétique, que le cinéma parlant hollywoodien des années 1930 a pu exercer sur les enregistrements des Beatles. Une approche sociale des formes de sociabilité dans le cadre des festivals est au cœur de la contribution de Florence Tamagne qui montre que l’on ne peut pas considérer les festivals européens d’Amougies, en Belgique, à Mont-de-Marsan comme de simples copies du modèle américain de Woodstock, d’ailleurs souvent mal connu en Europe. Là encore, selon Florence Tamagne, il importe de ne pas « sous-estimer l’importance des images, fixes ou animées » dans les circulations musicales transatlantiques. Yves Santamaria insiste sur « la place majeure du Septième art dans la diffusion du rock » (p. 84). La performance musicale elle-même comprend des aspects sociaux et des formes de réactions corporelles, comme la danse, qui relèvent de ce que Philippe Bergy, citant Christophe Small, appelle le musicking (p.169) pour insister sur tout ce qui touche « au code de comportement » ou à « l’ensemble des usages festifs » (p. 162).
Les éléments non strictement musicaux convoqués dans les études rassemblées ne peuvent, certes, dans le cadre de ce volume être approfondis et donnent envie de lire ou d’entreprendre de nouveaux travaux partant de pistes lancées dans l’ouvrage collectif. Par exemple, la piste religieuse et politique questionne et stimule le lecteur, le goût pour l’hybridité des cultures populaires de l’Amérique latine qui renverse le sens des courants traditionnels s’accompagne de ce que Sandrine Teixido appelle des « apports religieux ». L’intérêt pour le rastafarisme jamaïcain mériterait peut-être un point plus systématique que ce soit à propos de l’Europe mais aussi l’Afrique, avec « le cas ivoirien » étudié par Jérémie Kroubo Dagnini. Dans cet article sur la circulation des musiques jamaïcaines, Jérémie Kroubo Dagnini précise de façon très utile des enjeux culturels et politiques portés par le reggae et les autres musiques jamaïcaines en Angleterre ou en Afrique, dans la dénonciation du néocolonialisme ainsi que du racisme et de la ségrégation subie dans les sociétés européennes. Il faudra sans doute, dans des travaux à venir, recontextualiser ces enjeux politiques des années 1970 qui voient la musique jamaïcaine accéder à un succès mondial, en ne négligeant pas la vie politique intérieure de l’île, dominée par deux forces politiques majeures, appuyées, chacune, par un puissant appareil syndical : le JLP, travailliste, modéré et le PNP (Parti National du Peuple) qui se réclame d’idéaux révolutionnaires. En 1972, le PNP est d’ailleurs devenu majoritaire (avec le soutien actif des plus célèbres musiciens de reggae, dont Bob Marley) et son dirigeant Michael Manley, Premier ministre, est accusé par les États-Unis de se rapprocher de Cuba. L’attrait exercé par le castrisme pourrait également être analysé comme phénomène lié aux circulations musicales. Ce qu’atteste le disque de Jean Ferrat, sorti en décembre 1967 chez Barclay, avec des chansons évoquant son récent voyage à Cuba. On pourrait également évoquer, outre l’exemple des musiciens brésiliens exilés, connus grâce à Anaïs Fléchet, celui des musiciens chiliens après le coup d’Etat militaire de Pinochet. On connaît bien, en France, les Quilapayún alors que les Inti-Illimani sont réfugiés et actifs en Italie.
Cette référence à l’Italie permet de poser une question majeure soulevée par l’ensemble du livre : celle des limites géographiques de l’espace atlantique. Alcide De Gasperi, président du Conseil italien démocrate-chrétien, n’hésitait pas à présenter son pays comme un pays atlantique, bravant la géographie pour assoir une alliance politique décisive. Cette américanisation de la culture italienne est portée par l’armée victorieuse et ses moyens de diffusion liés à l’OTAN, mais aussi comme le montre Marilisa Merolla, de façon parodique, par le Napolitain Renato Carosone (« Tu vuo' fa' l'Americano »). La contribution de Philippe Birgy montre bien comment l’italo disco est opportunément apparu pour répondre aux besoins des clubs américains (p. 160). De façon générale, on assiste, selon Philippe Birgy, à « au moins quatre allées-venues entre les deux côtés de l’Atlantique via l’Italie ».
Alain Mueller et Marion Schulze font appel au terme braudélien de géohistoire « pour rendre compte de processus de (re)composition historique dans lequel les contextes géographiques se placent au premier plan » (p. 263) mais l’ensemble de l’ouvrage est traversé par de telles interrogations sur la pertinence d’échelles choisies pour étudier un phénomène de circulation culturelle. L’espace transatlantique semble ainsi tiraillé dans un mouvement d’allure centrifuge. Le contexte de la globalisation culturelle favorise des interrogations qui ne se limitent pas aux rives de l’Atlantique et à une frange côtière. L’exemple de l’Italie n’est pas un cas isolé. Loïc Riom donne comme exemple de cette « résonnance globale » le fait que les anthropologues découvrent « que des Zurichois puissent jouer de l’indie rock comme des New-Yorkais » (p. 262). La Suisse neutre est ainsi incorporée à l’espace musical atlantique globalisé. Dès lors pourquoi conserver la dichotomie de la Guerre froide pour étudier des phénomènes de circulations musicales qui ont pu traverser le Mur ? L’article de Lucas Le Texier, co-directeur de la publication, qui s’intéresse au free jazz en Europe met bien en évidence la nécessité de repenser le cadre spatial des études sur les circulations transatlantiques. Lorsqu’il aborde les musiciens qui, en Allemagne fédérale, jouent du free jazz, il trouve des artistes militants, en particulier le saxophoniste Peter Brötzmann. À cette occasion, apparaît la prestation de ce musicien engagé politiquement au Jazz Jamboree de Varsovie (p. 192). Or ce festival est un phénomène majeur de l’histoire culturelle d’Europe centrale. Il date de 1958 et illustre le bouillonnement musical jazzistique que connaît à ce moment la Pologne avec des musiciens autochtones comme Krzysztof (Trzciński) Komeda, connu pour la musique qu’il a composée, en Pologne et en Amérique, pour les films de Roman Polański ou des étrangers célèbres comme Dave Brubeck en tournée dans le pays. Les premières éditions du Jazz Jamboree avaient été dirigées par Leopold Tyrmand, écrivain dissident qui s’est exilé aux États-Unis en 1966. L’exil de musiciens d’Europe centrale a joué un rôle important dans l’évolution du jazz vers des fusions avec la sensibilité rock, avec des musiciens comme le guitariste hongrois Gábor Szabó, le contrebassiste tchèque Miroslav Vitouš ou le claviériste Jan Hammer. Peut-être l’influence des musiques nouvelles du reggae au free jazz doit-elle être aussi étudiée chez des musiciens restés de l’autre côté du mur comme le saxophoniste est-allemand Ernst-Ludwig Petrowsky.
Lucas Le Texier cite la version interprétée en 1974 par Peter Brötzmann du Einheitsfrontlied, « hymne du mouvement ouvrier allemand », composé par Hanns Eisler qui est mort à Berlin-Est mais qui a vécu la Guerre en exil aux États-Unis avant d’être dénoncé par sa sœur comme espion soviétique. Or, peu de temps avant le concert de Varsovie, la chanson politique d’Eisler a été reprise dans un disque américain de Charlie Haden, sorti en 1970 sous label Impulse ! La présence de l’Europe centrale et orientale dans l’espace culturel « transatlantique » est perceptible. « Le pouvoir émancipateur » des musiques africaines et caribéennes évoquée par Jérémie Kroubo Dagnini est manifeste dans les choix de la chanteuse d’origine est-allemande Nina Hagen. Après avoir chanté Janis Joplin en Pologne et enregistré quelques disques en Allemagne de l’Est, elle passe, en 1976, avec son beau-père Wolf Biermann (déchu de sa nationalité) à l’Ouest et enregistre, dans un deuxième album « occidental » un African Reggae. Il n’a pas fallu attendre l’effondrement du Bloc soviétique et l’adhésion de pays qui s’en sont détachés à l’OTAN pour constater la présence du rock en Allemagne de l’Est (étudiée par Michael Rauhut) ou en URSS (Anna Zaytseva). Mais il est vrai que les années 1990 ont conduit à une certaine homogénéisation culturelle, également par l’introduction sur un marché mondialisé de musiciens « de l’Est ». On peut penser au groupe Gogol Bordello animé par le guitariste Eugen Hütz (né en Ukraine) qui joue du « gipsy punk » ou au « romano punk » du groupe tchèque Gipsy.com. En Hongrie, le festival étudiant de l’île d’Óbuda est devenu un festival international (Sziget) dans les années 1990. Mais l’influence de Woodstock est largement relayée par des événements d’une sociabilité musicale juvénile qui se sont déroulés en Allemagne.
Le livre mentionne ainsi, à juste titre, à plusieurs reprises le premier festival d’Essen (Internationalen Essener Songtage) (p. 198, 210). Florence Tamagne y décèle un modèle contre-culturel. Or la programmation est, à bien des égards, un défi à la logique des blocs. En 1968, pour la première édition le jazzman Peter Brötzmann qui ne cache pas ses sympathies communistes côtoie les Mothers of Invention, groupe de Frank Zappa qui est devenu par la suite un proche de Václav Havel et une figure de référence pour la sortie du communisme. L’Europe centrale et orientale n’est pas absente de temps forts populaires de célébration des échanges musicaux transatlantiques. Élizabeth Jacquinot, dans l’ouvrage présenté ici, a bien identifié la multitude de références culturelles sollicitées dans le Sacha Show de Sacha Distel, avec un fort tropisme brésilien. Dans l’émission du 7 novembre 1964, Distel a invité le célèbre guitariste brésilien Baden Powell ; il parodie la présentation d’une émission de musique classique en parlant d’un « quatuor à cordes » et cite Baden Powel ainsi que Elek Bacsik (« guitariste tzigane »), le jeune Boulou Ferré (« guitariste gitan ») et se présente comme un « guitariste russe). Ce quatuor de guitaristes reprend d’ailleurs le thème de Bluesette, standard de jazz récent, cité par Olivier Bourderionnet (p. 115) comme « une valse bien connue » de l’harmoniciste et guitariste belge Toots Thielemans.
Un des apports majeurs de l’ouvrage est d’inclure l’Afrique dans l’aire de circulation musicale transatlantique. Le continent n’est pas seulement un réservoir passif de traditions exploitées par l’industrie musicale mais un acteur de la mondialisation culturelle avec des échanges entre le Nord et le Sud des deux côtés de l’Océan. Le succès européen de Chris McGregor et de la Brotherhood of Breath (p. 192) donne au jazz sud-africain un aspect politique de lutte contre l’Apartheid. Les travaux de Denis-Constant Martin pourraient, à cet égard, figurer dans les références. Le livre dirigé par Philippe Poirrier et Lucas Le Texier met bien en évidence la nécessité de penser les circulations musicales comme un ensemble mêlant des formes de diffusion asymétrique et des phénomènes d’aller-retour ainsi qu’une multitude de situations et de conflits (sur chaque rive, à des échelles différentes) révélés par le voyage transatlantique. Alpha Blondy conteste la présence de l’armée française sur un rythme de reggae (p. 152).
La British Invasion, excellent exemple de ce que l’on pourrait appeler un « contre-transfert » est analysée de façon critique et détaillée dans l’ouvrage. Les groupes anglais ne constituent pas une armée en ordre de marche à la conquête du marché américain. Le voyage en Amérique a bien été une épreuve mettant à mal la cohésion des groupes. Philippe Gonin raconte d’étonnants épisodes de la British Invasion : les tournées du Floyd en Amérique ont été un véritable enfer. Les musiciens de Pink Floyd ont, en effet, été bloquées par les autorités, victimes de vol de matériel avant de connaître la gloire. On sait à quel point le bassiste Roger Waters a été excédé par « un nouveau public, définitivement plus bruyant, souvent moins attentif » (p. 135). C’est, comme le montre Philippe Gonin, l’Amérique qui a révélé les cassures qui opposaient des membres du groupe, surtout Roger Waters aux autres.
Le livre ouvre, enfin, une autre piste très stimulante : l’évocation de ce qui ne circule pas, des obstacles, des échecs commerciaux dans la diffusion de productions musicales d’Outre-Atlantique, des blocages du public. Sandrine Teixido résume bien la question : « La description des expériences particulières montre bien l’existence de conflits et d’irréductibilités à l’hybridation comme la prolifération de replis identitaires ou communautaires » (p. 185). Ce phénomène en effet apparaît à plusieurs reprises dans l’ouvrage avec une intensité différente. Reprenant avec Yves Santamaria le terme de « greffe » (p. 81), on pourrait parler alors de rejet, pour la forme extrême. Des formes moindres se manifestent avec la constitution de divers degrés de protectionnisme ou de concurrence rendant inutile le recours à l’importation et permettant même de concurrencer ou d’inspirer les musiques américaines sur leur terrain. Ainsi dès avant la « période charnière » de la Seconde Guerre mondiale présentée par Renée Dickason, (p. 50), les orchestres de jazz dansant et leurs crooners s’imposent en Grande-Bretagne, en Europe mais même aux États-Unis (Ambrose, Ray Noble, Jack Hylton, Jack Payne…). Un degré supplémentaire est franchi dans les réactions chauvines caricaturées citées par Élizabeth Jacquinot : « Ah le Brésil ! Dans tous les Sacha Show on parle de Brésil ! Alors qu’il y a quand même, franchement reconnaissez-le, il y a quand même un folklore en France qui en vaut largement celui du Brésil » (p. 110). Rappelons que Jean Yanne s’était aussi amusé à figurer en bleu de travail un ouvrier proclamant qu’il n’aimait pas le rock… Un degré moindre de rejet tient simplement aux simplifications et à la méconnaissance des cultures d’outre-Atlantique. Les lecteurs européens, mêmes britanniques ne bénéficient, selon Florence Tamagne, que d’« une couverture médiatique incomplète et décalée » des festivals rock américains (p. 202). Et les adaptations européennes de succès américains du Nord ou du Sud évoquées par Michael Spanu (p. 222) fonctionnent tellement bien que le public répugne à penser qu’il ne s’agit que d’importations. C’est dire le talent des paroliers parmi lesquels se singularise l’humoriste Francis Blanche. Le public français, par exemple, associe un succès dont la musique est importée presque uniquement à son interprète : La Quête « de » Jacques Brel (musique de Mitch Leigh), L’Homme à la moto « de » Piaf (Jerry Leiber et Mike Stoller), Brigitte Bardot « de » Dario Moreno (Miguel Gustavo)… Le processus d’appropriation est alors parachevé. L’attachement affectif à ces « chansons françaises » dont la musique atteste de l’intensité des circulations musicales n’est pas incompatible avec tous les discours et toutes les proclamations d’une « résistance […] à l’américanisation » décrite par Julien Péquignot (p. 239).
Ce livre collectif fait d’une certaine façon le point sur les orientations qui se sont imposées dans le champ de l’histoire culturelle des circulations. La « doxa » qui veut que les échanges soient « unilatéralement vectorisés, des États-Unis vers l’Europe » à laquelle s’oppose (à juste titre) Julien Péquignot (p. 233) n’est peut-être plus « dominante ». Et les auteurs de l’ouvrage et d’autres chercheurs travaillant sur le sujet s’accorderont aisément à sortir de ces schémas simplificateurs. L’ouvrage apportera au lecteur de nouvelles pistes, de nouveaux terrains, de nouvelles approches pour poursuivre le décloisonnement d’un intérêt largement interdisciplinaire non seulement pour toutes les musiques, sans entrer dans la question de la légitimation, mais aussi de phénomènes culturels variés, complexes et polymorphes.