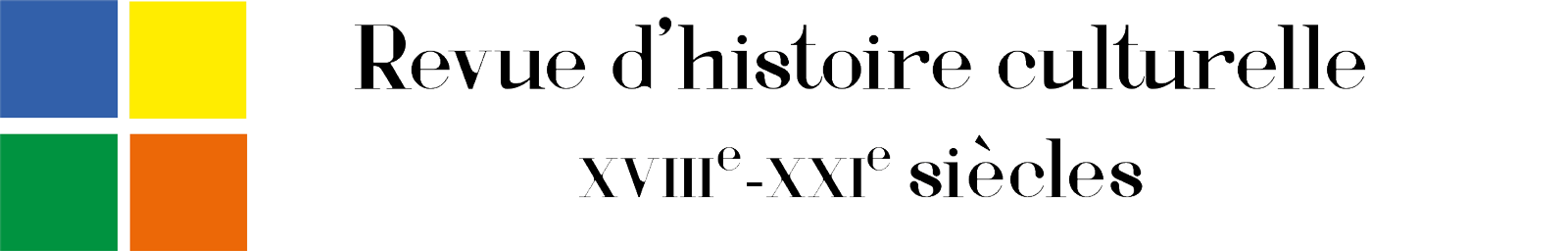Dans Les Monuments de la langue, Dominique Rouillard interroge la rivalité entre langue et architecture, ou plutôt entre leurs monuments : « laquelle représente le plus fidèlement, le plus durablement le plus visiblement la mémoire d’un peuple, d’une civilisation ? » (p. 9). Ce livre est le fruit de recherches engagées dans les années 1980, dont un premier rapport était paru en décembre 1989 pour le Bureau de la Recherche Architecturale1. La publication de 2021 réactualise les questionnements et les conclusions de l’auteure dans un contexte qu’elle qualifie de « linguistico-poststructuraliste ». Dans son premier rapport de 1989, Dominique Rouillard mettait en lumière la manière dont les rapports entre l’architecture et la langue avaient connu un renversement. La langue s’est construite à partir du XVIe siècle sur la métaphore de l’édification, faisant de l’architecture un modèle dominant pour la rhétorique et l’éloquence. Cependant, le recours dans les traités d’architecture au XVIIIe siècle aux références de la rhétorique fait basculer l’architecture d’un modèle dominant à un modèle dominé. Le rapport de force entre architecture et langue s’établit désormais à l’avantage de cette dernière. Dans l’édition de 2021, Dominique Rouillard retraverse son corpus, pour montrer que ce renversement est plus « insidieux » : la langue a dominé, mais elle a aussi déconstruit la théorie de l’architecture en remettant en cause sa capacité à produire des monuments. Là est tout l’enjeu de ses recherches : s’interroger sur les relations référentielles, conflictuelles et surtout concurrentielles entre architecture et langue, chacune prétendant à conserver la mémoire de manière pérenne.
Dominique Rouillard s’attache à démontrer les processus réflexifs « de et par la langue » (p. 13) autour de l’architecture pendant une confrontation de quatre siècles. Elle situe le point de départ chronologique au XVIe siècle, lorsque les défenseurs de la langue française ont cherché par la métaphore architecturale à imposer le français face au latin et au grec. Le chapitre « Destin commun » revient sur la manière dont la langue a été pensée comme un chantier à construire, à consolider face au grec et au latin : « la langue se doit d’être un monument, et pour en convaincre, le parallèle va s’établir avec l’architecture, qui aspire au même but : élaborer, conserver et rappeler la mémoire d’une société, affirmer une nation, représenter sa gloire. » (p. 26). Elle explique comment les opposants des citations latines et grecques dans les plaidoyers, comme Claude Fleury (1664), élèvent encore les architectes comme modèle, eux qui étudient les ruines antiques pour « composer dans l’esprit des Anciens […] au lieu d’emprunter des parties en les plaçant dans un contexte étranger. » (p. 39).
Le modèle de l’architecture pose toutefois quelques problèmes pour les défenseurs de la langue : dans le court chapitre « Résistance », Dominique Rouillard souligne l’une des critiques principales des gens de lettres contre le monument d’architecture : sa matérialité. Or « les défenseurs de la langue ne veulent pas reconnaitre dans la solidité et la massivité de l’architecture des qualités qui assurent la durée » (p. 47). Au XIXe siècle encore, des auteurs comme John Ruskin (1849)2 soutiennent que le monument perd sa capacité d’incarner la mémoire dès qu’il subit les affres du temps – c’est pourquoi Ruskin plaide pour l’entretien continu des monuments d’architecture, seul moyen de garantir leur mission de mémoire.
Le retournement du rapport de force est exploré dans le chapitre « Durée et visibilité », qui s’ouvre sur la question de la compréhension immédiate de l’architecture par le spectateur. L’architecture peut proposer des monuments universels, car perceptibles sans traduction : « le monument bâti comme langue pour illettrés » (p. 65). Toutefois, la matérialité et la visibilité de l’architecture font qu’elle s’impose, qu’elle peut aveugler, voire tromper par « excès de présence ». Dominique Rouillard prend l’exemple de la cathédrale, qui « évoque mieux que tout cette limitation de la connaissance "imposée" par le langage » (p. 65). La cathédrale est un « livre de pierre », qui enseigne par la vue d’images, qui impose l’émotion de l’image, au détriment de l’apprentissage de la lecture – et donc l’accessibilité directe des textes. C’est pour cela que dès le XVIIe siècle se pose la question se pose des inscriptions sur les monuments bâtis, illustration tangible de cette rencontre entre architecture et langue. L’auteure rappelle la dimension politique du choix de la langue de l’inscription. Dans les débats du XVIIe siècle, écrire – ici inscrire sur le monument – dans une langue, c’est choisir d’exclure ceux qui ne connaissent pas le latin, sous prétexte que le peuple ne lit de toute façon pas, ou rassembler tous les Français – volonté par exemple de l’abbé de Marolles (1677) ou de François Charpentier (1683). Le monument ne peut être objet des seuls érudits, la langue française permet de l’expliquer à tous. À la Révolution française, ce choix devient un enjeu pédagogique : Kersaint (1792) veut que soient inscrites les lois sur de nouveaux monuments, pour que chaque citoyen les lise et soit saisi d’un sentiment patriotique. Dominique Rouillard nuance toutefois : si la langue de l’inscription meurt, elle entraine avec elle le monument et sa puissance symbolique – même si le monument matériel, lui, résiste. Le monument tombe alors dans l’indifférence, (même) s’il est protégé par un cadre juridique, : plus personne toutefois n’y prête attention, comme s’en amuse Robert Musil (1965)3. L’auteure termine le chapitre sur ce que font les architectes pour que le monument ne tombe pas dans l’indifférence. Leur but n’est plus de garantir la durée à la mémoire – ce qui était pour l’architecte François Blondel le sens du monument – mais « d’accrocher, de racoler. » (p. 84).
Le dernier chapitre « Communication » débute par la réfutation de la « prophétie hugolienne », où l’écrivain affirme dans son roman Notre Dame de Paris que « le livre tuera l’église ». Pour Dominique Rouillard, le scénario de Victor Hugo relève pleinement de la fiction, mais se comprend dans le cadre d’une défense de l’art gothique, qui disparait peu à peu depuis la Renaissance et porté par les courants romantiques. Cette dernière partie propose de déconstruire la concurrence des supports mémoriaux, qui, bien avant l’invention de l’imprimerie, ont rendu la mémoire plus mobile et moins matérielle. Selon l’auteure, l’invention de l’imprimerie a surtout banalisé le fait d’écrire : l’inscription sur pierre devient alors une manière de distinguer le passé du présent et surtout de sacraliser l’architecture en tant que support mnésique. De fait, l’inscription sur pierre n’a jamais disparu, pas davantage que l’usage des langues anciennes. Au-delà du simple modèle du passé dont elles se réclament se réclamer, les inscriptions imposent une certaine révérence. La prévalence aujourd’hui encore d’édification de plaques commémoratives ou de monuments gravés de noms prouve bien la valeur commémorative de l’inscription. Dominique Rouillard fait le lien avec les créations contemporaines, d’une part, montrant comment l’enseigne, a d’une certaine manière pris le relais de l’inscription dans l’architecture moderne. D’autre part, elle expose aussi le paradoxe du monument moderne, dont la construction est jugée trop rapide, « comme s’il fallait qu’un ouvrage destiné à durer voit son chantier s’étirer pareillement dans le temps. » (p. 110). Ce « refus de rapidité » pousse ainsi certains architectes contemporains à « gonfler » le temps de leurs chantiers pour accroître la dimension monumentale de leurs créations. Si l’édifice a été construit trop rapidement, est-il condamné à disparaître ? Le livre s’achève sur la question de la démolition, en particulier dans des villes en constant développement. Si les bâtiments ne sont pas détruits pour être remplacés, ils sont laissés en l’état. Ils deviennent des « monuments-résidus » (p. 115), qui survivent parce qu’ils ont été oubliés, ignorés. Cette nature résiduelle est pour Dominique Rouillard, au final, le propre du monument.
D’une grande richesse et d’une grande densité, le livre retrace des siècles d’écrits sur la langue et l’architecture. Au croisement des disciplines de l’histoire de la langue, de l’écriture, de l’architecture, mais aussi de la linguistique, cet ouvrage marque par son important corpus de citations : architectes, gens de lettres, philosophes4, tous se sont saisis de la question de l’architecture au prisme de la langue. Les citations – auxquelles l’auteur consacre des pages entières – font la force de cet ouvrage. La mise en page de l’ouvrage rend non seulement la lecture très plaisante, mais permet de mettre au cœur du livre un corpus varié sur lequel Dominique Rouillard invite à réfléchir. Aux côtés des extraits, des illustrations donnent à voir cette architecture qui sinon n’est construite et racontée que par les mots. En étudiant le lien complexe qui unit l’architecture à la langue, elle souligne le rôle prépondérant de chacune de ces domaines dans la construction des doctrines de l’autre. L’auteure réussit à montrer toute la complexité de deux disciplines qui se confrontent, fascinées et façonnées l’une par l’autre.