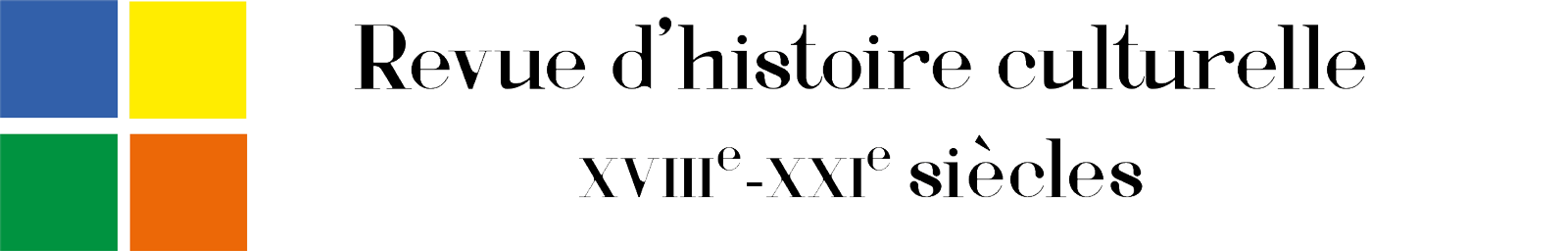Dans l’histoire du livre en France, la période napoléonienne constitue à la fois un moment charnière et un angle mort. Moment charnière car le fameux décret de 1810, mettant fin au désordre réglementaire dans lequel la Révolution avait laissé le monde de l’imprimé, en organise l’économie pour les six décennies à venir avec le système du brevet. Angle mort, car au-delà de cet acte fondateur bien connu des spécialistes, on savait jusque-là peu de choses des réalités concrètes de la gestion et du contrôle du monde du livre par un souverain et un régime soucieux de réglementer la plupart des aspects de la vie sociale et culturelle. C’est pour combler ce manque provoqué par le « relatif désintérêt des historiens pour la censure napoléonienne » (p. 12) que Patricia Sorel, spécialiste reconnue de l’histoire du livre, de l’édition et de la librairie à l’époque contemporaine, publie, à l’orée du bicentenaire de la mort de l’Empereur, ce Napoléon et le livre dont le titre cependant compte moins que son sous-titre : La censure sous le Consulat et l’Empire. Des rapports du vainqueur d’Austerlitz au livre en effet, il est peu question dans l’ouvrage – tout au plus y voit-on qu’il était un « grand lecteur » (p. 35), soucieux de se constituer une bibliothèque portative et de s’entourer de secrétaires et d’écrivains chargés de le tenir au courant des dernières parutions. Ne sont pas non plus évoquées l’aide aux écrivains ou bien les saisies d’imprimés effectuées par le conquérant de l’Europe dans le cadre du grand drainage vers Paris des œuvres d’art et fonds d’archives des pays occupés. Le propos est ailleurs, et centré sur un sujet précis se suffisant du reste à lui-même, celui de la censure exercée par le régime entre 1799 et 1815.
Ce thème on l’a dit est encore peu étudié. On ne s’étonnera donc pas que la bibliographie de l’ouvrage tienne en deux pages et une petite cinquantaine de références : quand on voit que moins d’une sur cinq seulement date des vingt dernières années, on comprend qu’il était temps que quelqu’un s’attelle à la tâche de réduire cet angle mort historiographique, entre une période moderne de l’histoire du livre bien jalonnée – en témoigne l’actuelle question au concours de l’agrégation – et un XIXe siècle (au sens académique du chrononyme) dont l’historiographie ne cesse elle aussi de se renouveler. L’ouvrage s’appuie sur les rares travaux d’ampleur existant sur cette période, notamment l’étude ancienne d’Henri Weslchinger (1887) sur la censure sous l’Empire, ainsi que les travaux de Bernard Vouillot (1979) et Odile Krakovitch (2008) sur les imprimeurs et libraires parisiens de cette période. Patricia Sorel a également dépouillé les séries F/7 (Ministère de l’Intérieur) et F/18 (Direction de l’Imprimerie et de la Librairie) des Archives nationales, bien connues des historiennes et historiens du livre, mais qui n’ont pas encore révélé tous leurs secrets, comme en témoigne l’étude des rapports de la préfecture et du Bureau de la presse du ministère de la Police, et surtout des bulletins quotidiens de cette même police : rien que pour la période courant de juillet 1803 à juillet 1804, une grosse centaine de ces bulletins sont adressés par le préfet au ministère de la Justice, proposant l’interdiction ou l’autorisation d’ouvrages soumis aux autorités.
Les résultats de cette recherche sont répartis entre quatre chapitres d’inégale ampleur. Les chapitres I, II et IV sont organisés de manière chronologique : ils décrivent l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de la censure de 1799 à 1810 d’abord, puis de 1810 à 1814, avant d’étudier « la suppression de la censure » entre les deux restaurations et les Cent-Jours. Ces pages d’histoire de l’administration de la culture nous montrent comment le Premier Consul puis l’Empereur mettent fin à la plus ou moins grande anarchie réglementaire qui régnait dans le monde du livre depuis 1789, anarchie régulièrement dénoncée par les membres de la profession comme par les auteurs. Ainsi s’objective une véritable politique du livre, soucieuse de répondre à une demande d’intervention de l’État, lequel met en place de manière empirique les outils qu’il juge nécessaires. On voit l’important travail de centralisation autour de services et de bureaux ministériels spécifiques : Division de la liberté de la presse au sein du ministère de la Police de Fouché (1804), puis Bureau de la presse dans ce même ministère, avant qu’une Direction de l’imprimerie et de la librairie ne soit créée au ministère de l’Intérieur par le décret de 1810. Une première approche prosopographique donne quelques éléments d’information sur ce groupe fondateur d’une politique, à commencer par les censeurs, ces écrivains de second rang, « hommes de lettres impécunieux ou en mal de reconnaissance » (p. 64) dont trois seulement passent par l’Académie française.
Napoléon lui-même, qui donne son titre à l’ouvrage, joue un rôle non-négligeable. Soucieux de limiter les prérogatives de son redoutable ministre de la Police générale, il fait jouer à plein la concurrence et l’émulation entre ces administrations. Il intervient aussi directement : il est, on le sait, coutumier du fait dans bien des domaines. Il envoie prescriptions et consignes à ses ministres, suit de près la préparation du décret de 1810 par le Conseil d’État, ordonne aussi lui-même, à l’occasion, des mesures vexatoires contre certains ouvrages (ainsi la saisie en 1810 d’un Essai historique et critique sur la Révolution française de Paganel). Mais ses interventions ont aussi parfois pour objectif de désavouer des censeurs un peu trop zélés à son goût. « C’est là l’un des paradoxes du régime », pointe Patricia Sorel (p. 37) : la censure mise en place ne dit pas son nom, l’empereur refuse d’assumer complètement le fait que « la liberté d’opinion a été abolie » et que « la liberté individuelle n’est pas respectée » (p. 91). Si une commission sénatoriale de la liberté de la presse est mise en place en mai 1804 pour garantir les droits des auteurs et des professionnels du livre qui se sentiraient lésés de ce point de vue, elle n’est saisie que huit fois en dix ans et ne protège rien du tout. Si on compte bien peu de poursuites et même d’interdictions d’ouvrages par rapport à l’ensemble de la production (autour de 3 % du total des publications en 1813), c’est surtout parce que quelques sanctions exemplaires (les archives recensent 158 saisies d’ouvrages entre 1800 et 1810, chiffre sûrement sous-estimé) découragent auteurs et imprimeurs : l’autocensure, motivée par la peur d’une saisie, d’une amende ou de la prison, joue déjà à plein sous l’Empire, comme elle le fera sous les régimes suivants.
Dans le collimateur de la censure se situent quatre catégories principales d’ouvrages dont le chapitre III nous livre un exemplier riche en informations : les écrits par trop favorables à l’Ancien Régime sont en première ligne – la Révolution comme la mort de Louis XVI sont des « sujets tabous » (p. 110). Les ouvrages suspects d’outrage aux bonnes mœurs, ceux traitant de religion ou bien encore tous les écrits de nature politique, traqués jusque dans les romans, sont aussi les principales cibles de la censure, dans des proportions que l’ouvrage ne donne pas – mais la bibliométrie en ce domaine est loin d’être évidente, sauf à vérifier systématiquement le contenu de tous les ouvrages concernés. Les limites humaines du travail historique rejoignent ici celles de l’activité censoriale : un millier d’ouvrages paraissent en moyenne chaque année avant 1810, quatre fois plus en 1811-1812. Même de plus en plus nombreux (8 en 1810, 20 en 1813), le corps des censeurs ne pouvait faire face à la marée montante de l’édition.
En dépit de ces limites, c’est une vraie réussite que nous donne à voir et à comprendre l’ouvrage de Patricia Sorel : celle de la mise en place d’une véritable politique de contrôle du livre, qui non seulement se fait de manière extrêmement rapide (dans d’autres domaines de la culture, il faudra beaucoup plus de temps pour que les problèmes soulevés par le débat public n’aboutissent à la mise en place des outils étatiques pour les traiter), mais trouve en plus rapidement les moyens de son efficacité à moindre coût ; à tel point que cette politique, ainsi que le rappelle la conclusion du livre, perdurera pendant soixante ans sans profondes évolutions dans son esprit sinon dans ses modalités, en résistant même à une demi-douzaine de changements de régime. Quant à comprendre comment cette réussite a été possible, la figure écrasante de Napoléon, qui donne son titre à l’ouvrage, ne saurait constituer l’unique explication. Au-delà de son « génie » ou en tout de cas de sa personnalité se cache en effet une série d’acteurs, de contingences, et de forces, tant sociales et culturelles que politiques, dont le jeu complexe doit pouvoir faire l’objet d’une analyse plus ample, à partir des pistes fournies par cette étude éclairante et stimulante. L’étude de ces acteurs et de ces mécanismes, en termes par exemple de sociologie historique, de réseaux, de générations, mais aussi de représentations, doit permettre de mieux comprendre comment la sphère politico-administrative s’est adaptée et a répondu au défi lancé par cette « révolution » culturelle qu’a constitué l’essor de l’imprimé au XIXe siècle.